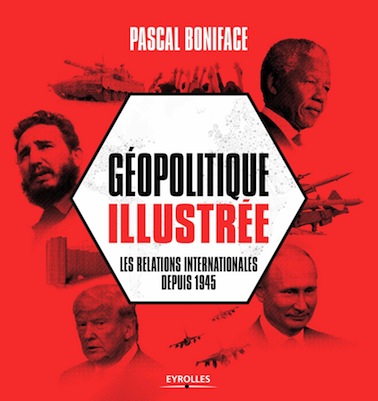
En un grand format, agrémenté de multiples schémas, d’encarts et d’illustrations qui éclairent des questions clefs (soft power, lanceurs d’alerte, ivoirité, perestroïka, déclin des grandes puissances…), nombreuses cartes aussi, Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, auteur d’une soixantaine d’ouvrages, a pris le parti évident de la pédagogie pour présenter à un assez large public, les relations internationales depuis 1945.
Il en découpe le déroulement en trois périodes. Celle de la guerre froide, celle de la détente, celle enfin du monde post-bipolaire, dans lequel nous évoluons. Cela a le mérite de la clarté. Car il s’agit à l’évidence de délimitations chronologiques, assez générales, qui ont pour mérite de fixer un cadre général d’analyse, des repères permettant de classer les événements décisifs qui caractérisent l’esprit de l’époque.
On date conventionnellement le début de la guerre froide au discours de Truman du 12 mars 1947, dans lequel il annonçait l’aide américaine à la Grèce et à la Turquie. Mais déjà peut-on distinguer la guerre froide « aiguë » ou la bipolarité rigide, qui a couvert les années 1947-1953, de la période de la coexistence pacifique qui a émergé en 1956, avec le discours de Khrouchtchev au XXe Congrès du PC soviétique et s’est prolongée jusqu’au début des années 1960. Puis les historiens et publicistes font débuter, la détente à la période qui a débuté après la crise des missiles de Cuba (22-28 octobre 1962), à la suite de laquelle différents instruments ou règles de comportement ont été mis en place entre Washington et Moscou (téléphone rouge, établi le 30 août 1963, accord de Moscou sur la limitation des essais nucléaires). Mais déjà, après la mort de Staline, le 6 mars 1953, les rapports Est-Ouest avaient connu un premier relâchement de tensions (armistice coréen de juillet 1953, traité d’État autrichien d’octobre 1955, « esprit de Genève »).
Pascal Boniface met l’accent sur l’âge d’or de la détente, qui a été la marque des années 1969-1974, celles de Nixon-Kissinger, marquées par les accords SALT, signés à Moscou, le 29 mai 1972, incarnant le sommet de la détente. Ce fut en effet une période marquée par le dialogue et non par la confrontation. Elle fut en réalité de courte durée. La guerre israélo-arabe d’octobre 1973 lui a porté les premiers coups, les États-Unis ayant entrepris seuls le processus diplomatique qui a suivi l’affrontement militaire. Après l’affaire du Watergate, qui a conduit à la démission de Richard Nixon en août 1974, le retrait des États-Unis, du Vietnam, en avril 1975, a succédé un discours de plus en plus sonore sur les « illusions » de la détente. L’URSS parvenue à la parité nucléaire avec les États-Unis, s’est lancée dans une vaste offensive pour gagner du terrain dans le Tiers-monde (Angola, Éthiopie, Yémen du Sud) ou préserver les acquis du socialisme (Tchécoslovaquie, août 1968) ou les défendre (intervention à Kaboul, le 24 décembre 1979). Il en est résulté, ce que l’on a déjà appelé « la nouvelle guerre froide », entre 1980 et 1985, date de l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl S. Gorbatchev en URSS. En lançant perestroïka et glasnost, l’adepte de la « nouvelle pensée » et le partisan de la « maison commune » en Europe, le 7e et dernier gensek, a ébranlé le système socialiste, auquel il a mis fin. Puis est intervenu l’effondrement de l’URSS, édifice politique, idéologique, économique et social, à bout de souffle. Au sein de cette succession d’événements entre la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989 et le départ de Gorbatchev, le 25 décembre 1991, où peut-on fixer la fin de la guerre froide ou de la bipolarité ?
Pascal Boniface penche, à la suite de James Baker, le secrétaire d’État, de George Bush père, pour le 29 novembre 1990, date de l’adoption de la résolution 678 du Conseil de sécurité, moment crucial de l’histoire des Nations unies. Les représentants soviétiques et américains votèrent alors la résolution, autorisant l’emploi de « tous les moyens nécessaires, y compris la force armée pour contraindre Saddam Hussein à évacuer le Koweït. Après cette césure d’ampleur, le monde bipolaire, qui avait structuré les relations internationales pendant cinq décennies, que certains présentaient comme immuable, ayant disparu, on est entré dans le monde post-bipolaire. L’emploi de cette expression générale cache en vérité la difficulté de nommer exactement la nature de l’ordre mondial actuel. On pressent pourtant que depuis 1990-1991 il est passé par plusieurs phases, et qu’il cherche toujours ses contours qui paraissent en constante évolution.
Pascal Boniface en décrit les principales étapes, marquées d’abord par l’échec du nouvel ordre mondial proclamé par George Bush père à l’issue de la guerre du Golfe. Puis on a été le témoin, de ce que Hubert Védrine a dénommé l’ère de l’hyperpuissance, une période s’étendant entre 1991 et 2001 ou 2003, au cours de laquelle la « nation indispensable », selon Madeleine Albright, secrétaire d’État de Bill Clinton, s’est trouvée sans contrepoids et sans contestation réelle. Certes, rappelle l’auteur, dès le début des années 1990 la plupart des analystes optaient plutôt pour la perspective d’un monde multipolaire. On voit cependant qu’il s’agissait plus d’intentions, de directions, d’objectifs que de réalités. Ce n’est qu’avec la montée en puissance de la Chine, apparue réellement lors de son adhésion à l’OMC en 2001 que se dessinent les linéaments encore isolés d’un monde multipolaire. Car ni le Japon, bien qu’ayant « réinterprété » sa Constitution pacifiste, ni l’Europe, toujours à la recherche de son « autonomie stratégique », ni l’Inde, premier importateur d’armes du monde, ni encore plus le Brésil, qui doit sortir de la crise actuelle, ne constituent, pour le moment, des pôles de puissance solides, autonomes et indépendants.
En dehors de ces questions globales, cet ouvrage fait une large part aux affaires régionales qui rendent compte des évolutions en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Au moment où Donald Trump s’évertue à ébranler bien des piliers du multilatéralisme, Pascal Boniface, qui ne voit aucune issue en dehors de celui-ci, n’ose pas annoncer après la guerre froide, la détente, le monde post-bipolaire, une quatrième période, celle du multilatéralisme. Nous en sommes encore loin. Il est vrai que sans avoir le profil des crises économiques, des bulles, les relations internationales connaissent leurs rythmes qui se déclinent en générations plutôt qu’en termes de mandats politiques.






