Eugène Berg analyse les principaux atlas stratégiques parus pour l'année 2025. Entre conflictualité mondiale, changements climatiques, interrogations européennes et occidentales et bouleversements de l'économie mondiale, un panorama quasi exhaustif des enjeux de notre temps.
Parmi les Atlas stratégiques (T 1700)
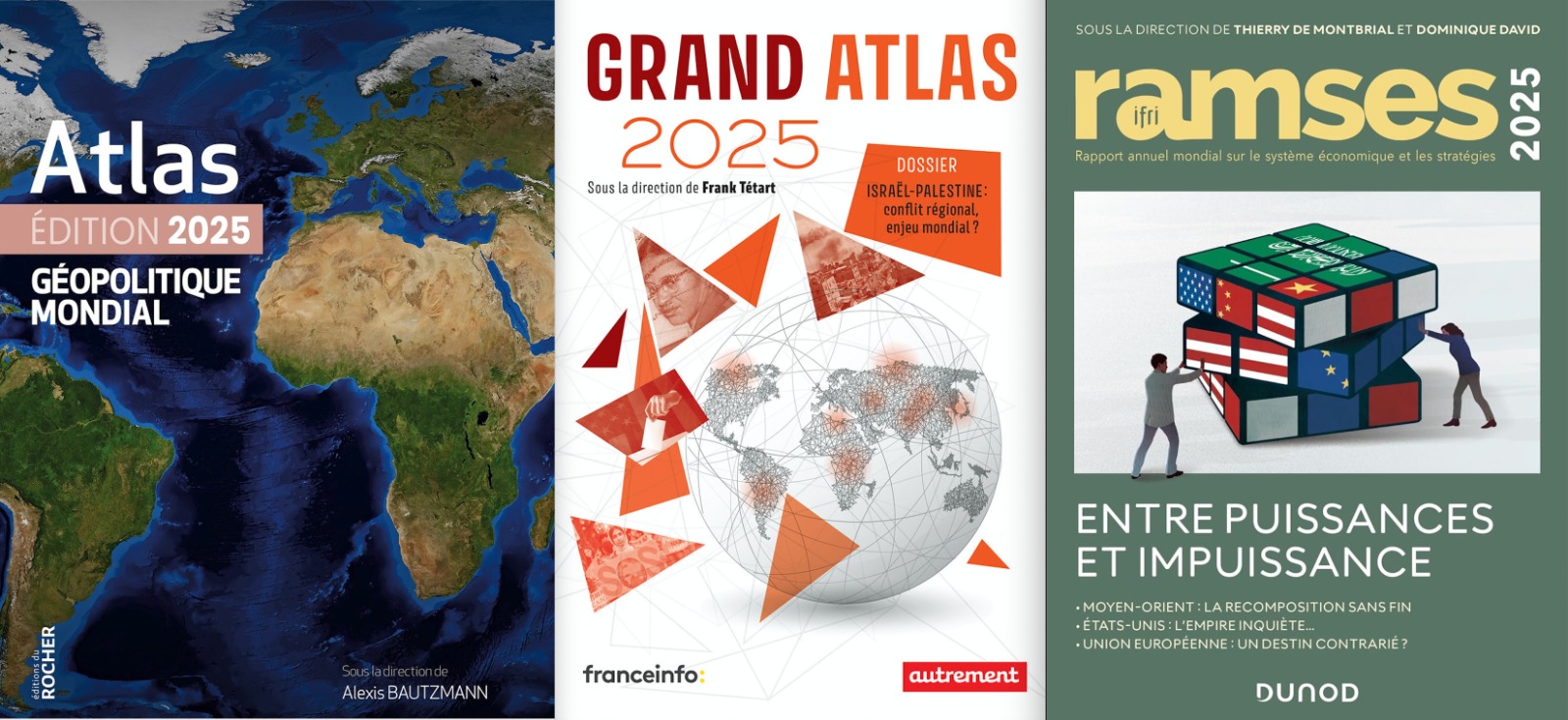
En cet automne 2024, l’actualité s’est une nouvelle fois emballée. D’un côté, l’offensive surprise de l’armée ukrainienne dans la région de Koursk se poursuit sans pour autant avoir atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’efforçait systématiquement d’obtenir le feu vert de Washington pour frapper le territoire russe en profondeur où le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) a identifié quelque 225 cibles, tout en présentant son plan de paix, destiné à placer l’Ukraine en position de force afin de contraindre la Russie à négocier la fin de la guerre, ce que celle-ci rejette toujours. Sans baisser la garde, l’aide occidentale semble avoir touché son pic bien que 100 milliards d’euros aient été promis à Kyiv.
D’un autre côté, on assiste à une spirale de la guerre au Proche-Orient où Tsahal, l’armée israélienne, fait pivoter son centre vers le nord et le Hezbollah libanais tout en ayant en ligne de mire l’Iran avec lequel elle se livre à un duel de moins en moins moucheté en s’en prenant à elle et à ses alliés Houthis. Ceux-ci, « paysans en guenilles », infligent grâce à leurs missiles iraniens des dommages progressivement sensibles aux rares navires empruntant encore la mer Rouge.
Fragmentation et hétérogénéité du monde
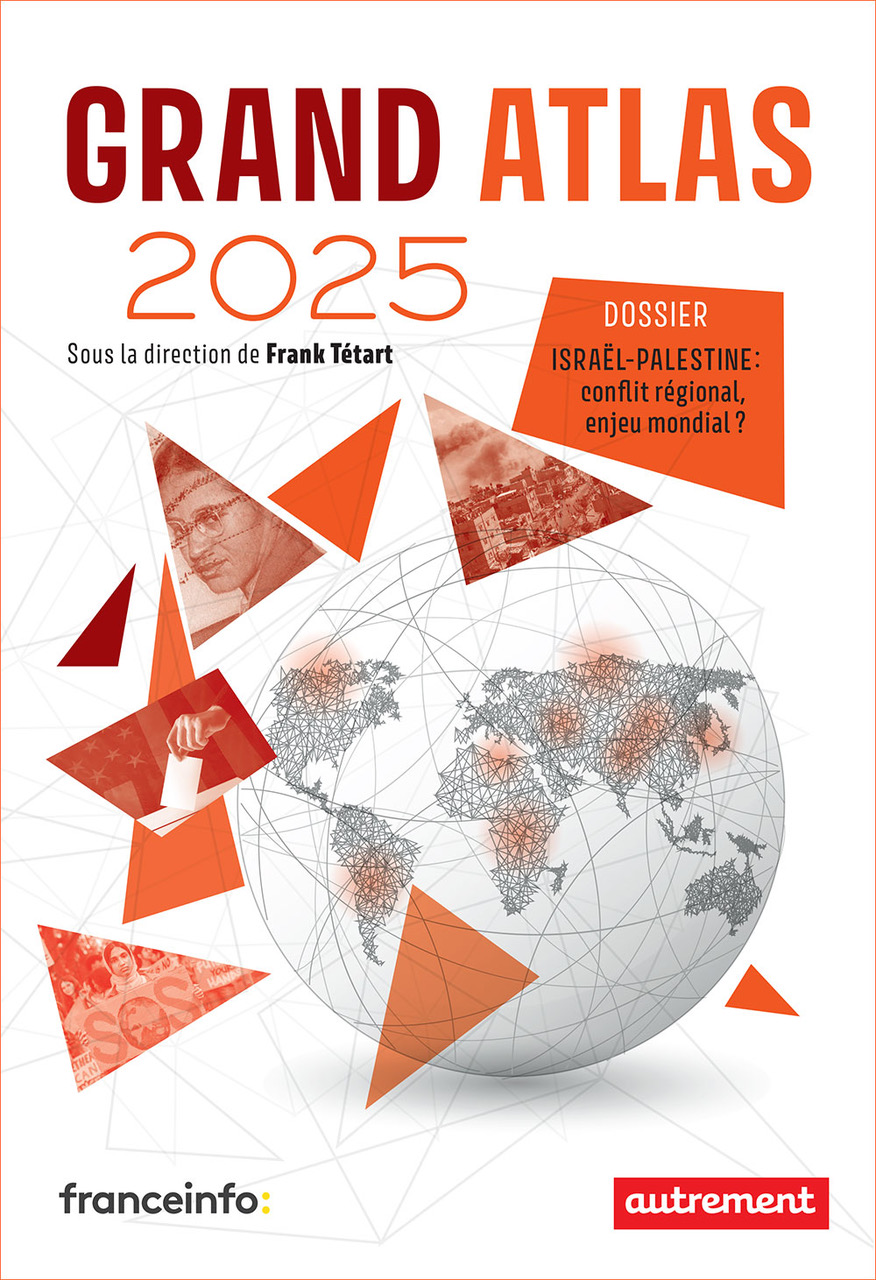 Ces deux conflits majeurs sont loin d’être les seuls qui fragmentent davantage le tissu international de plus en plus fragile et déchiré. La guerre civile au Soudan provoque la plus grande catastrophe humanitaire depuis des décennies. On trouvera sur ce point de solides entrées dans les divers Annuaires, mettant l’accent sur les mécanismes de cette guerre qui plonge ses racines dans le passé et résulte de causes socioculturelles profondes et durables. Il n’en demeure pas moins que plus encore que pour le conflit syrien, la guerre au Soudan implique bien des acteurs extérieurs. La Russie et les Émirats arabes unis (EAU) aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Hamdan Dagalo dit Hemetti ; l’Égypte, l’Iran, le Qatar et la Turquie du côté des Forces armées soudanaises (FAS) du général al-Burhan, installées désormais à Port-Soudan sur la mer Rouge. Dans la Corne de l’Afrique, l’accord annoncé entre l’Éthiopie et le Somaliland (république autoproclamée non reconnue par la communauté internationale) permettrait à l’Éthiopie de se désenclaver (1) et au Somaliland de progresser vers un véritable statut d’État. Cet accord qui bouscule le principe de l’uti possidetis juris, est porteur d’implications régionales, économiques et sécuritaires plus larges, en particulier pour les États du Golfe. La République démocratique du Congo (RDC), elle, n’en a pas fini avec la guérilla du M23 (Mouvement du 23 mars), qui met la main sur des mines de cobalt, dont le pays assure 60 % de la production mondiale. De son côté, la Tatmadaw (forces armées birmanes) ne parvient pas à rétablir son contrôle sur toute la Birmanie aux prises avec une guerre civile qui dure depuis des décennies. Le Grand Atlas 2025 indique que l’armée a perdu le contrôle de deux tiers du territoire, provoquant 3 millions de réfugiés.
Ces deux conflits majeurs sont loin d’être les seuls qui fragmentent davantage le tissu international de plus en plus fragile et déchiré. La guerre civile au Soudan provoque la plus grande catastrophe humanitaire depuis des décennies. On trouvera sur ce point de solides entrées dans les divers Annuaires, mettant l’accent sur les mécanismes de cette guerre qui plonge ses racines dans le passé et résulte de causes socioculturelles profondes et durables. Il n’en demeure pas moins que plus encore que pour le conflit syrien, la guerre au Soudan implique bien des acteurs extérieurs. La Russie et les Émirats arabes unis (EAU) aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Hamdan Dagalo dit Hemetti ; l’Égypte, l’Iran, le Qatar et la Turquie du côté des Forces armées soudanaises (FAS) du général al-Burhan, installées désormais à Port-Soudan sur la mer Rouge. Dans la Corne de l’Afrique, l’accord annoncé entre l’Éthiopie et le Somaliland (république autoproclamée non reconnue par la communauté internationale) permettrait à l’Éthiopie de se désenclaver (1) et au Somaliland de progresser vers un véritable statut d’État. Cet accord qui bouscule le principe de l’uti possidetis juris, est porteur d’implications régionales, économiques et sécuritaires plus larges, en particulier pour les États du Golfe. La République démocratique du Congo (RDC), elle, n’en a pas fini avec la guérilla du M23 (Mouvement du 23 mars), qui met la main sur des mines de cobalt, dont le pays assure 60 % de la production mondiale. De son côté, la Tatmadaw (forces armées birmanes) ne parvient pas à rétablir son contrôle sur toute la Birmanie aux prises avec une guerre civile qui dure depuis des décennies. Le Grand Atlas 2025 indique que l’armée a perdu le contrôle de deux tiers du territoire, provoquant 3 millions de réfugiés.
 Aussi n’est-il pas étonnant que Thierry de Montbrial commence ses traditionnelles « Perspectives » du Ramses 2025 - Entre puissances et impuissance par une réflexion sur l’hétérogénéité croissante de la planète. À ses yeux, cette série de conflits et de soubresauts comme une réaction aux excès de la mondialisation libérale, et de sa gouvernance qui n’a jamais été ni ouverte, ni inclusive. C’est ce qui explique en retour l’éclosion des régimes autoritaires ou dictatoriaux au sein de ce qu’il est convenu d’appeler le « Sud global ». Notre horizon n’apparaît guère engageant. Les États-Unis incertains d’eux-mêmes ne voudront plus après Joe Biden, enfant de la guerre froide, endosser le manteau de l’arbitre mondial et réduire le montant de leurs interventions extérieures en en transférant de plus en plus le coût et la responsabilité à leurs alliés européens ou de l’Indo-Pacifique. Cependant, si la fragmentation du monde s’accélère, on n’en est pas encore à la guerre économique à outrance.
Aussi n’est-il pas étonnant que Thierry de Montbrial commence ses traditionnelles « Perspectives » du Ramses 2025 - Entre puissances et impuissance par une réflexion sur l’hétérogénéité croissante de la planète. À ses yeux, cette série de conflits et de soubresauts comme une réaction aux excès de la mondialisation libérale, et de sa gouvernance qui n’a jamais été ni ouverte, ni inclusive. C’est ce qui explique en retour l’éclosion des régimes autoritaires ou dictatoriaux au sein de ce qu’il est convenu d’appeler le « Sud global ». Notre horizon n’apparaît guère engageant. Les États-Unis incertains d’eux-mêmes ne voudront plus après Joe Biden, enfant de la guerre froide, endosser le manteau de l’arbitre mondial et réduire le montant de leurs interventions extérieures en en transférant de plus en plus le coût et la responsabilité à leurs alliés européens ou de l’Indo-Pacifique. Cependant, si la fragmentation du monde s’accélère, on n’en est pas encore à la guerre économique à outrance.
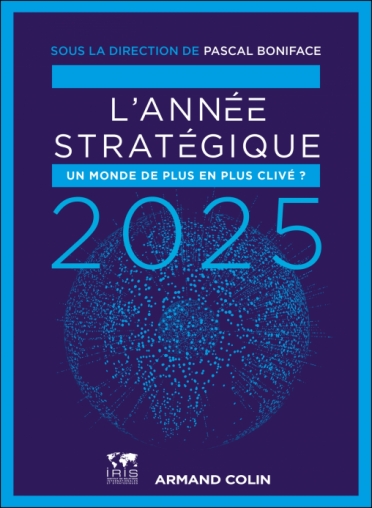 Pour sa part, dans l’introduction de L’Année stratégique 2025 – Un monde de plus en plus clivé ?, Pascal Boniface observe que ni les BRICS (2), pointe avancée du « Sud global », ni celui-ci ne forme une entité homogène, et que chaque État pratique à l’instar de l’Inde le multi-alignement. Il n’en reste pas moins que même si le Sud global n’existe pas vraiment, force est de constater qu’il constitue de plus en plus une caisse de résonance à la propagande russe en Afrique et au Sahel, où en l’espace de quelques années elle est parvenue à faire chasser la France et les États-Unis.
Pour sa part, dans l’introduction de L’Année stratégique 2025 – Un monde de plus en plus clivé ?, Pascal Boniface observe que ni les BRICS (2), pointe avancée du « Sud global », ni celui-ci ne forme une entité homogène, et que chaque État pratique à l’instar de l’Inde le multi-alignement. Il n’en reste pas moins que même si le Sud global n’existe pas vraiment, force est de constater qu’il constitue de plus en plus une caisse de résonance à la propagande russe en Afrique et au Sahel, où en l’espace de quelques années elle est parvenue à faire chasser la France et les États-Unis.
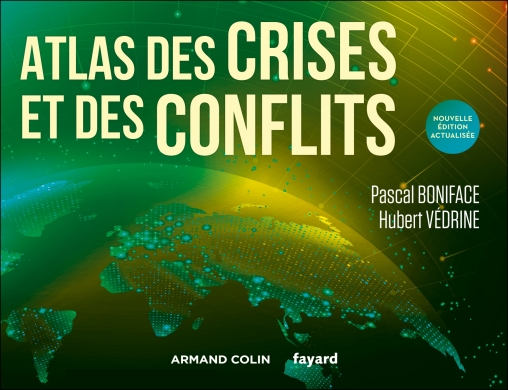 La nouvelle édition actualisée de l’Atlas des crises et des conflits de Pascal Boniface et Hubert Védrine s’inscrit dans cette ligne puisqu’elle commence à s’interroger sur les causes d’un monde chaotique, de la persistance des crises et conflits, du choc des volontés de puissance et d’influence, des États faillis, du rôle des opinions publiques, en donnant priorité au réalisme. À l’aide de cartes en couleur très explicites, cet atlas fournit un panorama complet des guerres, conflits, et points d’accrochage qui couvrent la surface de la planète regroupés par région.
La nouvelle édition actualisée de l’Atlas des crises et des conflits de Pascal Boniface et Hubert Védrine s’inscrit dans cette ligne puisqu’elle commence à s’interroger sur les causes d’un monde chaotique, de la persistance des crises et conflits, du choc des volontés de puissance et d’influence, des États faillis, du rôle des opinions publiques, en donnant priorité au réalisme. À l’aide de cartes en couleur très explicites, cet atlas fournit un panorama complet des guerres, conflits, et points d’accrochage qui couvrent la surface de la planète regroupés par région.
Le Kosovo est un État failli où les affrontements réapparaissent de temps à autre, alors que la situation dans les Balkans semble stabilisée compte tenu des perspectives d’adhésion des pays de la région à l’UE, ce qui montre l’effet régulateur que celle-ci exerce. Quant à l’Arménie, sortie affaiblie de ses conflits avec l’Azerbaïdjan (2020, 2023) auxquels Ramses 2025 consacre une entrée (« Arménie-Azerbaïdjan : la fin d’un conflit ? », par Gaïdz Minassian), elle se tourne progressi-vement vers le monde euro-atlantique en se munissant d’armes auprès de la France. La Turquie, dont le positionnement est peu à peu élargi, continue son conflit à bas niveau avec le Kurdistan, tout en entamant un processus de réconciliation avec la Russie qui s’est avéré peu convaincant au vue de l’évolution de la situation en Syrie et de la chute du régime de Bachar el-Assad. La Russie est perçue de plus en plus menaçante et agressive par ses voisins (pays baltes, Moldavie, etc.), tout en étant en butte aux mouvements djihadistes du Caucase.
En Amérique latine, c’est à des tensions principalement internes que l’on a affaire bien que le contentieux américano-cubain, vieux de soixante-cinq ans n’ait pas été apuré. Le Venezuela s’enfonce dans l’isolement et la crise et semble avoir renoncé à revendiquer l’Essequibo, province si riche en pétrole, appartenant au Guyana.
C’est donc le Moyen-Orient qui détient la palme des conflits, en ancienneté et du fait de leurs répercussions internationales. Si avant la guerre à Gaza, quinze pays n’avaient pas de relations diplomatiques avec l’Israël, ou huit les avaient rompus, cette liste s’est depuis rehaussée. On trouvera bien des cartes sur l’Iran, la Syrie, l’Irak, la Libye auxquels Ramses consacre d’abondants articles. Les crises en Afrique sont tout aussi nombreuses.
La Chine fait l’objet de pas moins de sept cartes, indice de sa montée en puissance et des tensions créées à l’intérieur (Tibet, Xinjiang) ou à ses marges (mer de Chine, Taïwan, Japon). Notons que si l’on parlait jusque-là en mer de Chine de la « ligne en neuf traits » masquant ses revendications en mer de Chine méridionale, une nouvelle image publiée par Pékin en 2023, mentionne dix points. Comment prévoir l’avenir de Taïwan au vu de l’énorme disproportion des budgets de défense de 310 milliards contre 17 Mds de dollars. S’agissant de la Corée du Sud, dont on a découvert l’efficace industrie d’armement, rien n’est dit de ses ambitions nucléaires qui pourraient bien prendre forme.
Une carte juxtapose les pays exportateurs d’armes d’au nombre de quatorze, dominés par les États-Unis (42 % du marché mondial) suivis par la France et la Russie (11 % chacune), la Chine (5,8 %), l’Allemagne (5,6 %) et la Pologne (4,3 %). En dehors de Haïti et de la Colombie, en Amérique latine, de Chypre et du Kosovo, en Europe, c’est en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud (Pakistan-Inde) que se trouvent la plupart des Opérations de maintien de la paix (OMP), ce qui reflète l’état des conflits dans le monde. Néanmoins, on le sait, bien d’autres zones de conflit n’ont pas entraîné une intervention de l’ONU : Arménie/Azerbaïdjan, Turquie/Kurdistan, Ukraine/Russie.
 La Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES) qui tient un colloque annuel à Toulon (octobre) publie tous les deux ans un Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient dont la dernière édition vient de paraître. Il s’agit d’une synthèse fort originale et complète s’appuyant sur une excellente cartographie portant sur les grands enjeux stratégiques du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient, mais aussi de la mer Noire et du Caucase du Sud. La spécificité de cet Atlas n’est pas de reprendre in extenso les données disponibles dans les différentes sources ouvertes, mais au contraire de les analyser, de les croiser et de les pondérer le cas échéant au filtre de l’expérience des experts de la FMES. S’agissant des armes des 33 pays de la zone ou qui y sont présents (États-Unis, Chine, Russie, France, etc.) l’atlas ne fournit pas leur seule liste, mais en propose une évaluation en fonction de leur âge, leur efficacité et leur usage opérationnel.
La Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES) qui tient un colloque annuel à Toulon (octobre) publie tous les deux ans un Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient dont la dernière édition vient de paraître. Il s’agit d’une synthèse fort originale et complète s’appuyant sur une excellente cartographie portant sur les grands enjeux stratégiques du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient, mais aussi de la mer Noire et du Caucase du Sud. La spécificité de cet Atlas n’est pas de reprendre in extenso les données disponibles dans les différentes sources ouvertes, mais au contraire de les analyser, de les croiser et de les pondérer le cas échéant au filtre de l’expérience des experts de la FMES. S’agissant des armes des 33 pays de la zone ou qui y sont présents (États-Unis, Chine, Russie, France, etc.) l’atlas ne fournit pas leur seule liste, mais en propose une évaluation en fonction de leur âge, leur efficacité et leur usage opérationnel.
Il livre de plus des grilles d’expertise permettant de décrypter les recompositions géopolitiques et l’évolution des forces armées. Si la grande stratégie américaine est bien connue, celle de la Chine exposée en une carte l’est un peu moins : 1) Sécuriser la mer de Chine. 2) Endiguer le Japon. 3) Étouffer l’Inde ou la forcer à négocier. 4) Vassaliser la Russie et affaiblir l’UE. 5) Isoler les États-Unis, ce qui passe par les axes de diffusion de l’influence chinoise que sont l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), les BRICS et la Ceinture et la voie (BRI) laquelle cherche à contrôler ou à tout le moins neutraliser les principaux points de franchissement maritimes (choke points), détroits de Taïwan, la Sonde, Malacca, Ormuz, Bab-el-Mandeb et Gibraltar, et canaux de Suez et Panama.
Diverses cartes commentées décrivent les recompositions géopolitiques du Moyen-Orient, espace de rivalités des puissances globales et régionales où l’insécurité alimentaire, le stress hydrique et le fait religieux pèsent de tout leur poids. Après la série très documentée des fiches pays, l’Atlas stratégique présente des bilans et les rapports de force de la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient. L’entrée la plus stimulante porte sur le scénario Israël vs Iran et Hezbollah sur lequel se termine l’ouvrage qui lui consacre sept pages. Un seul exemple parlant : Israël détient 1 850 chars contre 1 250 à l’Iran et le Hezbollah, dont 1 250 de première catégorie contre aucun à ses adversaires. Israël possède 12 satellites militaires, l’Iran 8. En conclusion, pour rétablir l’équilibre, l’Iran devrait durcir davantage ses réseaux de communications et de commandement, renforcer ses capacités cyber-nétiques et accroître le nombre de ses satellites. En aura-t-il le temps ?
Géographie humaine entre terre et mer
L’Atlas stratégique ne s’en tient pas aux seuls conflits armés ou aux crises récurrentes, mais dresse un tableau des menaces écologiques, de l’insécurité alimentaire, des désastres naturels, de la pression démographique et de la pénurie d’eau. Des facteurs d’instabilité que Ramses 2025 traite pareillement en mettant l’accent sur « Les flux maritimes [85 % du commerce mondial] à l’épreuve des crises » (Jérémy Bachelier) de la mer Rouge, nœud stratégique du commerce mondial au golfe de Guinée, en passant par la Corne de l’Afrique. N’oublions pas que les infrastructures, les routes de la Soie chinoises ou le Global Gateway lancé en réponse par l’UE en 2021, sont devenues des sources croissantes de rivalité.
De son côté, le Grand Atlas 2025 sous la direction de Frank Tétart examine les points chauds de la planète, présentant les 24 conflits en cours, dont les quatre de haute intensité (plus de 10 000 victimes). On notera que le Pakistan, entre instabilité politique et climatique, est le plus vulnérable de l’Asie du Sud devant le Bangladesh et le Népal avec 10 000 morts au cours de la dernière décennie. Il poursuit par les grands problèmes qui recouvrent à peu près tous ceux analysés dans les différents annuaires, y ajoutant le droit à l’avortement menacé dans le monde (un des enjeux de l’élection présidentielle américaine) et les féminicides. L’originalité du Grand Atlas est son substantiel dossier, fort d’une vingtaine de pages, consacré à « Israël-Palestine : conflit régional, enjeu mondial ? », qui offre une belle cartographie à travers les décennies de cette « guerre de Cent Ans ». La dernière partie se tourne vers l’avenir : « Et demain ? ». On peut regrouper les divers articles autour d’un thème commun, celui de la soutenabilité de la population mondiale qui devrait atteindre son pic en 2080 avec 10,4 Mds d’habitants. Cela ne menacera-t-il pas la biodiversité ? Quoi qu’il en soit, cela nous conduit à une adaptation permanente, nécessite une révolution doublement verte et de se reconnecter avec la biodiversité en ville. Cela impliquera aussi de sauver les océans (3) qui constituent 90 % de l’espace habitable de la planète et abritent près de 250 000 espèces connues. Saluons à cet effet la 3e Conférence des Nations unies sur les océans qui, après New York (2017) et Lisbonne (2022), se tiendra à Nice (coorganisée avec le Costa Rica) en juin 2025. Il s’agira de faire aboutir les négociations menées depuis plusieurs mois autour de la protection de la diversité marine, de l’exploitation minière des grands fonds ou encore de la pollution plastique.
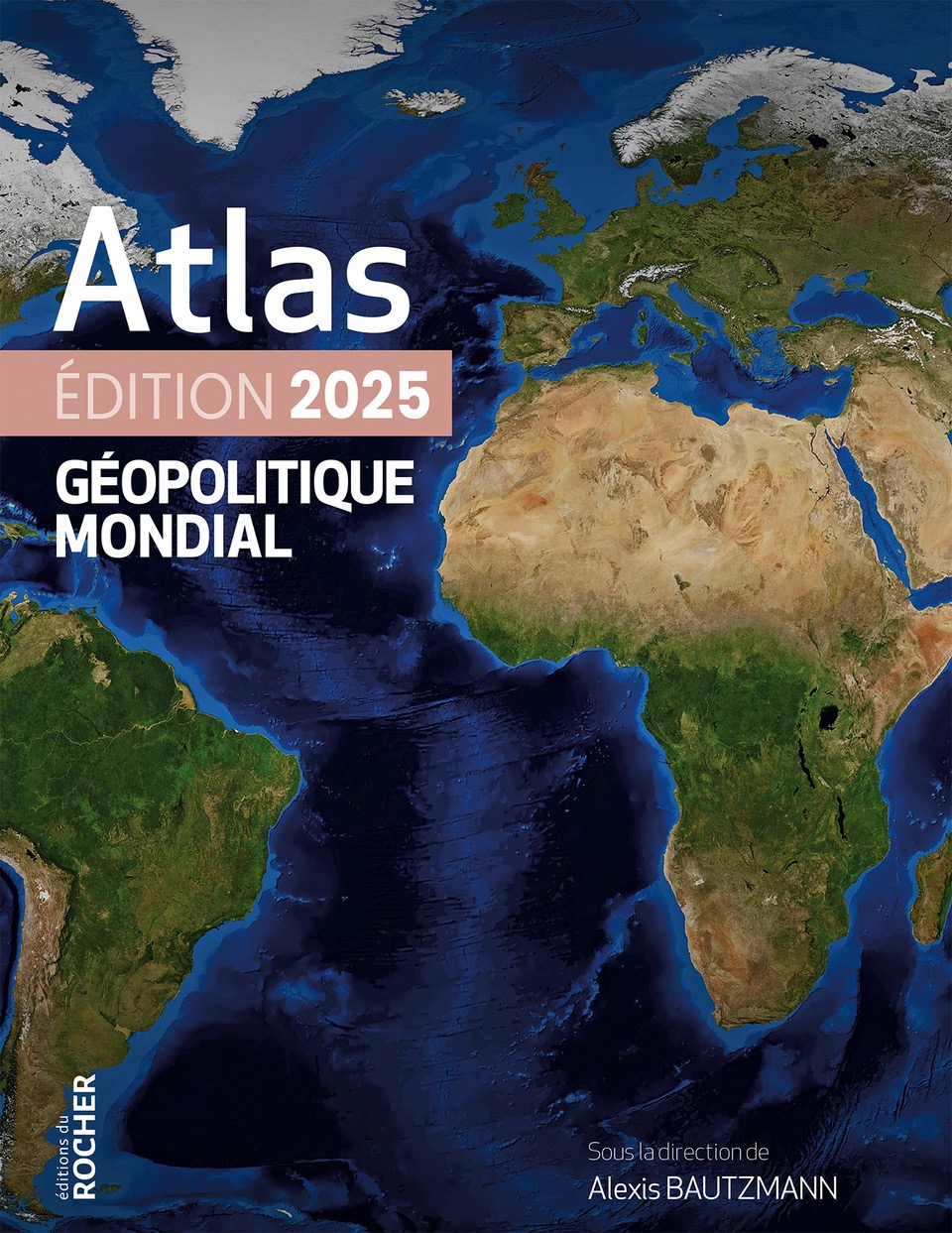 L’Atlas géopolitique mondial 2025, sous la direction d’Alexis Bautzmann, reste fidèle à sa ligne grâce à la richesse de ses cartes fort détaillées – qui s’étalent parfois sur deux pages – et à la variété des thèmes – il couvre toutes les régions du monde et la concision de ses commentaires. Sur le Moyen-Orient, outre les entrées portant sur les Palestiniens, le Hezbollah, le Sinaï, refuge des Palestiniens, on trouve des éléments intéressants sur la double inquiétude balistique et nucléaire, et le Moyen-Orient face à la faim. Le stock iranien d’uranium – 4 384,8 kilogrammes, en mai 2023 – a dû bien croître depuis et le pays possède 3 000 missiles, mais sautera-t-il le pas dans les circonstances actuelles et quel rôle, dans ce cas, joueront ses « tuteurs » russe et chinois, ce dernier lui reprochant de ne pas brider les Houthis dont les tirs en mer Rouge ont provoqué la hausse du prix de conteneurs de 3 000 à 7 000 $. Précisément l’Atlas comporte une carte fort détaillée des tensions géopolitiques en mer Rouge qui voyait passer 12 % du trafic maritime mondial, qui a reculé de 53 %, là où il a augmenté de 60 % à la pointe de l’Afrique. La partie consacrée à l’Afrique est bien fournie : série des coups d’État au Sahel, putsch au Gabon, guerres en RDC, et surtout au Soudan avec une pointe d’espoir représentée par Tanger-Med, plateforme logistique mondiale qui occupe le 24e rang des ports mondiaux et dont l’activité est double de celle du port d’Algésiras en Espagne juste en face. Le Grand Atlas fournit une carte (p. 97) répertoriant les 14 coups d’État ayant eu lieu en Afrique depuis 2012, dont la moitié se sont déroulés en Afrique de l’Ouest. La partie Asie comporte de solides analyses sur la Chine portant sur ses territoires, sa transition énergétique, son affrontement avec Taïwan, ses relations avec l’Inde ou le Vietnam. Le 28 août 2023, la Chine publiait une carte mentionnant tous les espaces chinois, la fameuse ligne des neuf points en mer de Chine méridionale en a rajouté un dixième à l’est de Taïwan. Et l’île de Bolchoï Oussouriisk au confluent de l’Amour et de l’Oussouri est devenue entièrement chinoise !
L’Atlas géopolitique mondial 2025, sous la direction d’Alexis Bautzmann, reste fidèle à sa ligne grâce à la richesse de ses cartes fort détaillées – qui s’étalent parfois sur deux pages – et à la variété des thèmes – il couvre toutes les régions du monde et la concision de ses commentaires. Sur le Moyen-Orient, outre les entrées portant sur les Palestiniens, le Hezbollah, le Sinaï, refuge des Palestiniens, on trouve des éléments intéressants sur la double inquiétude balistique et nucléaire, et le Moyen-Orient face à la faim. Le stock iranien d’uranium – 4 384,8 kilogrammes, en mai 2023 – a dû bien croître depuis et le pays possède 3 000 missiles, mais sautera-t-il le pas dans les circonstances actuelles et quel rôle, dans ce cas, joueront ses « tuteurs » russe et chinois, ce dernier lui reprochant de ne pas brider les Houthis dont les tirs en mer Rouge ont provoqué la hausse du prix de conteneurs de 3 000 à 7 000 $. Précisément l’Atlas comporte une carte fort détaillée des tensions géopolitiques en mer Rouge qui voyait passer 12 % du trafic maritime mondial, qui a reculé de 53 %, là où il a augmenté de 60 % à la pointe de l’Afrique. La partie consacrée à l’Afrique est bien fournie : série des coups d’État au Sahel, putsch au Gabon, guerres en RDC, et surtout au Soudan avec une pointe d’espoir représentée par Tanger-Med, plateforme logistique mondiale qui occupe le 24e rang des ports mondiaux et dont l’activité est double de celle du port d’Algésiras en Espagne juste en face. Le Grand Atlas fournit une carte (p. 97) répertoriant les 14 coups d’État ayant eu lieu en Afrique depuis 2012, dont la moitié se sont déroulés en Afrique de l’Ouest. La partie Asie comporte de solides analyses sur la Chine portant sur ses territoires, sa transition énergétique, son affrontement avec Taïwan, ses relations avec l’Inde ou le Vietnam. Le 28 août 2023, la Chine publiait une carte mentionnant tous les espaces chinois, la fameuse ligne des neuf points en mer de Chine méridionale en a rajouté un dixième à l’est de Taïwan. Et l’île de Bolchoï Oussouriisk au confluent de l’Amour et de l’Oussouri est devenue entièrement chinoise !
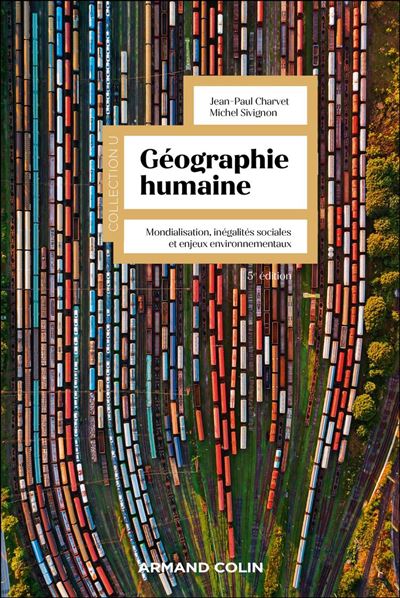 Géographie humaine : Mondialisation, inégalités sociales et enjeux inter-nationaux, dont on salue la 5e édition rénovée sous la direction de Jean-Paul Charvet et Michel Sivignon, est un instrument bien utile de réflexion et de savoir portant sur une gamme très étendue de questions, permettant au stratège, au planificateur, à l’économiste ou au chef d’entreprise de mieux se situer sur le terrain et de mieux comprendre son environnement. Depuis que l’on sait que « la géographie, ça sert à faire la guerre » (Yves Lacoste), approfondir les questions du paysage, de la carte (dont les premières furent militaires), du milieu et de l’environnement reste toujours essentiel tant la question des liens entre l’homme et le milieu est une vieille histoire. Ce qui suppose connaître l’évolution des climats, de la distribution des ressources et de la cartographie des espaces. On trouvera dans ce volume, des descriptions et des illustrations vivantes et récentes sur une vaste palette de sujets d’intérêt : « Peuplement et santé : approche géographique » (Gérard Salem, p. 69-88) ; « Aires culturelles et géopolitiques : le fractionnement du monde » (Michel Sivignon, p. 89-114) ; « Richesse, pauvreté, inégalités : esquisse d’une géographie sociale du monde » (Guy Di Méo, p. 115-163), sources de bien des conflits ; un chapitre solide sur les villes, avec leurs enjeux sociaux et environnementaux, tout en ne perdant pas de vue que la majorité des guerres se situe actuellement en milieu urbain. « Transports et mobilités : quelles limites ? » (Pierre Zembri, p. 289-327) ; un autre sur « Agricultures et espaces ruraux entre mondialisation et développement durable » (Jean-Paul Charvet, p. 205-250), sachant que toute la chaîne alimentaire à la fois en amont et en aval mobilise près de 45 % de la population mondiale. De même, à l’heure où l’on parle de réindustrialisation, élément indispensable pour disposer d’une large Base industrielle et technologique de défense (BITD), on lira avec intérêt les pages portant sur « Activités économiques, entreprises, et territoires à l’épreuve de la mondialisation et de ses crises » (François Bost, p. 251-287).
Géographie humaine : Mondialisation, inégalités sociales et enjeux inter-nationaux, dont on salue la 5e édition rénovée sous la direction de Jean-Paul Charvet et Michel Sivignon, est un instrument bien utile de réflexion et de savoir portant sur une gamme très étendue de questions, permettant au stratège, au planificateur, à l’économiste ou au chef d’entreprise de mieux se situer sur le terrain et de mieux comprendre son environnement. Depuis que l’on sait que « la géographie, ça sert à faire la guerre » (Yves Lacoste), approfondir les questions du paysage, de la carte (dont les premières furent militaires), du milieu et de l’environnement reste toujours essentiel tant la question des liens entre l’homme et le milieu est une vieille histoire. Ce qui suppose connaître l’évolution des climats, de la distribution des ressources et de la cartographie des espaces. On trouvera dans ce volume, des descriptions et des illustrations vivantes et récentes sur une vaste palette de sujets d’intérêt : « Peuplement et santé : approche géographique » (Gérard Salem, p. 69-88) ; « Aires culturelles et géopolitiques : le fractionnement du monde » (Michel Sivignon, p. 89-114) ; « Richesse, pauvreté, inégalités : esquisse d’une géographie sociale du monde » (Guy Di Méo, p. 115-163), sources de bien des conflits ; un chapitre solide sur les villes, avec leurs enjeux sociaux et environnementaux, tout en ne perdant pas de vue que la majorité des guerres se situe actuellement en milieu urbain. « Transports et mobilités : quelles limites ? » (Pierre Zembri, p. 289-327) ; un autre sur « Agricultures et espaces ruraux entre mondialisation et développement durable » (Jean-Paul Charvet, p. 205-250), sachant que toute la chaîne alimentaire à la fois en amont et en aval mobilise près de 45 % de la population mondiale. De même, à l’heure où l’on parle de réindustrialisation, élément indispensable pour disposer d’une large Base industrielle et technologique de défense (BITD), on lira avec intérêt les pages portant sur « Activités économiques, entreprises, et territoires à l’épreuve de la mondialisation et de ses crises » (François Bost, p. 251-287).
L’espace marin revêt de plus en plus d’importance. Le commerce mondial est assuré par la mer à 80 % en valeur et 90 % en volume. La part transitant par conteneurs représente 35 % en volume, mais 60 % en valeur. Bien des conflits actuels se déroulent sur les mers. Bien que dépourvue de véritable marine, l’Ukraine a chassé l’essentiel de la flotte russe de Sébastopol grâce à ses drones sous-marins. Les Houthis, armés par l’Iran et peut-être demain par la Russie, ont fortement réduit le trafic en mer Rouge. L’Éthiopie, en reconnaissant le Somaliland, se ménage une sortie en mer Rouge dont elle avait été privée du fait de l’indépendance de l’Érythrée, proclamée le 23 mai 1993. Le récent sabotage de deux câbles sous-marins en mer Baltique met une fois de plus l’accent sur la guerre hybride, mais nous rappelle que 98 % des données numériques transitent par un des 552 câbles sous-marins optiques qui ceinturent les fonds marins. La Chine menace d’étouffer Taïwan et se livre à des exercices de plus en plus intrusifs aux abords de ses eaux territoriales en y dépêchant le premier de ses trois porte-avions le Liaoning. On se prépare désormais à une guerre de haute intensité, type guerre des Malouines (1982). La France dispose encore d’une marine de premier rang, mais sa taille reste échantillonnaire – un seul porte-avions et seulement 15 frégates –, à l’heure où un engagement majeur possible ne peut être exclu.
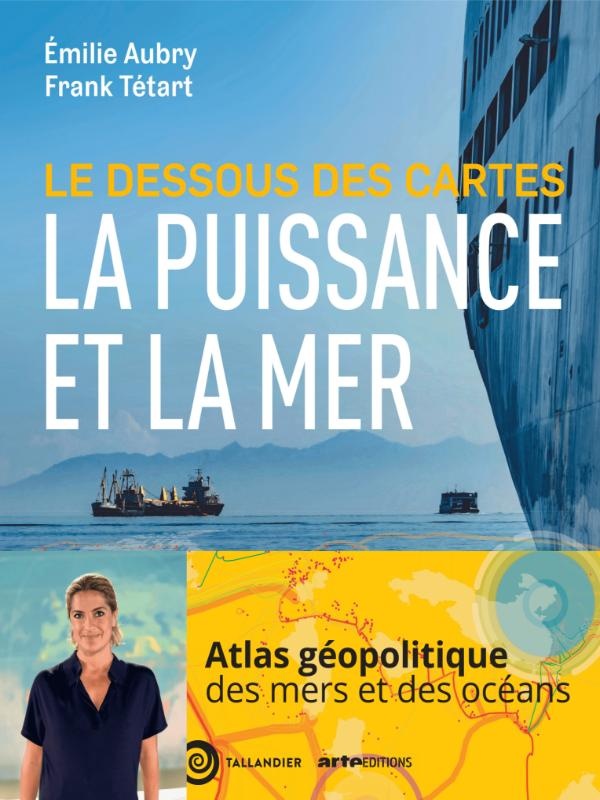 C’est dire tout l’intérêt de La puissance et la mer – Atlas géopolitique des mers et des océans rédigé par Émilie Aubry, qui anime l’émission « Le dessous des cartes », avec le concours du géographe Frank Tétart et du cartographe Thomas Ansart. Pour ce faire, elle a sélectionné parmi les 5 océans et 113 mers du monde, 21 escales, qui chacune raconte un grand enjeu du XXIe siècle. Les canaux (Panama, Suez), et les détroits (Gibraltar, Bab-el-Mandeb – où nous nous rendons à Salif, port yéménite et fief des Houthis –, Ormuz – « l’autoroute du pétrole », à Musandam, exclave du Sultanat d’Oman). Bien d’autres points chauds sont examinés à la loupe, comme le pont de Kerch, long de 18 kilomètres, qui n’est que le 9e pont le plus long du monde, celui reliant Hong Kong à Macao faisant 55 km. Le conflit ukrainien dans sa dimension maritime est amplement traité, avec des entrées fournies sur la mer d’Azov, une carte fort précise de la Crimée en relief, une autre sur la mer Noire, qui était avant la guerre une route maritime majeure avec un trafic annuel de 40 000 navires, traversée par les gazoducs Turk Stream (30 milliards de m3/an) et Blue Stream (16 Mds de m3/an). La Baltique, autre front Otan/Russie, est passée du statut de lac soviétique à celui de lac européen ou otanien, du fait du retour de la Rysskräck (peur de la Russie) apparue dès 2014 et qui s’est intensifiée considérablement après février 2022. Que l’on jette un coup d’œil sur la carte de l’île de Gotland, le « porte-avions insubmersible suédois », la plus grande île de la Baltique (3 184 km2) où sont stationnés 25 000 soldats pour 60 000 habitants. De l’autre côté, Kaliningrad, 15 000 km2, 1 million d’habitants, encadrés entre la lagune de Courlande et celle de Vistule, avec ses deux bases navales.
C’est dire tout l’intérêt de La puissance et la mer – Atlas géopolitique des mers et des océans rédigé par Émilie Aubry, qui anime l’émission « Le dessous des cartes », avec le concours du géographe Frank Tétart et du cartographe Thomas Ansart. Pour ce faire, elle a sélectionné parmi les 5 océans et 113 mers du monde, 21 escales, qui chacune raconte un grand enjeu du XXIe siècle. Les canaux (Panama, Suez), et les détroits (Gibraltar, Bab-el-Mandeb – où nous nous rendons à Salif, port yéménite et fief des Houthis –, Ormuz – « l’autoroute du pétrole », à Musandam, exclave du Sultanat d’Oman). Bien d’autres points chauds sont examinés à la loupe, comme le pont de Kerch, long de 18 kilomètres, qui n’est que le 9e pont le plus long du monde, celui reliant Hong Kong à Macao faisant 55 km. Le conflit ukrainien dans sa dimension maritime est amplement traité, avec des entrées fournies sur la mer d’Azov, une carte fort précise de la Crimée en relief, une autre sur la mer Noire, qui était avant la guerre une route maritime majeure avec un trafic annuel de 40 000 navires, traversée par les gazoducs Turk Stream (30 milliards de m3/an) et Blue Stream (16 Mds de m3/an). La Baltique, autre front Otan/Russie, est passée du statut de lac soviétique à celui de lac européen ou otanien, du fait du retour de la Rysskräck (peur de la Russie) apparue dès 2014 et qui s’est intensifiée considérablement après février 2022. Que l’on jette un coup d’œil sur la carte de l’île de Gotland, le « porte-avions insubmersible suédois », la plus grande île de la Baltique (3 184 km2) où sont stationnés 25 000 soldats pour 60 000 habitants. De l’autre côté, Kaliningrad, 15 000 km2, 1 million d’habitants, encadrés entre la lagune de Courlande et celle de Vistule, avec ses deux bases navales.
On l’aura compris : cet atlas, richement documenté et muni de cartes de grande qualité est une mine de renseignements sur la gamme la plus large de sujets tant historiques, mais principalement actuels ou à venir, comme la pêche et la guerre de filets, les câbles sous-marins, la puissance invisible, les abysses – un enjeu du XXIe siècle – ou l’Arctique et l’Antarctique, des mondes marins très convoités. On assiste désormais à une militarisation des pôles. Moscou renforce ses bases, comme celle de Severomorsk, une vingtaine de kilomètres au nord de Mourmansk (unique port du Grand Nord russe ne gelant pas en raison du Gulf Stream) qui abrite les deux tiers des sous-marins russes. Les pays de l’Otan y organisent des manœuvres bisannuelles depuis 2006, baptisées Cold Response, mobilisant jusqu’à 30 000 hommes en 2022. L’océan Indien où l’Inde avec ses 7 500 km de côtes reprend la mer, troisième espace maritime du monde relativement modeste avec ses 70 millions de km2, rassemble sur ses pourtours un tiers de la population mondiale, soit 2,7 milliards d’habitants – l’Inde à elle seule en comptant 1,4 Md. Elle cherche à rattraper son retard, en développant sa production nationale, notamment la fabrication d’un porte-avions et d’un sous-marin 100 % made in India. Une carte sur deux pages illustre bien les rivalités indo-chinoises, la Chine faisant preuve d’un impérialisme maritime de moins en moins dissimulé comme le montre l’entrée consacrée à ce sujet des plus actuels. À noter que la fameuse « langue de bœuf » chinoise, la ligne à neuf traits (désormais à dix), inclut Taïwan dont le budget militaire est dix fois inférieur et ses forces armées actives douze fois inférieures (169 000 contre 2,1 M). Une carte fort éloquente en grand format montre sa grande vulnérabilité face au géant chinois : étroitesse de ses eaux territoriales, faible densité de sa frontière maritime, proximité des îles de Kinmen, de Wuqiu et des Matsu avec le continent qui pourrait les gober sans effort. Saluons enfin, au vu des événements se déroulant en Nouvelle-Calédonie, les pages bien fournies consacrées à la place de la France en Indo-Pacifique, qui repose sur son immense domaine maritime – 9 M de km2 sur les 10 911 921 km2 que compte sa Zone économique exclusive (ZEE) dont 98 % se trouvent en outre-mer.
On trouvera des développements tout aussi fournis sur l’ensemble des espaces maritimes : Caraïbes, Méditerranée, Golfe persique, Manche – petite mer de 75 000 km2 aux grands enjeux car elle reste une des grandes voies maritimes du monde, plus de 754 M de tonnes de marchandises y ont circulé en 2022 soit plus de 180 000 navires.
Les guerres sans fin ?
L’onde de choc du 7 octobre dans la région
Visiblement l’onde de choc provoquée par l’audacieuse et sanglante opération du Hamas, est loin d’avoir épuisé ses effets. À mesure que les violences se sont intensifiées, les puissances occidentales ont appelé Israël à faire preuve de retenue, sans pour autant exercer de pressions autres que verbales, remarque Pascal Boniface, ce qui n’est plus tout à fait exact. Cependant, il a raison de souligner que les pays du Sud global ont interrogé la position des Occidentaux, qu’ils accusent de pratiquer le double standard. Ramses 2025 commence d’ailleurs son rapport annuel par un copieux dossier « Moyen-Orient : la recomposition sans fin », comprenant neuf articles traitant en profondeur ces questions de Gaza au Golfe, de l’Iran et de ses voisins. Avant même le récent ébranlement au Liban, on mesurait le dilemme stratégique de Téhéran qui, tout attaché qu’il soit à la cause palestinienne et en étant le soutien le plus ferme du Hezbollah, redoute d’être entraîné dans une déflagration régionale, ce qui mettrait en péril son rapprochement avec l’Arabie saoudite ainsi que le renforcement de ses relations avec les Émirats, Oman et le Qatar. De même, les relations turco-israéliennes fluctuent au rythme des évolutions de la diplomatie turque, laquelle a revalorisé la question palestinienne tout en cherchant toujours à jouer un rôle dans une éventuelle médiation de paix, dont on voit qu’elle semble plus éloignée que jamais.
Dans L’Année stratégique (« Une situation régionale surplombée par la guerre contre Gaza »), Didier Billion jugeait au printemps 2024 peu probable un embrasement général, au moins jusqu’aux élections américaines. Il relevait que les régimes arabes au-delà de déclarations compassionnelles n’ont pris aucune initiative politique véritable en faveur des Palestiniens. Ramses 2025, consacre une bonne partie de son rapport au Moyen-Orient : la recomposition sans fin. Une chose est de constater que le conflit à Gaza oppose deux acteurs en crise interne : des Palestiniens sans représentation crédible et des Israéliens politiquement très clivés, ce qui n’a fait que s’accentuer. Une autre est de souhaiter une mobilisation internationale seule à même de rendre concevable une solution à deux États, unique solution de sortie possible pour un conflit séculaire. Cette mobilisation est-elle envisageable dans l’état de fragmentation de la société internationale ? Et si la réponse était une confédération, ainsi que le préconisent de bons connaisseurs du dossier ? Entre les trois solutions, un seul État, deux États, État binational, elle apparaît a priori la plus raisonnable, mais hélas suppose la disparition des haines accumulées de part et d’autre. Gaza, vue de l’extérieur, est une autre entrée stimulante tant il est vrai que la question s’est introduite dans les débats internes de presque tous les pays du monde, beaucoup plus que la guerre en Ukraine.
La guerre d’Ukraine, une issue en 2025 ?
Thierry de Montbrial cherche à prendre de la distance à l’égard des discours répandus sur la guerre en la replaçant dans une perspective historique, celle de la constitution et du démembrement d’un empire. Il pousse l’analyse en esquissant, une comparaison entre l’Algérie par rapport à la France, et l’Ukraine face à la Russie. Cette comparaison n’est pas raison : si « l’Algérie, c’est la France » a déclaré François Mitterrand en novembre 1954, le berceau de la France ne s’y trouvait pas. Alors que Russie moscovite puis tsariste et, bien plus tard, Ukraine sont toutes deux nées d’un même berceau : la Rus’ de Kiev. Néanmoins, que peut-on dire de plus sur l’évolution du conflit, de la lassitude qui s’instaure un peu partout à son égard, sur la nécessité de poursuivre l’aide occidentale, en faisant sauter les verrous qui s’opposent à son extension. L’issue de la guerre se jouera principalement à Washington, sur un échiquier plus vaste que celui de l’Ukraine, conclut-il. Qu’est-ce à dire d’un remodelage de l’ensemble du système de sécurité qui, cette fois-ci, ne peut être qu’européen comme dans les années 1970 et 1980. Washington ne va troquer son abandon de Taïwan en échange d’un engagement de Pékin de ne plus défendre la Russie.
Plusieurs entrées du Ramses 2025 sont consacrées à l’Ukraine, portant plus sur les évolutions intérieures du pays que sur le champ de bataille ou du point de vue de l’extérieur. La guerre vue de Berlin est importante du fait des récentes évolutions du principal soutien financier européen de l’Ukraine qui vient de décider de diviser son aide par deux, et reste opposée aux frappes en profondeur sur le territoire russe, se refusant à livrer ses Taurus d’une portée de 1 200 km.
La gangstérisation du monde
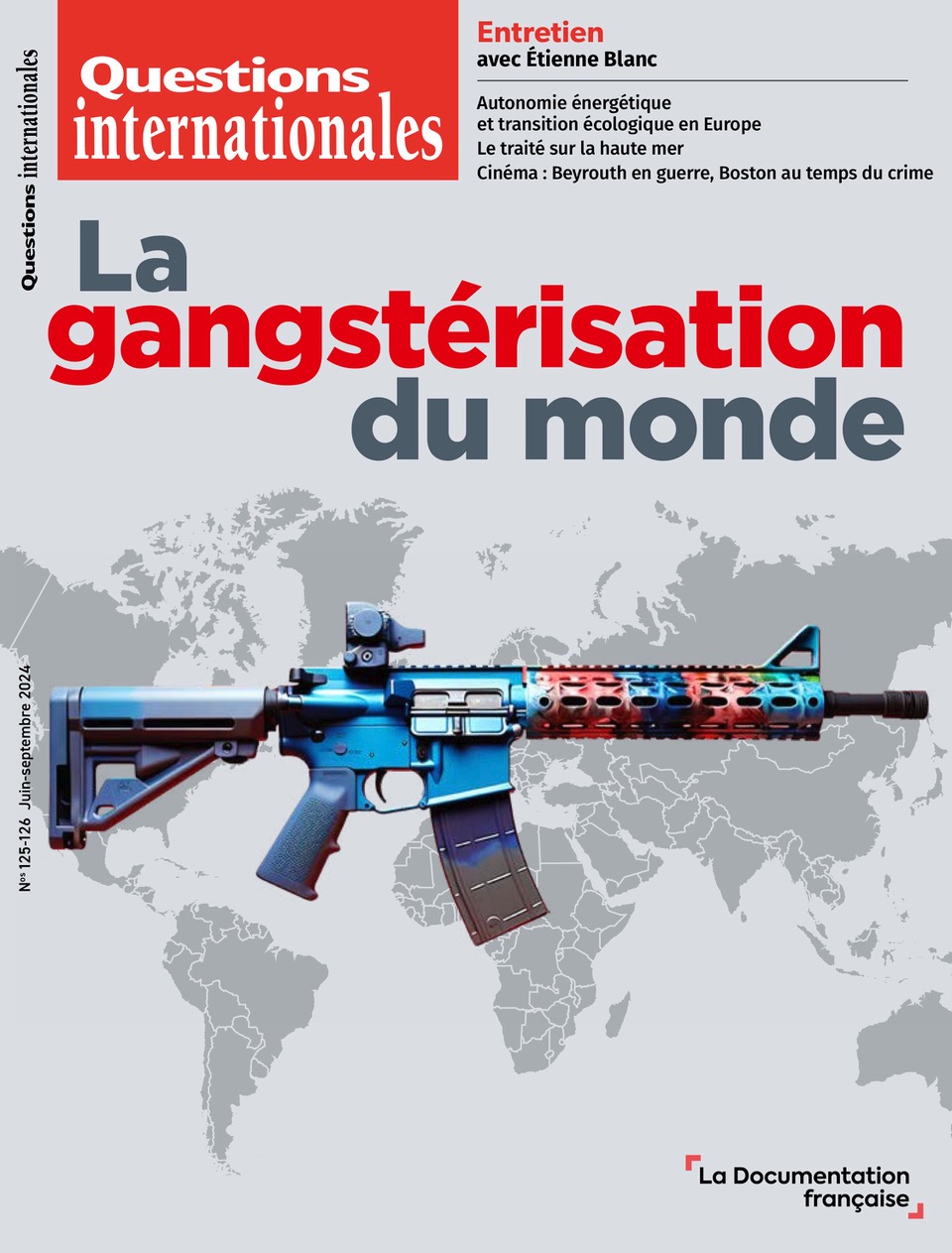 Puis que le terme de chaos, d’insécurité, de déstabilisation revient sous toutes les plumes, il paraît bien utile de se plonger dans le dernier numéro de Questions internationales n° 125-126 consacré à cette question. Dans son introduction, Serge Sur opère la distinction entre criminalité et gangstérisme. Alors que la première est généralement cantonnée au territoire d’un seul État dont elle transgresse la législation fiscale ou sociale, le gangstérisme a une dimension internationale. C’est en effet à une véritable galaxie de la gangstérisation que l’on a affaire, et celle-ci pour être jugulée requiert par moments le recours aux forces armées ou paramilitaires. Les drogues sont la première activité illicite mondiale avec un chiffre d’affaires oscillant entre 250 et 320 milliards de dollars par an. Notons que le président sortant mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a retiré la responsabilité de la lutte contre le narcotrafic à la police pour la confier à l’armée. Quand on voit que les drogues sont originaires d’une poignée de pays (Colombie, Mexique, Afghanistan, Birmanie, Laos), on peut s’interroger sur l’efficacité de la lutte menée contre les fabricants, les transporteurs, les distributaires de cannabis, de cocaïne, d’héroïne ou autres drogues de synthèse qui ont fait irruption comme le fentanyl qui a provoqué la mort de 700 000 Américains en vingt-cinq ans. Si l’on en croit l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDIC), 800 à 2 000 Mds $ seraient blanchis chaque année, soit entre 0,8 % et 2 % du PIB mondial (chiffre proche des dépenses mondiales d’armement) alors que moins de 1 % de ce montant est intercepté !
Puis que le terme de chaos, d’insécurité, de déstabilisation revient sous toutes les plumes, il paraît bien utile de se plonger dans le dernier numéro de Questions internationales n° 125-126 consacré à cette question. Dans son introduction, Serge Sur opère la distinction entre criminalité et gangstérisme. Alors que la première est généralement cantonnée au territoire d’un seul État dont elle transgresse la législation fiscale ou sociale, le gangstérisme a une dimension internationale. C’est en effet à une véritable galaxie de la gangstérisation que l’on a affaire, et celle-ci pour être jugulée requiert par moments le recours aux forces armées ou paramilitaires. Les drogues sont la première activité illicite mondiale avec un chiffre d’affaires oscillant entre 250 et 320 milliards de dollars par an. Notons que le président sortant mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a retiré la responsabilité de la lutte contre le narcotrafic à la police pour la confier à l’armée. Quand on voit que les drogues sont originaires d’une poignée de pays (Colombie, Mexique, Afghanistan, Birmanie, Laos), on peut s’interroger sur l’efficacité de la lutte menée contre les fabricants, les transporteurs, les distributaires de cannabis, de cocaïne, d’héroïne ou autres drogues de synthèse qui ont fait irruption comme le fentanyl qui a provoqué la mort de 700 000 Américains en vingt-cinq ans. Si l’on en croit l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDIC), 800 à 2 000 Mds $ seraient blanchis chaque année, soit entre 0,8 % et 2 % du PIB mondial (chiffre proche des dépenses mondiales d’armement) alors que moins de 1 % de ce montant est intercepté !
Quant au marché des Armes légères et de petit calibre (ALPC), on voit qu’il est bien difficile de la juguler. En 2017, l’Union africaine a lancé l’initiative « Faire taire les armes d’ici 2020 », en agissant sur les causes profondes de la violence armée. On mesure la distance entre les mots et les actes.
L’Union européenne entre élargissement et approfondissement
Elle constitue le troisième thème le plus abordé des annuaires. Dans la dernière partie de ses « Perspectives », Thierry de Montbrial se demande si l’UE est « une unité politique pérenne », ou si elle n’est pas déformée par les élargissements à venir qui avant 2030 devraient porter ses membres de 27 à 33 ou 36 membres (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie, Turquie, Ukraine). Toute une partie du Ramses 2025 est intitulée : « Union européenne : un destin contrarié ? ». L’agrandissement pour sûr représente un défi existentiel et géopolitique bien plus grand que les élargissements, survenus entre 1994 et 2013. Cela pose le problème des valeurs, des institutions, des politiques et des finances. Ce dernier point est le plus préoccupant. Le seul Green Deal nécessitera 620 milliards d’euros par an dans les années à venir, la transition digitale autour de 125 Mds, ce à quoi s’ajouteraient les recommandations du rapport Draghi, paru début septembre, préconisant 800 Mds € par an pour encourager la R&D dans les technologies d’avenir, l’énergie, la formation, les matériaux critiques, etc. C’est donc toute la procédure de négociation et d’adhésion (par étape et progressive) qui doit être réinventée. Et ce, au moment où l’UE s’engage à renforcer sa défense, ce qui exige de porter ses défenses à 3 % de son PIB, à européaniser l’Otan, alors que sa croissance est poussive et qu’elle a décroché dans la course technologique ses dépenses de R&D n’atteignant que 2,2 % de son PIB contre 4,9 % pour la Corée du Sud, 3,5 % les États-Unis et 2,5 % pour la Chine, chiffre allant croissant.
Allemagne, changement d’époque
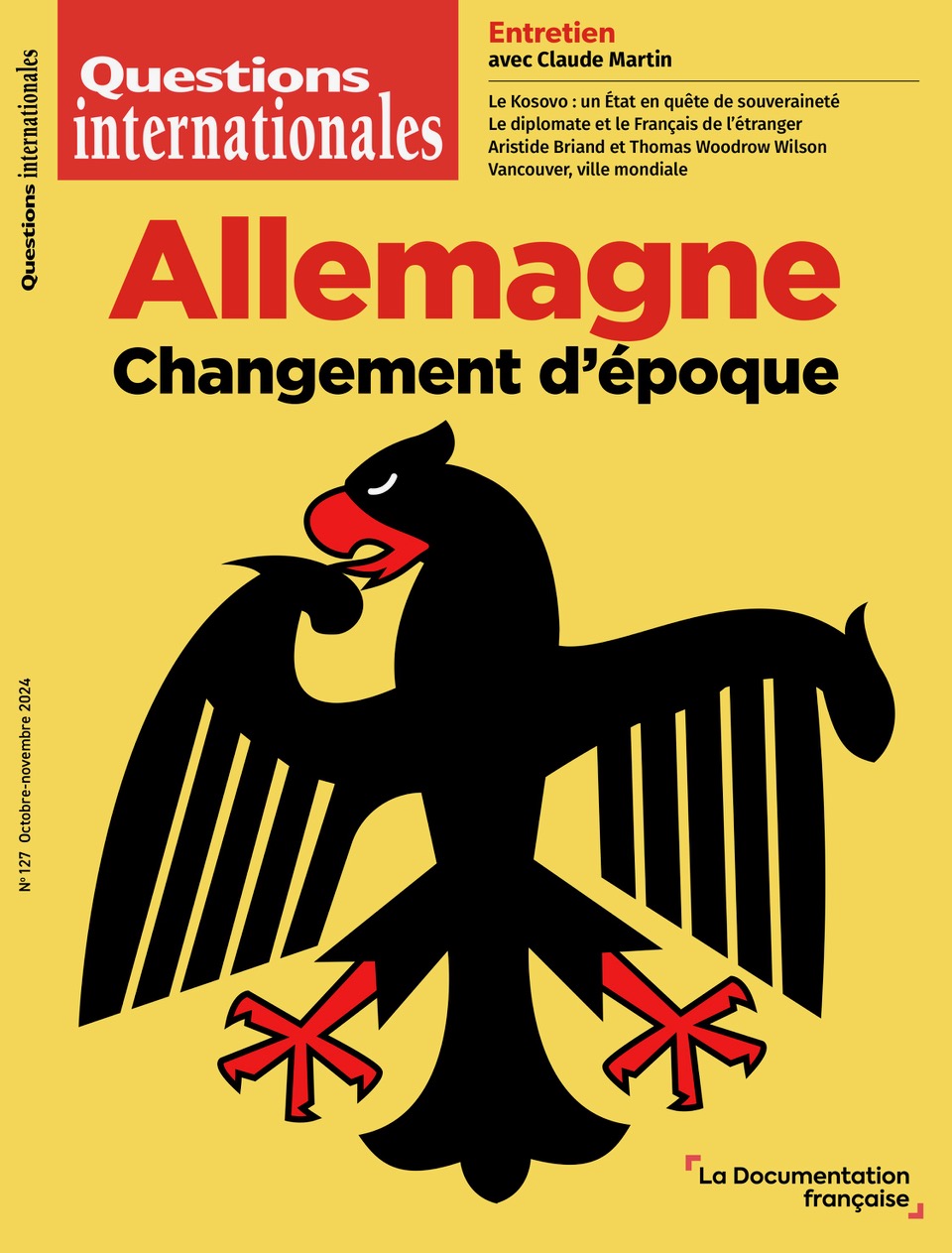 Parler de changement d’époque (Zeitenwende) est plus élégant que d’évoquer la fin/crise du modèle allemand, ou de l’homme malade de l’Europe. Où va l’Allemagne, c’est à cette question que répond le dernier numéro de Questions internationales n° 127. En tout cas avec une possible contraction du PIB de 0,1 % en 2024 alors que la croissance russe s’établit à 3,8 %, il y a préoccupation. Jusqu’en 2022, l’économie allemande dont les exportations de biens et de services représentaient 50,9 % du PIB, devenu le troisième du monde, devant le Japon reposait sur le gaz russe à bon marché (45 % de ses importations), du marché automobile chinois où se dirigeait le tiers de ses exportations de voitures haut de gamme et de la protection militaire américaine, Berlin ne consacrant que 1,2 % de son PIB à la défense. En quelques mois le gouvernement fédéral tripartite qui ne bénéficie actuellement que de 35 % des suffrages alors que Die Linke, l’AfD et la BSW (Alliance Sarah Wagenknecht) recueillent l’approbation de 25 % à 30 % des suffrages, a dû opérer des changements drastiques. En premier lieu, porter son budget de la défense au standard de l’Otan de 2 %, ce qui ne se traduit pas par une augmentation des dépenses de 30 Mds €. Pour ce faire, il s’est doté en juin 2023 d’une nouvelle Stratégie de défense nationale, puis en juillet de la même année d’une sur la Chine. Toutefois, on l’a vu encore récemment avec la taxation des voitures électriques chinoises, les milieux d’affaires d’outre-Rhin sont très réticents à couper les ponts avec la Chine. Ce qui se comprend au vu des échanges bilatéraux entre les deux pays : 254 Mds € fin 2023 (importations : 157 Mds ; exportations : 97 Mds) faisant de la Chine le premier partenaire commercial jusqu’à ce que les États-Unis lui ravissent cette place, montants bien supérieurs aux échanges bilatéraux germano-russes passés de 26,6 Mds € en 2022 à 12 Mds en 2023, la Russie n’étant que le 42e partenaire commercial ! L’Allemagne sera-t-elle donc l’armée la mieux équipée d’Europe comme elle prétendait le devenir au printemps 2022 ? Le ministre de la Défense estime qu’en cas de guerre, l’Allemagne doit aligner 480 000 soldats, et en période de paix, si elle veut maintenir le ratio de 10 % des forces de l’Otan, elle aurait besoin de 272 000 soldats. À ce jour, compte tenu de l’évolution démographique (taux de fécondité de 1,46 en 2024), on est loin du compte. Pour le moment, elle prévoit de constituer en 2025 une division blindée composée de deux brigades, suivie d’une troisième à l’horizon 2027 puis d’une seconde division mécanisée avant 2031. En outre, la mise à disposition de la « division 2025 » permettra également de mesurer l’aptitude de l’Allemagne à jouer son rôle de pays cadre.
Parler de changement d’époque (Zeitenwende) est plus élégant que d’évoquer la fin/crise du modèle allemand, ou de l’homme malade de l’Europe. Où va l’Allemagne, c’est à cette question que répond le dernier numéro de Questions internationales n° 127. En tout cas avec une possible contraction du PIB de 0,1 % en 2024 alors que la croissance russe s’établit à 3,8 %, il y a préoccupation. Jusqu’en 2022, l’économie allemande dont les exportations de biens et de services représentaient 50,9 % du PIB, devenu le troisième du monde, devant le Japon reposait sur le gaz russe à bon marché (45 % de ses importations), du marché automobile chinois où se dirigeait le tiers de ses exportations de voitures haut de gamme et de la protection militaire américaine, Berlin ne consacrant que 1,2 % de son PIB à la défense. En quelques mois le gouvernement fédéral tripartite qui ne bénéficie actuellement que de 35 % des suffrages alors que Die Linke, l’AfD et la BSW (Alliance Sarah Wagenknecht) recueillent l’approbation de 25 % à 30 % des suffrages, a dû opérer des changements drastiques. En premier lieu, porter son budget de la défense au standard de l’Otan de 2 %, ce qui ne se traduit pas par une augmentation des dépenses de 30 Mds €. Pour ce faire, il s’est doté en juin 2023 d’une nouvelle Stratégie de défense nationale, puis en juillet de la même année d’une sur la Chine. Toutefois, on l’a vu encore récemment avec la taxation des voitures électriques chinoises, les milieux d’affaires d’outre-Rhin sont très réticents à couper les ponts avec la Chine. Ce qui se comprend au vu des échanges bilatéraux entre les deux pays : 254 Mds € fin 2023 (importations : 157 Mds ; exportations : 97 Mds) faisant de la Chine le premier partenaire commercial jusqu’à ce que les États-Unis lui ravissent cette place, montants bien supérieurs aux échanges bilatéraux germano-russes passés de 26,6 Mds € en 2022 à 12 Mds en 2023, la Russie n’étant que le 42e partenaire commercial ! L’Allemagne sera-t-elle donc l’armée la mieux équipée d’Europe comme elle prétendait le devenir au printemps 2022 ? Le ministre de la Défense estime qu’en cas de guerre, l’Allemagne doit aligner 480 000 soldats, et en période de paix, si elle veut maintenir le ratio de 10 % des forces de l’Otan, elle aurait besoin de 272 000 soldats. À ce jour, compte tenu de l’évolution démographique (taux de fécondité de 1,46 en 2024), on est loin du compte. Pour le moment, elle prévoit de constituer en 2025 une division blindée composée de deux brigades, suivie d’une troisième à l’horizon 2027 puis d’une seconde division mécanisée avant 2031. En outre, la mise à disposition de la « division 2025 » permettra également de mesurer l’aptitude de l’Allemagne à jouer son rôle de pays cadre.
On trouvera dans ce dossier « Allemagne » une série d’articles détaillés et illustrés portant sur le modèle économique (en question), le modèle social (en mutation), la vie politique (pleine d’incertitudes un an avant les élections au Bundestag d’octobre prochain). Trois entrées sont particulièrement captivantes, portant sur la politique étrangère, l’Allemagne en Europe et la guerre en Ukraine. Le Gouvernement allemand se retrouve en tenailles entre les attentes des milieux d’affaires et les exigences de ses alliés : il exprime une loyauté sans faille vis-à-vis des États-Unis, bien que cette alliance soit fragile. Alors que la jeune génération demeure, quant à elle, majoritairement favorable à l’intégration européenne, la classe politique continue à vouloir se garder d’être un « hegemon », elle reste de surcroît mal à l’aise avec le rôle de leader en Europe.
États-Unis : l’empire inquiète
C’est un solide dossier que livre Ramses 2025 sur les États-Unis, une puissance lourde, fragilisée et hystérisée. Certes, la vitalité économique de la première puissance économique mondiale ne se dément pas : une croissance de 2,5 % en 2023, de bas coûts de l’énergie, un chômage à 4 % et une inflation en baisse continue. Cependant, les États-Unis sont devenus plus réticents vis-à-vis des engagements extérieurs. Trois grands dossiers restent prioritaires. La Chine est probablement le seul dossier autour duquel un consensus bipartisan et interpartisan apparaît relativement large. Si le soutien à l’Ukraine reste solide, qu’en sera-t-il en 2025 ? Quant à Israël, de premiers signes de changement apparaissent.
Dans ces conditions, la puissance militaire américaine, impressionnant à tous les titres, est en redéploiement. Il s’agit pour le Pentagone de défendre et protéger le territoire américain, de dissuader toute attaque stratégique et de se mettre en position de remporter toute « agression » ce qui nécessite la modernisation des forces armées dans tous les domaines (terre, mer, air, cyberespace, champ informationnel). Avec un budget de 850 Mds de dollars par an en 2025, les armées américaines restent les mieux pourvues du monde. De plus, les États-Unis disposent d’un large Soft Power et d’un lawfare, imposition juridique comme instrument de leur puissance. Notons que la carte de l’Atlas des crises et des conflits offre une vision synthétique des alliés, de la superpuissance stratégique (Chine) du rival stratégique historique, relation à leur plus bas niveau (Russie), des pays hostiles, de ceux subissant des sanctions économiques et financières, de ceux bénéficiant du soutien militaire et financier, et de l’Otan renforcée.
Énergies, climat, technologies
Si on rassemble ces thèmes largement abordés dans les divers annuaires c’est bien qu’il existe un lien de plus en plus étroit entre eux. L’Année stratégique 2025 décrit les profondes transformations des marchés énergétiques. Il ne s’agit pas seulement des fluctuations des prix du brut qui oscillent dans la bande des 75-90 dollars le baril, en fonction de l’état des stocks et des perspectives économiques de la Chine, ni de la réorganisation des flux gaziers russes, en direction de l’Inde et de la Chine. Il s’agit aussi de la transition énergétique ou la décarbonation des économies qui requiert l’emploi de matériaux rares, critiques ou stratégiques, lesquels sont indispensables aux diverses technologies civiles ou militaires. Si le fait que la Chine contrôle 60 % des chaînes de valeur des énergies vertes (panneaux solaires, batteries et voitures électriques) est bien connu, en revanche l’est beaucoup moins le fait que l’Arabie saoudite qui recèle un trésor minier dans son sous-sol évalué à 2 500 milliards de $ (cuivre, lithium, manganèse, nickel, terres rares) entend, avec l’aide de la Chine, devenir un futur leader régional sur les marchés des métaux.
De son côté, L’Année stratégique 2025 met l’accent sur un aspect relativement nouveau, celui de la perception des changements climatiques comme facteur d’insécurité humaine, laquelle est de plus en plus discernée comme une sécurité nationale. Cette montée en puissance du prisme, national de la sécurité nationale au détriment de la sécurité humaine, se rapporte donc à leur appréhension en tant qu’enjeu de sécurité nationale.
L’économie mondiale en 2025
Malgré tous les chocs qu’elle a subis depuis 2019 – en fait depuis la crise des subprimes de 2007-2008 et la crise de l’euro de 2010 –, l’économie mondiale continue de résister. Pourtant, les inégalités vont croissant à l’intérieur des États ainsi qu’entre les pays développés et les 58 pays les plus pauvres, regroupant 1,4 Md d’habitants dont la croissance moyenne s’est établie à 1,4 %. Or, misère, inégalités, absence d’infrastructures, faible niveau d’éducation et déficiences des systèmes sanitaires nourrissent conflits, flux migratoires, trafics et économies souterraines.
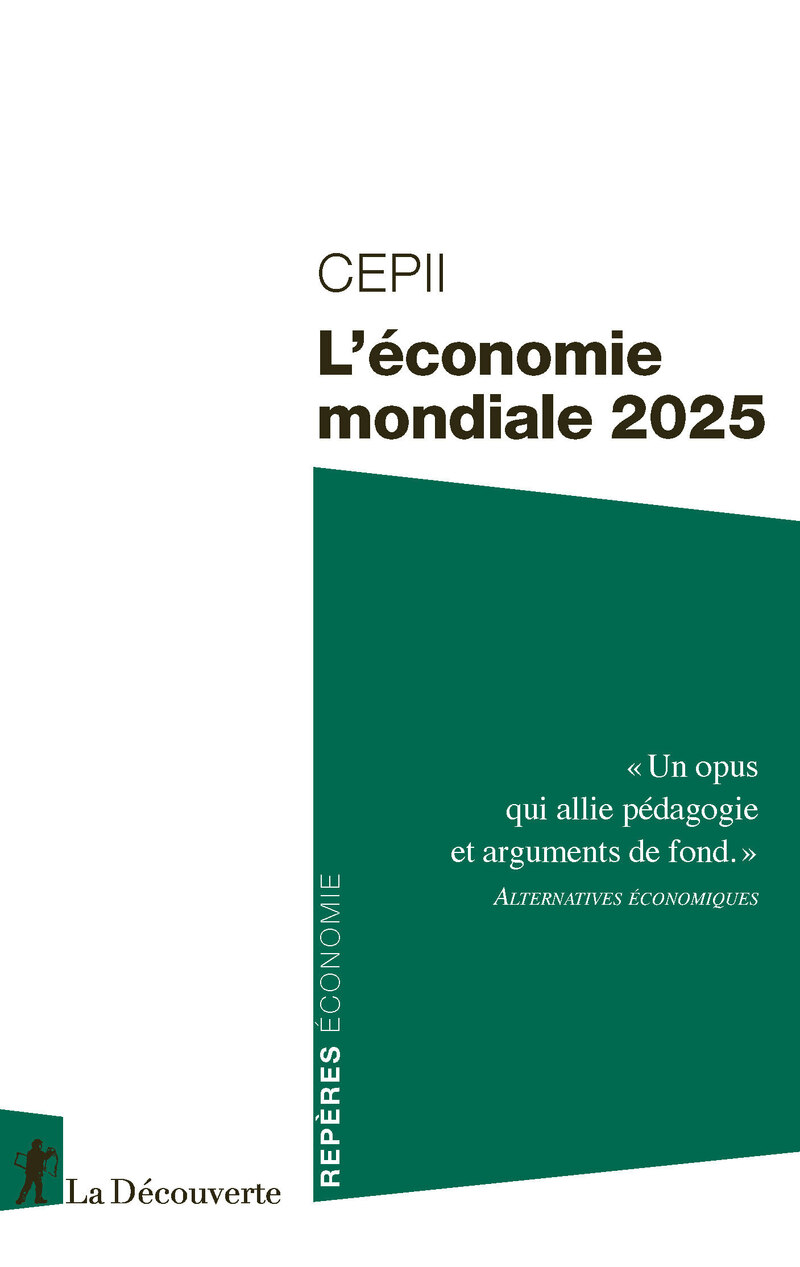 L’étude annuelle du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), L’économie mondiale 2025, offre un panorama solide pour appréhender l’ensemble de ces questions qu’elles relèvent des politiques industrielles, de la compétition technologique, de la recherche des métaux critiques ou de la politique commerciale ou monétaire. Car ne nous y trompons pas, la communauté internationale fait face à des exigences croissantes et il lui faudra trouver de 4 à 6 % du PIB mondial pour financer à la fois son réarmement (+1 %), son innovation scientifique et industrielle (+1 %), sa transition énergétique (2 à 2,5 %), sans parler du maintien de l’aide au développement dont les montants ont drastiquement chuté. D’où le sursaut européen indique Ramses 2025 que constitue l’Africa-EU Green Energy Initiative promettant de mobiliser 150 Mds d’euros afin de déployer 300 GW d’énergies renouvelables d’ici 2030.
L’étude annuelle du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), L’économie mondiale 2025, offre un panorama solide pour appréhender l’ensemble de ces questions qu’elles relèvent des politiques industrielles, de la compétition technologique, de la recherche des métaux critiques ou de la politique commerciale ou monétaire. Car ne nous y trompons pas, la communauté internationale fait face à des exigences croissantes et il lui faudra trouver de 4 à 6 % du PIB mondial pour financer à la fois son réarmement (+1 %), son innovation scientifique et industrielle (+1 %), sa transition énergétique (2 à 2,5 %), sans parler du maintien de l’aide au développement dont les montants ont drastiquement chuté. D’où le sursaut européen indique Ramses 2025 que constitue l’Africa-EU Green Energy Initiative promettant de mobiliser 150 Mds d’euros afin de déployer 300 GW d’énergies renouvelables d’ici 2030.
Changement climatique
Tous les annuaires et atlas analysés consacrent des entrées plus ou moins développées au changement climatique. Ramses 2025 s’interroge sur les Conferences of Parties (COP) qui, malheureusement en dépit de leur caractère indispensable, ont formé une technocratie internationale avec son propre langage, ses règles et outils hermétiques aux béotiens, comme les intitulés des groupes de travail, termes techniques ou acronymes. Cette technicité est problématique, car elle exclut les pays les plus pauvres, disposant de peu de ressources humaines et donc de temps à dédier à ces questions. D’ailleurs, un certain nombre d’entre eux ont déclaré qu’ils ne participeront pas à la COP29 de Bakou. Le fait que celle-ci se tienne dans un pays exportateur de gaz, peu allant en termes de lutte contre le dérangement climatique, accroît d’autant plus le malaise que son comité d’organisation de 28 membres ne comptait aucune femme, suscitant un tollé, obligeant Bakou à élargir de douze femmes et deux hommes. L’Année stratégique 2025 comporte un intéressant article intitulé « La sécurisation des changements climatiques et le retour de la puissance ». Jusqu’à présent, on parlait surtout d’insécurité humaine, ce qui structurait les programmes d’atténuation des risques climatiques des dernières décennies. On évoque désormais de plus en plus l’insécurité nationale et les discours associant climat et sécurité se sont amplifiés, ce qui en fait un enjeu de défense, de sécurité nationale. Le fait que l’Otan se soit dotée d’un plan d’action sur les changements climatiques et la sécurité en 2021, et a ouvert un centre d’excellence sur ces sujets en 2024, est caractéristique. Ceci pourrait également alimenter le narratif de certains leaders, arguant de la crise et de l’urgence, nécessitant des mesures rapides et exceptionnelles pour mobiliser la population autour d’une nation menacée par les changements climatiques. Si toutes les catastrophes naturelles ne sont pas dues au changement climatique, celui-ci les amplifie et les accélère. Selon l’indice mondial du risque, indique le Grand Atlas 2025, 96 % des victimes des catastrophes naturelles dans le monde ont lieu dans les pays en développement.
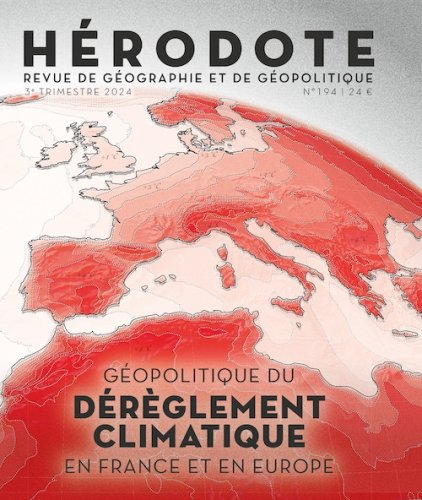 Hérodote consacre son n° 194 à la « Géopolitique du dérèglement climatique en France et en Europe », le suivant étant consacré à « Géopolitique et dérèglement climatique dans le reste du monde ». L’armée espagnole a été engagée à la rescousse face au chaos créé par les inondations sans précédent intervenues dans la région de Valence. C’est dire que ces catastrophes naturelles, courantes dans les pays du Sud, sont appelées à se multiplier dans les pays industrialisés du Nord. Le nombre de personnes exposées aux vagues de chaleur dans l’UE et au Royaume-Uni passerait de 10 à 300 millions – 50 % de la population. Les dérèglements climatiques posent déjà des problèmes importants de gestion de l’eau, de modification des cultures, d’accroissement des catastrophes naturelles.
Hérodote consacre son n° 194 à la « Géopolitique du dérèglement climatique en France et en Europe », le suivant étant consacré à « Géopolitique et dérèglement climatique dans le reste du monde ». L’armée espagnole a été engagée à la rescousse face au chaos créé par les inondations sans précédent intervenues dans la région de Valence. C’est dire que ces catastrophes naturelles, courantes dans les pays du Sud, sont appelées à se multiplier dans les pays industrialisés du Nord. Le nombre de personnes exposées aux vagues de chaleur dans l’UE et au Royaume-Uni passerait de 10 à 300 millions – 50 % de la population. Les dérèglements climatiques posent déjà des problèmes importants de gestion de l’eau, de modification des cultures, d’accroissement des catastrophes naturelles.
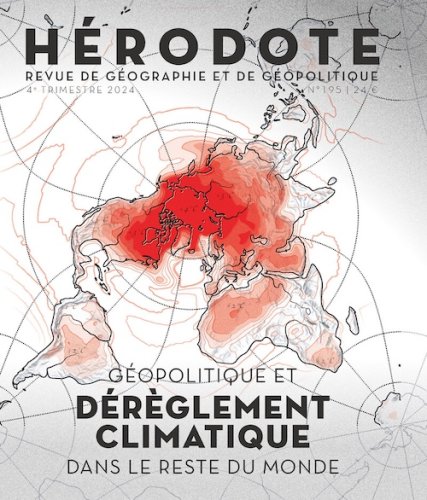 Le paradoxe, comme le souligne Béatrice Giblin dans son éditorial, tient qu’en dépit de cette multiplication des aléas climatiques, les partis écologiques ont subi un net revers lors des élections européennes de juin 2024. De ce fait, et en raison des « révoltes paysannes », c’est tout le contenu du Pacte vert de l’UE qui se trouve partiellement remis en cause. Celui-ci était certes ambitieux, et quelque peu déconnecté des dures réalités de la compétition économique internationale, mais il servait de guide et de référence. Faire de l’Europe le premier continent au monde à atteindre la neutralité carbone en 2050 et de réduire de 55 % les émissions de Gaz à effet de serre (GES) dès 2030 par rapport à 1990, comme de bannir le moteur thermique en 2035 n’avait rien d’évident. Atteindre ces objectifs nécessite de mobiliser 1 000 milliards d’euros d’ici 2030. D’où l’impératif pour l’UE de définir les conditions d’une transition juste pour maintenir une ambition climatique, et de faire face à la concurrence de la Chine et des États-Unis. Selon diverses évaluations, le coût de l’adaptation climatique se situe entre 0,2 % et 3,5 % du PIB de l’UE. Si on y ajoute la nécessité d’accroître nos dépenses de défense d’un point de PIB, et en faire de même pour les dépenses de Recherche et de développement (R&D), c’est formuler l’immense défi qui se pose à la France, comme à la plupart des pays européens. En France, la nécessaire refonte du réseau électrique construit dans les années 1950-1970 exigera un investissement de 100 Mds € sur quinze ans. C’est dire la richesse de ce numéro d’Hérodote qui fournit une réflexion approfondie sur bien des sujets, allant du nouveau programme nucléaire français, de l’érosion côtière, aux effets de l’élévation du niveau de la mer en Europe. « Limites et risques économiques et environnementaux de l’Energiewende en Allemagne » (Michel Deshaies, p. 161-180). « L’Écosse : du nationalisme pétrolier au nationalisme éolien ? » (Mark Bailoni, p. 199-216). Grâce à son potentiel éolien, elle peut afficher un bilan très vertueux, puisqu’en 2022, 71 % de son électricité est produite par du renouvelable contre 37 % en Grande-Bretagne. L’objectif est d’atteindre 100 % en 2045, pour atteindre le net zero.
Le paradoxe, comme le souligne Béatrice Giblin dans son éditorial, tient qu’en dépit de cette multiplication des aléas climatiques, les partis écologiques ont subi un net revers lors des élections européennes de juin 2024. De ce fait, et en raison des « révoltes paysannes », c’est tout le contenu du Pacte vert de l’UE qui se trouve partiellement remis en cause. Celui-ci était certes ambitieux, et quelque peu déconnecté des dures réalités de la compétition économique internationale, mais il servait de guide et de référence. Faire de l’Europe le premier continent au monde à atteindre la neutralité carbone en 2050 et de réduire de 55 % les émissions de Gaz à effet de serre (GES) dès 2030 par rapport à 1990, comme de bannir le moteur thermique en 2035 n’avait rien d’évident. Atteindre ces objectifs nécessite de mobiliser 1 000 milliards d’euros d’ici 2030. D’où l’impératif pour l’UE de définir les conditions d’une transition juste pour maintenir une ambition climatique, et de faire face à la concurrence de la Chine et des États-Unis. Selon diverses évaluations, le coût de l’adaptation climatique se situe entre 0,2 % et 3,5 % du PIB de l’UE. Si on y ajoute la nécessité d’accroître nos dépenses de défense d’un point de PIB, et en faire de même pour les dépenses de Recherche et de développement (R&D), c’est formuler l’immense défi qui se pose à la France, comme à la plupart des pays européens. En France, la nécessaire refonte du réseau électrique construit dans les années 1950-1970 exigera un investissement de 100 Mds € sur quinze ans. C’est dire la richesse de ce numéro d’Hérodote qui fournit une réflexion approfondie sur bien des sujets, allant du nouveau programme nucléaire français, de l’érosion côtière, aux effets de l’élévation du niveau de la mer en Europe. « Limites et risques économiques et environnementaux de l’Energiewende en Allemagne » (Michel Deshaies, p. 161-180). « L’Écosse : du nationalisme pétrolier au nationalisme éolien ? » (Mark Bailoni, p. 199-216). Grâce à son potentiel éolien, elle peut afficher un bilan très vertueux, puisqu’en 2022, 71 % de son électricité est produite par du renouvelable contre 37 % en Grande-Bretagne. L’objectif est d’atteindre 100 % en 2045, pour atteindre le net zero.
Crise écologique, tensions géopolitiques, surcapacité industrielle chinoise qui représente 30 % de l’industrie mondiale conduisent à un protectionnisme accru, au délitement du multilatéralisme, à la réorganisation des chaînes de valeur. Ce qui est préoccupant est le décrochage de l’Europe dont la croissance cumulée de la zone euro de 2019 à la fin de 2013 a été de 3 % contre 8 % pour les États-Unis. En matière d’Intelligence artificielle (IA), l’écart entre les deux rives de l’Atlantique a doublé. Ramses 2025 consacre deux entrées à l’IA, véritable onde de choc géopolitique qui bouleverse les règles du jeu planétaire, ce qui requiert urgemment une régulation internationale. L’IA dont la contribution pour l’économie mondiale s’élèverait, indique Ramses 2025, à 15 700 milliards $ d’ici 2030 est bien au centre du jeu tant il bouleverse les règles du jeu international. Entre une régulation internationale de plus en plus nécessaire et la fragmentation digitale qui risque d’accroître les inégalités, la voie est étroite.
Aussi est-on passé à une époque où au règne sans partage du marché a succédé sous toutes les latitudes, le souci de la sécurité économique, qui demande une plus grande intervention des États et une plus vaste coordination internationale.
Conclusion
En cette période de transition, tout semble en question ou en recomposition comme le sont l’Union européenne, le Moyen-Orient ou la Bande soudano-sahélienne. Les malentendus transatlantiques (titre d’un ouvrage d’Henry Kissinger paru en France en 1965), et les rapports Nord-Sud, remontent aux années 1970, avec la revendication d’un Nouvel ordre mondial. Aussi, sommes-nous toujours en dehors du supposé affrontement entre l’« Occident global » et le « Sud collectif » à la recherche de nouveaux concepts. Afin de tenter de dépasser la division trop simpliste de Nord et de Sud ou d’« Occident collectif » et de « Sud global », les auteurs du Grand Atlas présentent en fin de volume dans leur entrée « Nord-Sud : dépasser les limites du monde », une carte du monde divisée en six catégories. En bas, les très précaires, 27 pays dans lesquels ils placent l’Angola, le Cameroun et la Côte d’Ivoire, ce qui ne laisse pas d’interroger. Puis les précaires très inégalitaires, soit tous les pays d’Afrique australe, Afrique du Sud comprise. Ensuite, les 18 émergents en essor, parmi lesquels l’Inde, après les 54 émergents consolidés, soit toute l’Amérique latine, le Maghreb, le Moyen-Orient, ainsi que la Russie, la Chine, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la Turquie, l’Iran et seul pays d’Asie centrale, le Kazakhstan qui vient d’opter pour le nucléaire (civil). En haut, les 25 favorisés avec fragilités, parmi lesquels l’Italie, le Portugal et l’Espagne, et la Corée du Sud. Enfin, au sommet, les 20 très favorisés, où se trouve la France. Observons que les deux dernières catégories correspondent à peu de chose près à la carte exposant la réaction des pays à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Ces classifications sont utiles pour situer la position des États, mais on en perçoit les limites. Est modus in rebus. Il est en toutes choses un milieu.
Décembre 2024-janvier 2025
(1) Avec l’accord du 1er janvier 2024, l’Éthiopie reconnaît désormais le Somaliland et obtient un bail de 50 ans sur le port de Berbera ainsi que l’installation d’une base militaire au Somaliland.
(2) Depuis le 1er janvier 2024, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les EAU ont rejoints les BRICS historiques : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.
(3) NDLR : le numéro de mai 2025 de la RDN sera consacré aux enjeux maritimes.

.jpg)





