Sigem 2025 - L’officier au service de la Nation dans le monde du XXIe siècle
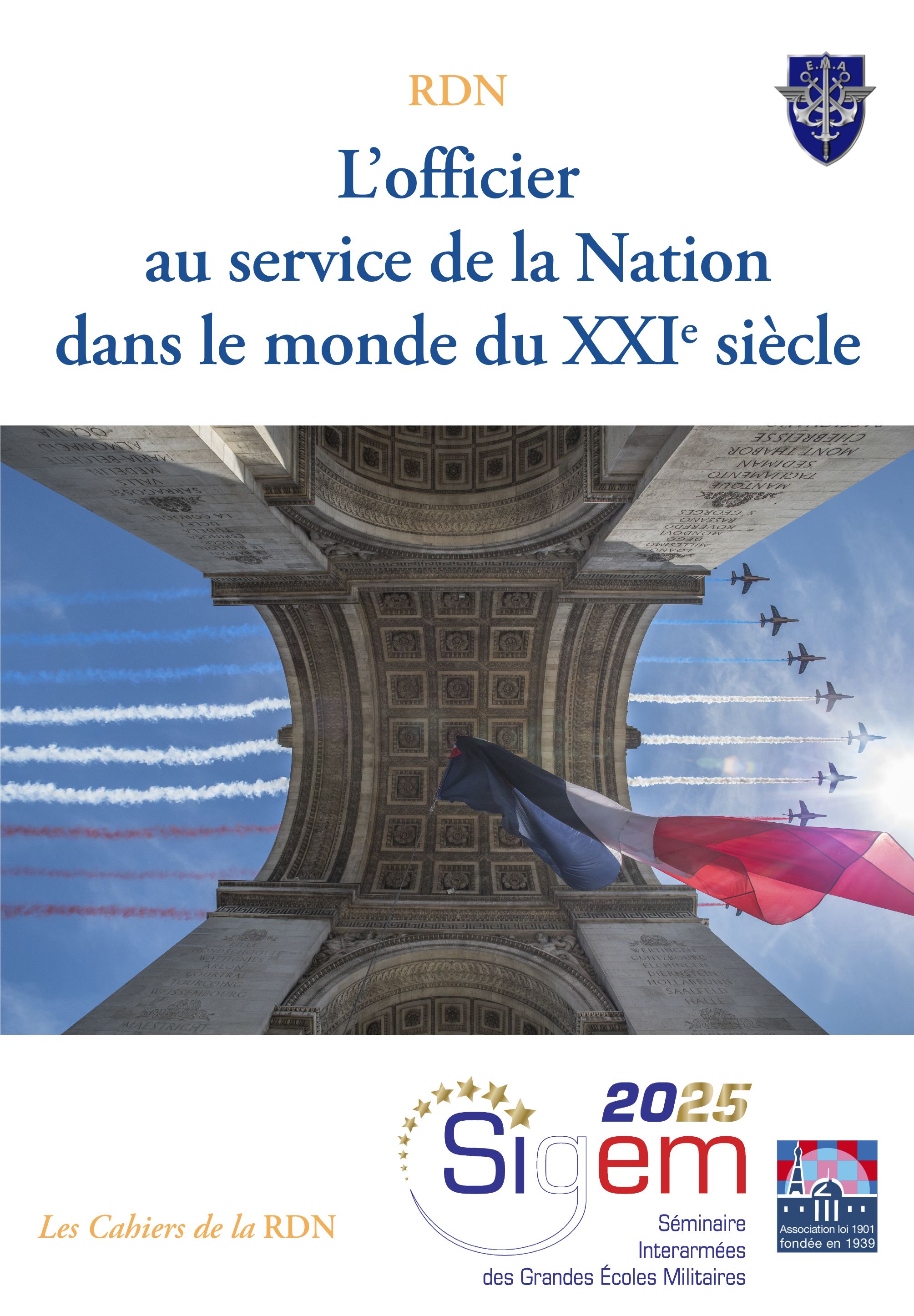
Depuis 2001, le Séminaire interarmées des grandes écoles militaires (Sigem) rassemble chaque année les élèves des grandes écoles militaires auxquels se joignent quelques étudiants de grandes écoles civiles.
Le thème du Sigem 2025, tenant lieu de fil conducteur aux différentes interventions et activités organisées, s’articule autour de l’idée suivante : choisir de servir la Nation repose plus que jamais sur l’adhésion à des valeurs fondamentales qui conservent leur acuité dans un monde devenu fort complexe, ce qui doit conduire chacun à s’interroger pour donner du sens à son action.
Le jeune officier, comme tout être humain, a besoin de repères de temps et de perspective pour mieux se situer dans le présent afin de se projeter dans l’avenir. Il lui est pour cela nécessaire de s’appuyer sur un héritage, un corpus de valeurs et de connaissances solides.
Confronté à la complexité du monde de ce début de XXIe siècle, l’officier, militaire professionnel et citoyen, doit disposer d’une sérieuse culture générale. Elle seule peut lui assurer les clés de compréhension historique, sociale, géographique, économique, technologique, du choix ou du comportement de l’autre, qu’il soit ennemi ou ami.
Mais cela ne suffit pas à faire de l’officier un chef. Au moment de la décision, ce dernier est seul face à lui-même. Il lui est donc nécessaire d’avoir un esprit ouvert et curieux, apte à l’intelligence de situation et au discernement, c’est-à-dire en capacité de réfléchir sur une philosophie de l’action.
Cahier numérique - Février 2025 - 116 pages
Feuilleter ce Cahier
Introduction - Yann Marbœuf - p. 5-7
Mondialisation et besoin de proximité, réseaux sociaux et solitude, société de consommation et quête de sens… Dans un monde qui a plus changé au cours des cent dernières années que pendant le dernier millénaire, quelles sont les raisons qui vous ont conduits à vous engager ? La défense de la Nation, de sa population et de son territoire constituait hier la principale motivation de vos aînés. Il y a encore quelques années, certains pouvaient la considérer désuète. Les attentats de 2015 et plus récemment l’invasion de l’Ukraine par la Russie sont malheureusement venus nous rappeler que la sécurité et la paix ne sont pas éternellement acquises. Lire la suite
Éditorial - Audrey Hérisson - p. 8-10
Depuis 2013, les Cahiers Sigem offrent l’opportunité, pour vous, jeunes officiers amenés à servir la Nation, de réfléchir, individuellement et collectivement, à la fois sur votre engagement en tant que futur chef, et sur l’état du monde dans lequel vous allez être amenés à exercer votre vocation militaire. Une sélection d’articles vous propose de vous aider à mieux vous connaître et à mieux connaître votre environnement, afin de pouvoir être prêts à accomplir les missions exigeantes qui vous seront confiées. Lire la suite
S’engager au service de la Nation
Le statut de militaire est spécifique et ne peut être comparé ou assimilé à un simple contrat de droit civil. La mission exorbitante demandée au militaire à travers l’usage des armes exige un respect de sa spécificité. L’exemple de l’équipage d’un navire de guerre illustre cette exigence, seule garante du succès en opération.
L’engagement (RDN n° 829 - avril 2020) - Richard Lizurey - p. 19-24
L’engagement, c’est la volonté de servir et participer collectivement à une mission. L’engagement militaire en est une forme particulière de dévouement vis-à-vis de la nation. Celle-ci doit alors le reconnaître et le valoriser. Cela exige également de donner du sens à la mission ; c’est alors la responsabilité du chef.
La guerre transforme le combattant et ceux qui y sont confrontés plus ou moins directement. L’impact psychologique est loin d’être négligeable et s’inscrit dans la durée avec des réactions individuelles contrastées. Aujourd’hui encore, les combats de nos soldats peuvent provoquer des troubles comme l’ennui après…
Être un chef au XXIe siècle
La notion de force est centrale et oblige à s’interroger sur son rôle, notamment dans sa mise en œuvre par le soldat. La légitimité de son usage repose donc sur plusieurs principes dont la relation au bien et à la violence. Dès lors, le rôle de l’État est primordial pour définir l’emploi de la force et le justifier auprès de ses citoyens.
Le chaos de la guerre est devenu réalité depuis février 2022. Il nous faut passer du tempo des crises à la capacité de répondre aux chaos frontaux. Cela nous oblige à raisonner différemment en s’inscrivant dans le temps long et en prenant en compte la complexité désormais normale. Il nous faut repenser la guerre, c’est la responsabilité de l’État-major des Armées.
Déceler et former un successeur, disposer aux différents échelons de commandement d’hommes capables de prendre avec lucidité et courage leurs responsabilités, c’est là peut-être le problème le plus important qui se pose aux chefs d’entreprise. Sans doute ne se pose-t-il pas à l’Armée avec moins d’acuité ni dans des termes bien différents ; les qualités qui font un chef ne sont-elles pas partout les mêmes ?
Le leadership s’apprend et se perfectionne tout au long de la carrière. Alors que les armées sont engagées dans des réformes profondes et durables, nous pouvons avoir une approche construite et scientifique dans les cursus de formation professionnelle des officiers pour rendre ces derniers capables d’analyser et de conduire le changement. Le système académique américain offre à cet égard un point de vue intéressant.
Un monde en guerre : le Moyen-Orient plus instable que jamais
L’attaque terroriste du 7 octobre 2023 a relancé dramatiquement le conflit israélo-palestinien. Aucune des deux parties ne semble vouloir trouver une solution pérenne, au grand désespoir de ceux qui veulent construire un ordre raisonnable. Or, il est urgent de trouver un plan pour l’après si l’on veut sortir de ce cycle infernal. Peut-être que de cette violence aveugle sortira un espoir de solution ?
La guerre imposée par le Hamas le 7 octobre 2023 à Israël a enclenché une spirale infernale avec une montée aux extrêmes, remettant brutalement en cause les acquis du droit des conflits armés. À cela s’ajoutent des dimensions millénaristes, antagonistes, éloignant un peu plus une perspective de dialogue. Le temps est encore à la guerre, encore loin de l’après.
La république islamique d’Iran voue une haine féroce à l’égard d’Israël et active de nombreux acteurs pour contester à Israël son droit à exister. L’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas en est une illustration. L’accroissement de la relation entre Téhéran et Moscou complexifie encore le contexte, tandis que les États du Golfe recherchent avant tout une certaine stabilité indispensable à l’économie.
Téhéran s’est imposé depuis 1979 comme un acteur régional majeur s’appuyant sur l’islamisme et son nationalisme perse. Son anti-occidentalisme brutal et revendiqué entre pourtant en contradiction avec les aspirations sociétales d’une société civile plus ouverte au monde, obligeant les Ayatollahs à un certain pragmatisme.
De l’Arme atomique à la dissuasion nucléaire
Charles Ailleret, un des penseurs français de la stratégie de dissuasion, réfléchissait en 1955 sur le rôle de l’arme atomique. Celle-ci, par son caractère destructeur, incite à réfléchir quant à son emploi potentiel. Et de fait, la bombe atomique oblige à éviter la guerre. C’est le principe de dissuasion
À la suite de la cessation des essais français, de la signature par notre pays d’un certain nombre de traités, de la loi de programmation militaire votée à l’été 1996, l’auteur a voulu nous donner son sentiment sur l’avenir de notre politique et de notre système de dissuasion, tel qu’il le perçoit actuellement.
Le général de Gaulle a permis à la France de se doter d’une capacité nucléaire devenue opérationnelle à partir de 1964. Au-delà des grands équipements nécessaires comme les SNLE et les avions Mirage, il a réalisé la synthèse doctrinale indispensable pour rendre crédible notre dissuasion dès sa création et dont les principes restent essentiels aujourd’hui.
La dissuasion française nécessite un renouvellement de la réflexion doctrinale indispensable pour ne pas laisser en friche le débat avec le risque de fragiliser la crédibilité de notre stratégie par une indifférence érodante.






