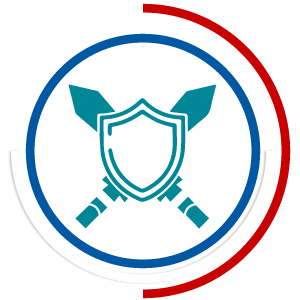La RDN perd, en la personne du Maréchal Juin, le président de son Comité de patronage. Le Maréchal avait accepté cette fonction en 1954. Ancien Chef d’état-major général de la défense nationale, il était utilement intéressé par la présentation et la diffusion des grands problèmes qui, à des titres divers, intéressent la défense et sollicitent de ce fait le concours de toutes les activités du pays. Nous avons demandé au général Pédron, qui appartint à l’État-major du Corps expéditionnaire français (CEF) en Italie avant de devenir chef d’état-major du Maréchal Juin, de rappeler quelques traits de sa personnalité et certains actes de sa longue carrière militaire.
Alphonse Juin, Maréchal de France
À 5 heures 45, le vendredi 27 janvier 1967, Alphonse Juin, Maréchal de France, s’est éteint doucement au Val-de-Grâce où il avait été transporté la veille. Ainsi vient de disparaître un grand soldat dont la mort semble clore un demi-siècle de notre histoire militaire nationale.
Toutes les actions qui ont marqué la vie d’Alphonse Juin pendant cinquante ans s’inscrivent dans la trame historique de nos peines et de nos gloires, de la peine et de la gloire de ces hommes qui, animés comme lui par l’ardent amour de la patrie, luttèrent à ses côtés ou sous ses ordres, souvent jusqu’à en mourir, pour que la France vive.
Tous ces hommes, le Maréchal Juin les avait compris, aimés et les gardait présents dans son souvenir. Vivants, il les reconnaissait au cours de ses pérégrinations à travers la France et son Empire, leur rappelant d’un mot souvent amusant, l’action qui les avaient liés autrefois, à moins que ce ne fût le camarade ou le subordonné qui se fît reconnaître, tel ce vieux Marocain qui se plantant au garde-à-vous devant lui, à son arrivée à Casablanca en 1947 lui dit : « Tu te souviens, j’étais blessé et tu m’as porté sous les balles ».
Jeune officier, il avait connu très tôt dans le rang, les fatigues et les peines du soldat. Sorti de Saint-Cyr en 1912, il avait fait ses premières armes au Maroc, participé en 1914 à la prise de Taza ; puis il fut jeté avec sa section de « chasseurs » marocains en plein dans la bataille de la Marne ; il avait reçu sa première blessure près de Penchard alors qu’à quelques centaines de mètres sur sa gauche tombait Péguy. Quelques mois plus tard, en mars 1915, il était blessé, une fois de plus, mais très grièvement cette fois, à Mesnil-les-Hurlus, ce qui lui valut huit mois d’hôpital et une longue convalescence pendant laquelle il servit au Maroc comme aide de camp du Maréchal Lyautey. Rentré en France il prit le commandement d’une compagnie au front et termina la guerre avec le grade de capitaine, la Légion d’Honneur et cinq citations. Ensuite, entre les deux guerres, ce fut sa formation de Chef : tantôt dans la troupe, tantôt dans l’état-major, à l’École de guerre comme stagiaire en 1919, comme professeur en 1934, aux côtés du Maréchal Lyautey, du Général Noguès, de M. Lucien Saint, Résident Général à Rabat, à travers les péripéties dramatiques de la pacification du Maroc et enfin, en 1935, comme Colonel, le plus beau grade de l’Armée française, à la tête du 3e Régiment de Zouaves à Constantine, la ville de sa jeunesse, de sa famille, de la famille de sa femme, la ville de ses souvenirs. Ce fut, avant la grande épreuve de 1939-1945 un véritable retour aux sources, sur cette terre algérienne qu’il évoquera plus tard avec tendresse et souvent une pointe d’humour en parlant de ses frasques de collégien, de ses vacances chez son grand-père gardien d’un phare bâti sur un îlot au large de Bône, de sa vie à la caserne de gendarmerie dont il croira reconnaître les bâtiments à travers les fenêtres du Val-de-Grâce, dans sa vision nostalgique de mourant.
Nommé Général de Brigade en 1938, il exerce les fonctions de Chef d’état-major du Général Noguès, Commandant en Chef du théâtre d’opérations d’Afrique du Nord, qui consent à le laisser partir lorsqu’il s’avère qu’il ne se passera rien de ce côté de la Méditerranée, pour prendre le commandement de la 15e Division d’Infanterie motorisée. Une division d’élite, avec laquelle le Général Juin bloque un moment l’avance des blindés allemands, les 14 et 15 mai 1940, à Gembloux mais qui devra mettre bas les armes, quelques jours plus tard, dans les faubourgs de Lille, après avoir brûlé ses dernières cartouches.
C’est la défaite. Prisonnier derrière les hauts murs de la forteresse de Königstein, le Général Juin ne s’attarde pas à méditer sur les causes de cette défaite, décelée bien avant 1939 quoiqu’on en ait dit et écrit : son esprit s’attache à la recherche des conditions de la « revanche ».
Celui qui, justement, a centré toute son activité en Afrique du Nord miraculeusement sauvée de l’invasion, le Général Weygand, a fait demander qu’on libère un certain nombre de généraux pour l’encadrement des Forces Françaises chargées de la défense de l’Afrique du Nord « contre quiconque » suivant un euphémisme dont la lourdeur germanique ne saisit pas le véritable sens. Placé en tête de liste, Juin est libéré. Quelques jours après, Hitler, pressentant la tromperie, réclame son retour. Mais en vain, car Juin a rejoint sans délai le poste de Commandant Supérieur des Troupes du Maroc où il vient d’être affecté et refuse de se laisser intimider.
À Rabat, il se retrouve dans son milieu d’élection, sur cette terre d’Afrique qui va être la base de départ de l’Armée de la Libération. Les événements se précipitent. Le Général Weygand, Délégué Général et Commandant en Chef en Afrique, considéré pour ses sentiments et son activité anti-allemande comme un « obstacle insurmontable » à la collaboration, est rappelé à Vichy et le Général Juin qui entre-temps a refusé la succession du Général Huntziger au Ministère de la Guerre, est nommé à Alger.
Lorsqu’il arrive au Palais d’Hiver, siège de l’État-Major du Commandement en chef, au début de décembre 1941, il définit devant ses futurs collaborateurs, presque incrédules devant tant de bonheur, la mission qu’il s’est donnée et qu’il leur confie. « Messieurs, dit-il, avec cette modestie qui est un trait permanent de son caractère, on ne remplace pas le Général Weygand, on lui succède ». Puis, après un temps, martelant ses mots : « La séance continue ». Phrase courte et significative qu’il reprend à la fin de son allocution. Cela signifie que rien ne sera changé, ni le but qu’avait défini Weygand : la revanche ; ni les moyens à mettre en œuvre pour en créer l’instrument, en dépit de tout et de tous. Et, en effet, la préparation clandestine d’un corps de bataille composé de trois divisions d’infanterie et de deux brigades blindées s’accélère tandis que l’on cache du matériel, des approvisionnements, des munitions et que l’on prépare en Tunisie des bases de ravitaillement pour la future campagne contre l’Axe, objet d’une instruction personnelle et secrète aux Commandements responsables. Soudain, c’est le déclenchement de l’opération « Torch », le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord. Tenu à l’écart de l’affaire même, par une décision de Roosevelt, alors que préparé à l’éventualité d’une sécession de l’Afrique du Nord, Juin est depuis le 13 octobre en étroite relation avec le Consul Général des États-Unis, M. Murphy, et attend de lui les précisions nécessaires sur les conditions de l’intervention alliée, ce dernier, par ordre, se tait.
Ce sont alors les malheureux combats des 8 et 9 novembre que le Général Juin s’efforce de faire cesser rapidement pour prendre en mains les négociations destinées à faire rentrer en guerre contre l’Axe, l’Armée d’Afrique, aux côtés des Forces alliées et engager le pays dans la grande voie de salut qui lui est enfin offerte. Pendant ces négociations il s’impose et il impose. Le 10 novembre matin, au cours de la conférence qui réunit à l’hôtel Saint-Georges l’Amiral Darlan, présent à Alger par hasard, le Général Clark, commandant les Forces américaines, et M. Murphy, il présente ses arguments tantôt en souplesse, tantôt avec véhémence et même brutalité ; et lorsque vers 11 heures il sort le premier, de son pas rapide, de la salle de conférences, il heurte légèrement du coude l’officier d’état-major qui l’attend, anxieux, dans le salon voisin, et il lui glisse à voix basse : « J’ai enlevé le morceau ». Derrière lui, à pas lents, sort à son tour l’Amiral Darlan, les yeux baissés, le visage congestionné, serrant dans sa mâchoire contractée, le tuyau de la pipe qu’il tient de la main droite. La bataille a été rude. Des mises au point seront encore nécessaires pour aplanir bien des divergences de conception, compte tenu des personnalités françaises en présence et de la nécessité d’amener toute la masse africaine à constituer un bloc sans faille dans la lutte qui va reprendre. Quoi qu’il se défende d’être un homme politique, le Général Juin s’y emploie avec le plus grand succès et finalement le résultat est définitivement acquis le 14 novembre. La France, par l’Afrique du Nord, rentre en guerre aux côtés des Alliés.
Mais un autre problème, uniquement militaire, se pose au même moment. Que cela puisse paraître aujourd’hui parfaitement invraisemblable, le plan anglo-américain ne visait pas au-delà d’Alger. Le Général Juin n’aura de cesse qu’il n’ait fait comprendre au Haut-Commandement allié, qu’il n’y a pas une minute à perdre et qu’il faut pousser au plus vite toutes les forces disponibles vers la Tunisie où s’amorce la réaction militaire de l’Axe, pour éviter de transformer l’Algérie en un effroyable champ de bataille. Il donne l’exemple ; il laisse au Général Giraud, débarqué d’avion le 9 novembre à Blida après une dramatique évasion de France — la deuxième après celle de Königstein — le Commandement en chef en liaison avec le Général Eisenhower et prend celui du Détachement d’Armée formé avec ce fameux Corps de bataille constitué dans la clandestinité, pour installer au plus vite une ligne d’arrêt en Tunisie.
Le 19 novembre 1942, les Français ouvrent le feu sur les Allemands à Medjez el Bab. Mais il faudra près de quatre mois pour que les Alliés amènent en Tunisie les forces terrestres et aériennes et les ravitaillements nécessaires pour prendre l’offensive contre Rommel qui a débouché de Libye, poursuivi par la 8e Armée de Montgomery. En attendant ce sont les 60 000 hommes de Juin, mal armés, mal vêtus, mal ravitaillés, ces « va-nu-pieds » de l’Armée d’Afrique qui vont contenir l’adversaire dans le champ clos tunisien. À maintes reprises la situation frise la catastrophe. Le 22 février 1948, le Général américain Freedendall lui fait part de sa décision de rompre le combat devant Rommel qui débouche en force de Kasserine sur Tebessa. « Ma femme et mes enfants sont à Constantine, lui oppose avec véhémence le Général Juin. Je vous signifie que si vous vous obstinez… je vous retire de mon propre chef la Division de Constantine pour défendre Tébessa et nous y faire tuer ». Pour Juin, la situation est alors d’une gravité exceptionnelle et mieux vaudrait pour lui et ses compagnons d’armes mourir les armes à la main que de subir la honte d’un abandon qui livrerait à l’ennemi cette terre algérienne si chère à son cœur, compromettrait la concentration des Forces alliées et probablement tous les espoirs mis dans une victoire en terre d’Afrique, prélude obligatoire à la libération de la Métropole. Freedendall, frappé par cette objurgation pathétique, va faire front et gagner cette bataille prématurément perdue dans son esprit. Le 8 mai suivant, les Forces de l’Axe, battues à plate couture, laissent 325 000 prisonniers et un matériel considérable entre les mains des Forces alliées. L’Afrique du Nord est libérée.
L’Armée d’Afrique, passée entre-temps sous le commandement du Général Kœltz, a pris une large part dans cette victoire et le Général Juin, installé provisoirement comme Résident Général à Tunis, dira avec émotion à un de ses collaborateurs des bons et des mauvais jours : « Je suis aujourd’hui infiniment heureux car j’ai conscience d’avoir libéré mon pays ».
C’est de ce pays que va partir l’Armée française de la Libération pour l’Italie, pour la France ; et c’est en Italie que le grand stratège qu’est le Général Juin va donner sa pleine mesure et rendre à la France, avec une armée reconstituée et victorieuse, sa place dans le concert des Nations alliées.
En décembre 1943, le Corps Expéditionnaire français, placé sous les ordres du Général Juin par décret signé du Général de Gaulle, commence à débarquer à Naples et à s’engager au fur et à mesure de ses débarquements dans le cadre de la 5e Armée américaine du Général Clark : deux Divisions, la 2e Division marocaine du Général Dody et la 3e Division algérienne du Général de Monsabert, les Tabors marocains du Général Guillaume, et des éléments de Corps d’Armée, artillerie, génie, etc… et des services. C’est immédiatement une grande surprise chez nos alliés ; la 2e D.I.M. s’empare, le 16 décembre, du Pantano devant lequel piétinait depuis un mois le 6e C.A. américain ; le 15 janvier, cinq jours avant la date prévue au plan, la 2e D.I.M. et la 3e D.I.M., découplées en direction générale du Rapido qui coule au pied du Mont Cassin, atteignent leurs objectifs après une série d’exploits extraordinaires ; le Général Clark, qui doute encore, se rend en première ligne le 16 et rentre convaincu que le C.E.F. de Juin est un instrument de guerre redoutable, devançant de quelques semaines dans cette opinion le Commandant en Chef d’en face le Maréchal Kesselring. La campagne d’hiver se développe alors, marquée par les attaques, très coûteuses mais sans succès sur Cassino, des Anglo-Saxons qui s’obstinent à vouloir s’en emparer de front, aidés par les Français qui se donnent à corps perdu dans de terribles combats pour aider leurs frères d’armes alliés : notamment au Belvédère, en février 1944, où ils enfoncent les lignes ennemies et débordent le massif de l’Abbaye par l’Est, sans possibilité, hélas ! d’exploitation de cette victoire.
C’est au cours de cet hiver effroyable où ils ont eu à supporter toutes les misères du froid, des pluies torrentielles, de la boue, de la neige, dans le chaos pierreux des contreforts des Abruzzes qui entoure Cassino, que la petite Armée française d’Italie s’est imposée par la maîtrise, l’endurance et l’héroïsme de ses combattants de tous rangs, la science et la valeur de ses chefs. Aussi est-ce au C.E.F., à son chef, le Général Juin, qu’est confiée la mission principale dans cette offensive de printemps qui débouchera le 11 mai 1944 et que le Haut-Commandement allié veut décisive. De ce Haut-Commandement le Général Juin fait maintenant indubitablement partie. Haute culture, profonde intuition alimentée par une réflexion constante, jugement précis et clair, faculté remarquable de synthèse, caractérisent le talent du stratège dont on sollicite maintenant les avis. C’est d’ailleurs le plan qu’il propose dans son « Mémoire en date du 4 avril 1944 sur les futures opérations du C.E.F. dans les monts Aurunciz » qui est adopté. « Il s’agira, écrit-il dans ce Mémoire, de foncer à toute vitesse dans la montagne, là où l’ennemi ne peut se tenir en force, pour atteindre au plus tôt les arrières de l’adversaire, couper les routes qui alimentent sa défense et ouvrir le chemin aux actions frontales ». Manœuvre napoléonienne fondée sur les jambes des tirailleurs français et les pattes de leurs mulets : trente mille hommes sous les ordres des Généraux Sevez et Guillaume feront irruption sur le plateau que domine le Petrella, à quinze cents mètres d’altitude.
Pour cette offensive, le C.E.F. a reçu en renfort la 4e Division marocaine de montagne du Général Sevez et la 1re Division Française Libre du Général Brosset ; ses effectifs atteignent près de 125 000 hommes.
Les 11 et 13 mai 1944, l’ennemi, surpris, est enfoncé, défait ; il bat en retraite, talonné par le C.E.F. qui entraîne le 2e C.A. américain à sa gauche et la 8e Armée britannique à sa droite, jusqu’à Rome où nos forces entrent le 5 juin 1944.
Le Général de Gaulle télégraphie au Général Juin : « L’Armée Française a sa large part dans la victoire de Rome. Il le fallait. Vous l’avez fait. Général Juin, vous-même et les troupes sous vos ordres êtes dignes de la Patrie. »
Cette Armée poussera de succès en succès jusqu’à quelques kilomètres de Florence et sera relevée le 22 juillet 1944 pour aller participer au débarquement des Forces alliées en Provence, le 15 août 1944, sous les ordres du futur Maréchal de Lattre de Tassigny qui la conduisit sur le Rhin et du Rhin au Danube.
En Italie, elle avait perdu plus de 6 500 tués sur 40 000 hommes au total mis hors de combat. Cette Armée de la Revanche, constituée en majeure partie par des contingents de la vieille Armée d’Afrique, avait ramené la victoire sous nos drapeaux et rendu à l’Armée Française tout entière « ses lettres patentes », suivant l’expression même du Général Juin.
C’est à elle que pensait le nouveau Maréchal de France au moment où il recevait, le 8 mai 1952, son bâton étoile des mains du Président de la République. C’est elle qui accompagnait, le 1er février dernier, la dépouille mortelle du dernier Maréchal de France, de Notre-Dame aux Invalides au milieu de tout un peuple, recueilli et comme en prière. Ces ombres, le Général Juin les avaient évoquées d’une façon pathétique lorsqu’il alla pour la première fois, en novembre 1946, visiter les cimetières militaires d’Italie. Après avoir passé en revue les tombes de ses soldats, au cimetière de Naples — un carré de chrétiens, un carré d’israélites et un grand rectangle de musulmans — il s’écria : « Aujourd’hui, ô mes morts, c’est votre chef qui vient vous saluer et vous dire sa reconnaissance et celle de tout un peuple… auquel vous avez rendu la liberté ».
Ces combattants, ces hommes qu’il aimait avec ferveur, ils vivaient dans sa mémoire. Avare de leurs peines et de leur sang il n’avait jamais consenti à les exposer à la mort qu’avec la certitude que lui donnait sa haute science militaire de ne pas le faire en vain. C’est eux, dans l’au-delà, qui l’ont accueilli dans leur gloire éternelle.