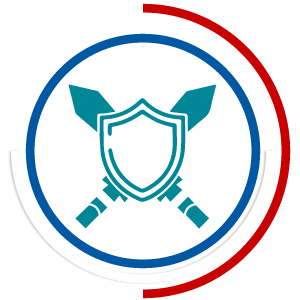Institutions internationales - Les difficultés des Nations unies - La « relance » britannique - La solidarité monétaire des « Six » - Les organisations internationales
Si l’existence des États apparaît comme une constante remarquable dans l’histoire des relations internationales depuis la fin du Moyen-Âge, la naissance et le développement des institutions internationales constituent l’un des traits les plus notables de la société contemporaine. Il n’est aujourd’hui guère de problèmes qui, dans une mesure plus ou moins large, plus ou moins directe, ne soient conditionnés par une organisation internationale, soit que celle-ci s’en préoccupe en raison même de ses attributions, soit que l’État concerné ne puisse faire abstraction d’elle. Aussi bien est-il nécessaire d’en étudier régulièrement les travaux : telle est la raison pour laquelle nous élargissons le cadre de cette chronique, jusqu’alors consacrée à l’Otan.
Certes, l’Otan a été l’une des organisations les plus caractéristiques du monde issu de la Seconde Guerre mondiale. Mais, indépendamment même du retrait de la France de ses organismes militaires, elle a perdu une part de sa signification, depuis que la coexistence pacifique a succédé à la guerre froide, depuis que Washington et Moscou raisonnent plus en fonction de leur parité nucléaire qu’en fonction des intérêts de leurs alliés respectifs, depuis que, sans pour autant rompre les solidarités atlantiques, l’Europe aspire à plus d’autonomie face aux États-Unis, etc. Au surplus, il ne semble pas que la réorganisation qui suivra l’installation du Conseil Atlantique et du SHAPE en Belgique puisse modifier l’une des données de base de la situation, à savoir le fait que l’intégration ne concerne et ne peut concerner que les armements conventionnels, les forces nucléaires ne pouvant être que nationales. Les discussions et les travaux risquent donc, selon toute vraisemblance, de ne concerner que des aspects mineurs des véritables problèmes, rien ne permettant de penser que les États-Unis soient disposés à renoncer à la « doctrine McNamara » qui, si elle correspond peut-être aux exigences de la sécurité américaine, ne satisfait pas celles de la sécurité européenne.
L’activité de l’Organisation des Nations unies, de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), du Conseil de l’Europe, des Communautés européennes (Marché commun, Communauté européenne du charbon et de l’acier, Euratom), du Fonds monétaire international (FMI), etc. tel sera désormais l’objet de cette chronique, qui ne négligera pas l’Otan, mais ne se limitera plus à elle.
Les difficultés des Nations unies
Les organisations internationales à principes et à vocation politiques sont en crise chronique, parce qu’elles ont voulu s’arroger une autorité supérieure à celle des États alors que l’État demeure le seul mode organique d’existence des communautés humaines. C’est particulièrement évident en ce qui concerne les Nations unies. Si celles-ci reposaient sur le postulat d’un accord entre le monde non communiste et le monde communiste pour assurer la paix par l’organisation des relations internationales, si, en matière de possibilités d’action, elles furent dotées de moyens très supérieurs à ceux dont disposait la Société des Nations, elles se trouvèrent amenées à œuvrer dans un monde dominé par l’opposition entre l’Est et l’Ouest, et parfois même, elles devinrent le champ clos de cet affrontement. Elles se trouvèrent ainsi condamnées à subir un décalage par rapport aux réalités internationales. C’est ainsi que, pièce maîtresse d’une organisation qui se voulait vouée à l’unité mondiale, le Conseil de sécurité devint, par son impuissance, le symbole de ce que Raymond Aron a pu appeler « le grand schisme du monde moderne ».
Il était logique que l’amélioration des relations entre Washington et Moscou se répercutât aux Nations unies, qui se comportent comme une caisse de résonance, qui répercutent aujourd’hui les discours en faveur de la coexistence pacifique comme, hier, elles répercutaient ceux de la guerre froide. Est-ce suffisant ?
Il va y avoir vingt-deux ans que les Nations unies existent. La Société des Nations n’eut pas une telle durée. Mais si les Nations unies existent et continueront d’exister, elles ne peuvent pas jouer le rôle décisif dans les crises dont l’enjeu est la paix ou la guerre. Ou bien les grandes puissances sont d’accord, et en ce cas, avec ou sans organisation internationale, les périls sont limités ; ou bien les grandes puissances s’opposent les unes aux autres et, en cette hypothèse, ni le Conseil de sécurité, ni l’Assemblée générale ne peuvent les contraindre. Ce sont les armes nucléaires, non les Nations unies, qui ont enseigné la sagesse…
Manipulée contre l’Union soviétique pendant la crise coréenne, l’Assemblée générale l’a été ensuite par les États afro-asiatiques contre les puissances « coloniales ». Mais elle comprend maintenant deux fois plus d’États-membres qu’il y a vingt ans, et elle est devenue moins complaisante : l’obtention d’une majorité y est plus difficile. On peut donc mieux apprécier ce que l’on peut espérer des Nations unies, et ce que l’on ne doit pas leur demander.
Quand deux États en conflit souhaitent ne pas en venir à la lutte ouverte et ne veulent pas établir de contact direct, les Nations unies constituent le meilleur intermédiaire : les « casques bleus » séparent alors les antagonistes aussi longtemps que ceux-ci n’ont d’autre désir que d’être séparés.
Certes, il est facile de tourner en dérision les grands mots et les formules creuses de l’éloquence onusienne, de remarquer que ceux qui y donnent des leçons de démocratie et d’humanité ne sont pas toujours qualifiés pour les donner, mais les 120 États représentés à New York constituent le système international. La plupart sont gouvernés par des hommes qui n’accepteront plus que le sort de l’humanité soit confié aux seuls chefs des cinq ou six grands États. Unie par la technique mais divisée par les idéologies et par les inégalités de développement, l’humanité a besoin d’un lieu où se rencontrent les représentants de tous les pays : le dialogue n’est pas une condition suffisante de la compréhension réciproque, mais il en est une condition nécessaire.
Enfin, les Nations unies sont le lieu où les jeunes États peuvent faire leur apprentissage de la vie internationale, peuvent vaincre ce que, par analogie avec une célèbre formule communiste, on peut appeler « les maladies infantiles du nationalisme ».
Mais elles demeurent parfois hors du concret. C’est ainsi par exemple que, pour la seizième fois consécutive, l’Assemblée générale a, lors de sa dernière session, refusé l’admission de la Chine populaire – et, au rebours de la tendance qui s’était manifestée lors des précédentes sessions, Pékin a, cette fois, perdu des voix lors des scrutins successifs. Est-ce une victoire pour les États-Unis ? Ne serait-ce pas plutôt une défaite pour la Chine, dont l’agressivité idéologique, la promotion nucléaire, l’expansionnisme en Asie continentale et dans le Pacifique, inquiètent nombre d’États ? Il est significatif que la Chine ait perdu de nombreuses voix afro-asiatiques. Mais il n’en demeure pas moins que la Chine existe, et qu’elle ne siège pas aux Nations unies. Peu importe le jugement que l’on porte sur l’infrastructure idéologique du régime politique chinois : les Nations unies se préoccupent de problèmes dans lesquels intervient la Chine populaire, et elles ignorent celle-ci. Rien ne permet de penser qu’elles pourraient intervenir plus activement dans le drame vietnamien si elles adoptaient une altitude différente, mais force est de reconnaître qu’il leur est bien difficile d’intervenir dans ce problème aussi longtemps qu’elles n’ont pas dans leurs rangs l’un de ses principaux protagonistes.
Pourtant, en dépit de ce nouveau rejet de la candidature chinoise, les Nations unies ont exprimé un certain soulagement. C’est qu’en effet M. Thant a accepté, à la demande du Conseil de sécurité, de rester pour une nouvelle période de cinq ans au Secrétariat général. Washington et Moscou n’ont pas caché leur satisfaction commune : dans les deux capitales on redoutait le nouvel affrontement qui serait devenu inévitable s’il avait fallu choisir un nouveau Secrétaire général. M. Thant s’est-il pour autant soumis aux grandes puissances ? Approuve-t-il pour autant la politique des États-Unis au Vietnam ? En fait, il a toujours préféré des mesures prudentes, permettant d’améliorer une situation ou tout au moins d’en sauvegarder les chances, à des décisions spectaculaires qui n’ont généralement d’autre résultat que d’aggraver la situation de Moscou et de certaines réserves de Washington, M. Thant avait succédé à M. Hammarskjoeld. Il vient d’obtenir leur appui, sans pour autant se soumettre à leurs vues. Pourtant, il a pris position contre la politique américaine au Vietnam, et il a reproché à Moscou de s’opposer à l’admission de Pékin. C’est donc un succès moral et politique qu’il a remporté.
Quelles peuvent en être les conséquences ? M. Thant sait que les Nations unies ne pourront pas intervenir efficacement dans des problèmes comme le Vietnam ou le désarmement aussi longtemps que la Chine Populaire en restera exclue – mais peut-il obtenir d’elle qu’elle mette un terme à la subversion qu’elle développe dans le Tiers-Monde, et qu’elle ne présente plus sa politique nucléaire sous un jour aussi agressif ? Ainsi donc, sans avoir tenu des propos aussi explicites, M. Thant pourrait reprendre à son compte la politique préconisée par M. Hammarskjoeld. L’évolution du monde depuis 1945 a donné aux pays afro-asiatiques la majorité aux Nations unies, au détriment des grandes puissances, mais celles-ci continuent à y exercer une influence prédominante. Le courant sera-t-il renversé ? Les Nations unies seront-elles dominées politiquement, comme elles le sont numériquement, par les États ayant accédé depuis peu à l’indépendance ? Telle est la principale question qui se pose alors que M. Thant vient d’entamer un nouveau bail de cinq ans alors – qu’au Moyen-Orient des incidents fréquents maintiennent un état de crise latente d’où peut à chaque instant surgir un conflit – que la décision d’appliquer des sanctions à la Rhodésie pose plus de questions qu’elle n’en résout – que les États-Unis s’obstinent à poursuivre au Vietnam une politique qui ne peut pas déboucher sur la paix…
La « relance » britannique
Dans le même temps, la Grande-Bretagne laissait entendre qu’elle envisageait de poser à nouveau sa candidature au Marché commun. Elle n’a jamais considéré comme sans appel le veto mis en janvier 1963 par le général de Gaulle à son entrée dans le Marché commun, mais elle n’a pas précisé depuis si elle acceptait les perspectives politiques de ce même Marché commun. Certes, l’intégration politique des « Six » est exclue – et, à cet égard, il est faux de prétendre que le général de Gaulle est le seul, parmi les dirigeants des « Six », à s’opposer à l’idée de supranationalité européenne. Aucun des partenaires de la France n’est disposé à accepter cette supranationalité ! Mais entre cette intégration rejetée par les uns pour des raisons de principes politiques, considérée par les autres comme hors de question dans un avenir prévisible, et la simple juxtaposition des souverainetés nationales, il y a place pour bien des formules intermédiaires, qui concilient les exigences de la communauté et celles, non moins légitimes, des États. C’est dans cette zone intermédiaire que se situent les thèses françaises sur l’Europe politique, thèses qui reposent sur l’idée que l’on ne peut envisager une Europe solide que fondée sur les réalités européennes, c’est-à-dire sur les États-Nations.
Aussi bien certaines équivoques subsistent-elles. Tant au sein du Conseil de l’Europe que de l’Association européenne de libre-échange qu’au cours de la réunion à Rome des partis socialistes européens, de nombreuses voix se sont, au cours des dernières semaines, élevées en faveur de l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, mais sans que l’on puisse faire exactement la part de celles qui la prônent sincèrement et de celles qui la prônent d’abord par opposition à la politique du général de Gaulle. À l’issue de ses entretiens avec ce dernier, M. Harold Wilson s’est montré optimiste. Mais les problèmes demeurent aussi complexes qu’ils l’étaient, dans le domaine politique puisque les communautés de Bruxelles ne sont, dans l’esprit et selon la lettre du Traité de Rome, qu’une étape fonctionnelle sur la voie de l’Europe politique, dans le domaine économique aussi. C’est ainsi, par exemple, qu’en ce qui concerne l’agriculture, certains des intérêts de la Grande-Bretagne paraissent incompatibles avec la politique agricole commune définie par les « Six », et M. Wilson a lui-même précisé que son pays demanderait des « ajustements » en matière agricole. Au surplus, il ne semble pas que l’on puisse parvenir à un accord sur l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun sans un accord préalable sur le problème monétaire.
Quoi qu’il en soit, tandis qu’à Bruxelles la « Commission » de la Communauté économique européenne » (« Commission Hallstein ») proposait une gestion centralisée de la politique agricole commune à partir du 1er juillet prochain, tandis que devant le Conseil de l’Europe le délégué tunisien demandait l’association de son pays au Marché commun, le problème britannique dominait les discussions de plusieurs organisations : Conseil de l’Europe, Union de l’Europe occidentale (UEO), etc.
La solidarité monétaire des « Six »
Dans le même temps aussi – et la concomitance est significative – les ministres des Finances des « Six » à La Haye, les experts des « Dix » (pays à monnaie forte) et les vingt directeurs exécutifs du Fonds monétaire international (FMI) se sont, à quelques jours d’intervalle, trouvés placés devant le problème d’une éventuelle réforme du système monétaire international. Les Européens ont repris à leur compte, du moins dans son principe, la proposition faite il y a trois ans par les Américains, à savoir qu’il conviendrait, en même temps qu’on envisage la création d’une nouvelle monnaie de réserve internationale, de prévoir une expansion des facilités de crédit existantes.
Au-delà de ces divergences de vues s’est affirmée une certaine solidarité des « Six ». Ceux-ci sont bien décidés à poser des conditions à une éventuelle extension des possibilités de crédit accordées par le FMI. Ils voudraient non seulement que soit augmentée la part des Européens (quota) dans le capital du Fonds mais surtout que soient révisées les règles relatives à la prise des décisions au sein de cette institution. Il s’agirait d’élaborer une procédure donnant aux six pays de la Communauté économique européenne une sorte de droit de veto sur l’octroi de tout crédit complémentaire.
Comme l’a dit M. Zijstra, Premier ministre des Pays-Bas, qui présidait la réunion des ministres des Finances des « Six », le problème à long terme du rôle de l’or dans le système monétaire international, et de son prix futur, n’a pas été abordé. Si la France a renoncé à saisir les experts des « Dix » de la question du prix de l’or, du moins a-t-elle eu la satisfaction de voir que ses partenaires européens n’en excluaient pas formellement l’examen dans les prochains mois. C’est alors qu’apparaît un nouveau problème : l’harmonisation monétaire à l’intérieur de la CEE ; seule cette harmonisation peut permettre, dans un second temps, une coordination à partir de laquelle pourra peut-être être posée la question d’une monnaie commune. On ne peut pas, en effet, imaginer qu’un effort de coordination économique ne s’accompagne pas d’un égal effort de coordination monétaire, de même que l’on ne peut concevoir que cette coordination économique ne se complète pas par une coordination diplomatique et militaire. Les communautés économiques – Marché commun, Communauté Charbon-Acier, Euratom – ont été conçues comme des organismes fonctionnels préparant une construction politique. Il conviendrait ainsi, puisque l’on a adopté la démarche fonctionnelle pour arriver à l’Europe politique, de prévoir une nouvelle Communauté, chargée de préparer la coordination monétaire.
Au lendemain de la guerre, dans l’optimisme que suscitaient les premières aspirations européennes, certains spécialistes proclamèrent : « l’Europe se fera par la monnaie ». Aujourd’hui, alors que les aspirations européennes ont été réinsérées dans le concret, on se rend compte que « l’Europe ne se bâtira pas a sans la monnaie ».
Les organisations internationales
Une chronique comme celle-ci sera toujours incomplète. Il faudrait aujourd’hui signaler certains travaux de l’UNESCO, ou de l’OCDE. L’essentiel se situe ailleurs. On dénombre actuellement dans le monde plus de 150 institutions fondées par les gouvernements – la France est membre de 85 d’entre elles. De 1815 à 1954, 1978 organisations internationales ont été créées. Il ne se passe pas de jour où, même sans tenir compte des organismes qui exercent une activité permanente, un ou plusieurs rouages de ces institutions ne tiennent une séance. Les relations internationales tendent donc à s’institutionnaliser de plus en plus. Nous voulons dire par là qu’elles se déroulent de plus en plus souvent dans le cadre et selon les règles d’organismes préétablis qui exercent une sorte de médiation permanente entre les États. Ce phénomène institutionnel a certainement transformé les conditions de la vie internationale. Il n’a pas affecté pour autant la nature même des rapports internationaux, chaque État cherchant à défendre ses intérêts.
C’est désormais à l’analyse mensuelle des problèmes posés par ce phénomène institutionnel, de ceux qui naissent de l’insertion des politiques nationales dans des organisations transnationales, que sera consacrée cette chronique.