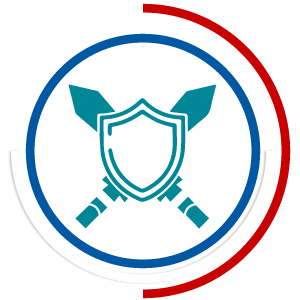Défense à travers la presse
L’intervention du président Mitterrand devant l’Assemblée générale des Nations unies, avec sa forte condamnation des armes chimiques, a sans doute constitué le point fort de ce mois de septembre. Toutefois, il y avait eu auparavant le lancement par Israël d’un satellite expérimental, Offek-1 (autrement dit Horizon-1). Cette percée technologique de l’État hébreu, dans une région des plus critiques et à un moment où la tension est particulièrement vive en Cisjordanie, ne pouvait laisser indifférent. Nos confrères n’ont pas manqué de fournir à leurs lecteurs tous les détails concernant cette réussite, peu d’entre eux se sont cependant intéressés à l’aspect stratégique de la question.
Le Quotidien de Paris, le 20 septembre 1988, se contentait de signaler que « les Israéliens ne seraient pas toujours satisfaits des informations fournies par les satellites américains et souhaiteraient donc disposer de leur propre engin ». Une thèse plus largement développée par Shalom Cohen dans Libération du même jour :
« Offek doit permettre à l’industrie spatiale israélienne de développer un vrai satellite espion. Jérusalem a investi plus d’un milliard de dollars dans ce projet parce que les États-Unis refusent de lui fournir les informations recueillies par leurs propres satellites au-dessus des pays arabes. Pour les obtenir, les services secrets du Mossad avaient recruté l’Américain Jonathan Pollard, arrêté et condamné aux États-Unis pour espionnage au profit d’Israël. Nous avons ressenti le manque de ce genre d’informations pendant la guerre du Kippour, raconte Mordechai Gour, ancien chef d’état-major de Tsahal. La leçon de cette guerre, vieille de quinze ans, a été appliquée quelques années plus tard avec la création d’une agence pour la recherche spatiale, sous la direction du professeur Yuval Neeman que certains experts à l’étranger ont surnommé le père de la bombe A israélienne ».
Pour Alain Frachon, dans Le Monde du 21 septembre 1988, il ne fait pas de doute qu’Israël est devenu la première puissance spatiale du Proche-Orient et, de ce fait, réduit sa dépendance vis-à-vis des États-Unis sans toutefois la supprimer encore :
« Les experts n’ont pas été surpris par la capacité d’Israël à concevoir et assembler un satellite du fait de ses connaissances avancées dans les domaines de l’informatique et de l’optique spatiale. Ils estiment que la performance réside avant tout dans la mise au point de la fusée et la maîtrise de la mise sur orbite. Seuls les États-Unis, l’URSS, la Chine, l’Inde, le Japon, la Grande-Bretagne et la France appartenaient jusqu’à présent au club très fermé des puissances possédant ce maillon de la chaîne spatiale. Même si les Israéliens s’en défendent, la percée a des significations militaires, ne serait-ce que d’un point de vue psychologique, puisqu’elle vient confirmer cette image d’un Israël techniquement supérieur à ses adversaires et voisins. Par ce qu’il représente de maîtrise scientifique. Horizon-1 accroît la capacité de dissuasion d’Israël ».
Enfin Olivier Fournaris considère que l’État hébreu devient un modèle pour le Tiers-Monde. Il s’en explique dans La Croix du 21 septembre 1988 :
« En ayant prouvé d’une manière totalement inattendue son aptitude à réaliser effectivement un engin spatial, Israël s’ouvre la porte des grands programmes internationaux dédiés à l’espace. C’est un atout majeur pour un pays de peu de ressources naturelles et qui ne pourra construire son futur que sur les apports d’une science et d’une technologie appliquée particulièrement développées. L’exemple est ainsi donné à une cinquantaine de pays du Tiers-Monde, dont les ressources financières sont au moins égales à celles d’Israël, que l’investissement dans la recherche scientifique peut être payant pour gommer les infortunes de la géographie ».
C’est pour gommer de la planète d’autres infortunes que le président Mitterrand a exposé devant l’ONU un plan visant à mettre hors la loi les armes chimiques. Guy Magalon, dans La Croix du 1er octobre 1988, juge l’initiative impressionnante :
« Il s’agit là sans doute du dispositif le plus complet proposé à ce jour pour mettre un terme à l’utilisation de ces armes que Vernon Walters, l’ambassadeur des États-Unis à l’ONU, qualifiait de plus dangereuses que la bombe atomique, car plus faciles à produire ».
Analysant le discours présidentiel dans son ensemble, Paul Guilbert, dans Le Quotidien de Paris du 30 septembre 1988, note la netteté de la formulation et de l’intonation :
« Ce que le président français a voulu dire, c’est que les valeurs du désarmement et de la sécurité n’étaient pas antagonistes, qu’elles méritaient au contraire d’être proposées avec application, avec obstination, que pour tenir ce fil-là il ne fallait négliger aucune chance, aucune astuce. On le voit à sa manière de répéter que l’Accord Reagan-Gorbatchev est un bon accord, à sa manière de chercher à diviser, selon les zones et les stratégies, les difficultés du désarmement conventionnel en Europe en y ajoutant une pointe de lyrisme sur la vraie nature de l’unité européenne ».
Cependant, dans Le Figaro du même jour, François Hauter n’hésite pas à évoquer le casse-tête du désarmement chimique. Là encore se pose le problème des vérifications :
« Le consensus général entre Occidentaux et Soviétiques sur cette impérieuse nécessité ne règle pas pour autant le problème de fond : compter et vérifier la destruction de millions de bidons soulèvent des difficultés autrement plus compliquées que réduire le nombre de têtes nucléaires ou les moyens d’une artillerie… La France, l’année dernière, avait surpris ses alliés et l’Union soviétique en développant une position assez étrange sur le chimique. Elle avait annoncé qu’elle se doterait d’un stock dissuasif de gaz (deux mille tonnes) en attendant que les deux Grands détruisent effectivement leurs propres stocks considérables (trois cent mille tonnes pour l’URSS, de quarante à cinquante mille tonnes pour les États-Unis). M. Mitterrand a enterré cette idée. Les spécialistes des armes chimiques s’interrogent cependant sur la possibilité de limiter sérieusement leur prolifération ».
Quant au Monde, il a préféré consacrer son éditorial au Prix Nobel de la paix, décerné cette année aux casques bleus de l’ONU, une distinction méritée selon notre confrère qui a laissé à Charles Lescaut le soin de présenter le discours du président Mitterrand. Rappelant, à l’instar du Figaro, la précédente position de la France à l’égard des armes chimiques, il note :
« Le changement est significatif, même si le discours n’est pas d’une totale transparence. Après avoir affirmé que, contrairement à l’URSS et aux États-Unis, la France ne possède pas d’armes chimiques, le président a laissé entendre qu’elle se gardait la possibilité d’en produire et qu’elle n’y renoncera qu’une fois signée la convention internationale. M. Mitterrand avait été pris de vitesse sur le sujet par le président Reagan qui, dans la même enceinte, avait proposé la convocation d’une réunion internationale visant à réaffirmer solennellement l’interdiction de l’emploi des armes chimiques. Il l’a été à nouveau jeudi quand les Américains, avant les Français, ont proposé que cette réunion se tienne à Paris. On approuve, bien sûr, côté français, mais on insiste sur le fait qu’une telle réunion serait insuffisante, voire de pure diversion, si elle se bornait à prohiber une nouvelle fois les armes chimiques et pas leur fabrication. M. Mitterrand est d’ailleurs allé un peu plus avant que le président Reagan, y compris à propos de l’emploi de ces armes, en demandant que l’ONU se charge d’élaborer des mesures de sanction ».
La guerre du Golfe aura donc eu pour résultat d’attirer l’attention des responsables du monde international sur les risques d’une guerre chimique. Le débat s’ouvre à nouveau, mais il ne faudrait pas tomber dans le travers de juger ces armes, chimiques ou biologiques, immorales d’où on conclurait à leur interdiction. Elles sont d’une redoutable efficacité, mais elles présentent l’inconvénient de ne pas avoir de parade et à ce titre elles sont déstabilisantes ; seule une dissuasion nucléaire est en mesure d’interdire à l’adversaire leur emploi. Là encore, on retrouve la sécurité que procure l’arme nucléaire dès lors qu’elle est assujettie à une doctrine stratégique de circonstance.
Nos journaux n’ont pas oublié qu’il y a cinquante ans furent signés les accords de Munich. L’événement est relaté avec les divergences d’appréciation auxquelles il a donné lieu par la suite. Il est normal aujourd’hui d’avoir recours au qualificatif de « munichois » pour réprouver l’attitude de toute personne plus soucieuse de pacifisme que d’honneur. De même parle-t-on de façon quelque peu abusive du partage de Yalta. Les miroirs de la polémique sont déformants. S’en tenir au seul récit des accords de Munich, comme viennent de le faire nos confrères, c’est oublier la situation qui prévalait en Europe, c’est oublier qu’au sommet de la montée de l’hitlérisme les pays libres n’ont pas accepté d’accomplir l’effort militaire qui s’imposait. Ils se mettaient de ce fait dans l’impossibilité d’honorer les engagements qu’avaient souscrits leurs diplomates. Se placer dans une telle situation n’a certes rien d’honorable, mais faut-il pour autant réprouver ces accords de Munich qui laissaient courir les délais et auraient dû nous permettre d’armer nos contingents ? Sait-on à ce sujet que le général de Gaulle, peu suspect de défaitisme, avait déclaré à Georges Bonnet : « Vous avez eu raison de faire les accords de Munich. Les Américains n’étaient pas encore prêts. Il fallait gagner un an ». Le propos est rapporté par l’ambassadeur Raphaël-Leygues dans ses Chroniques des années incertaines (France-Empire, 1977 p. 97). L’année aura bien été gagnée, mais pas les premiers affrontements avec l’armée allemande. Il apparaît qu’à l’époque le général de Gaulle comptait sur la puissance des États-Unis : l’Europe actuelle suit la même pente, mais ne conviendrait-il pas de mieux assurer seuls notre sécurité ? ♦