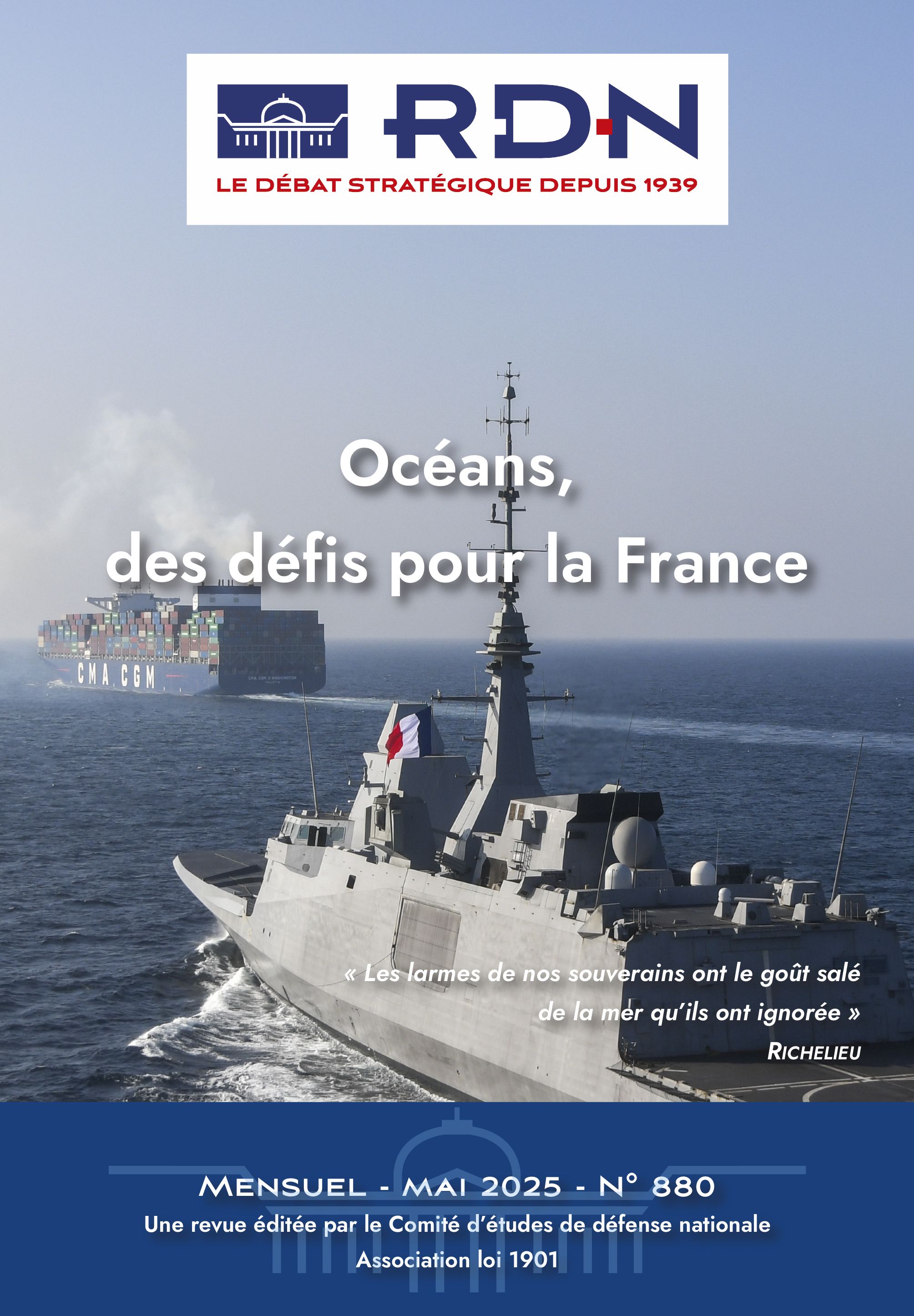Les marins et l’outre-mer
Rendons d’abord hommage à l’éditeur qui a osé intituler sa nouvelle collection : « L’aventure coloniale de la France », témoignant ainsi que pourrait enfin commencer à s’estomper cette mauvaise conscience collective qui nous a été imposée sur le sujet depuis un quart de siècle. Et cela bien que tout n’ait pas été négatif dans cette aventure, comme osait également le rappeler récemment un haut personnage de l’État, lorsqu’il soulignait les liens affectifs que nous avons le plus souvent conservés avec les populations de nos anciennes colonies. Après Jean Martin, Gilbert Comte et Paul-Marie de La Gorce, c’est Jean-Pierre Gomane qui vient nous en parler maintenant dans ce livre qui évoque l’aventure des « gens de mer » dans l’« outre-mer », avec l’autorité que lui confèrent sa connaissance personnelle de la plupart de ces régions, sa qualité de directeur des études du Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes (CHEAM), et enfin, son expérience d’homme de mer, puisqu’il fut lui-même un vrai marin. Les lecteurs de cette revue ont pu par ailleurs apprécier déjà la finesse de ses jugements et sa rigueur intellectuelle dans les analyses qu’il leur a présentées sur la géopolitique du Pacifique et la situation dans l’Asie du Sud-Est, ses sujets de prédilection.
Dans l’introduction de son nouvel ouvrage, Jean-Pierre Gomane se défend d’avoir voulu écrire un livre d’histoire, et encore moins d’histoire coloniale, précise-t-il comme pour se disculper une dernière fois du péché de colonialisme. C’est en effet à une réflexion sur l’attitude des Français en général – et des marins en particulier –, qu’il entend surtout nous inviter. L’outre-mer étant pour lui un terme qui dépasse de beaucoup le cadre colonial, puisque « Marine, commerce et outre-mer furent toujours liés, parfois institutionnellement, de Colbert à Jules Ferry », rappelle-t-il. Mais pour les Français, ce peuple de terriens, « la mer n’est que la fin de la terre », ajoute-t-il, paraphrasant Hegel. D’où ce « dilemme français », qu’il se propose d’analyser à travers notre histoire, puisque nos gouvernants ont généralement considéré que « l’essentiel était de mener une grande politique en Europe », et, de ce fait, ont souvent « tranché au détriment des initiatives ultramarines », considérées par eux « comme des épisodes lointains et subalternes ».
Or ces initiatives ont été le plus souvent prises par des marins, ces « inconnus » sous-titre notre auteur, qui aurait pu ici paraphraser Platon lorsqu’il leur attribuait un monde à part. Mais elles sont généralement ignorées, comme Jean-Pierre Gomane en a fait l’expérience lors d’une mésaventure pédagogique qu’il nous raconte avec humour. C’est pour remédier à cette situation que, dans la première partie de son livre, il a entrepris de nous relater « la permanence de la Marine outre-mer », restant ainsi à mi-chemin d’une histoire de l’outre-mer, où « les marins n’occupent nullement un monopole », et d’une histoire de la Marine « qui se déroulera souvent… dans les eaux métropolitaines ou européennes ». Ce récit, il le conduit avec brio, depuis « l’élaboration d’une vision mondiale » par Richelieu, en passant par le « premier reflux » provoqué par Louis XIV qui « n’aimait pas la mer », en s’arrêtant aux « succès du petit-fils qui répare les échecs du grand-père », puis à la « débâcle (napoléonienne) masquée par la gloire en Europe », pour parvenir à la IIIe République, qui voit la « conversion d’une république de ruraux », lorsque « le chemin de Strasbourg passait par Hanoï », et en arriver ainsi à la période contemporaine, où, après que l’« Empire (ait été le) refuge de la France humiliée », se produisit un « troisième reflux », puisque « qui perdra Hanoï, perdra Alger ». Et cette fresque brillante se termine alors sur les perspectives nouvelles ouvertes par l’ère nucléaire.
Dans la deuxième partie de son ouvrage, Jean-Pierre Gomane a animé sa démonstration, en évoquant de façon plus précise certains événements ou certains personnages, et en groupant ces précisions par thèmes. Ceux-ci sont successivement, pour reprendre ses titres : navires et navigateurs, combattants sous les tropiques, découvreurs du monde, sillage du commerce, service de l’État (où il distingue les administrateurs et gestionnaires, les négociateurs et diplomates, et enfin – là encore avec humour – les « louvoyeurs du pouvoir »). Il finit sur le thème moins sérieux, mais traité avec esprit des « délassements du marin », où sont évoqués notamment les nombreux anciens marins qui ont dû à l’exotisme l’inspiration de leur art, tels Rivière, Segalen, Eugène Sue, Pierre Loti et Claude Farrère bien sûr, Paul Gauguin, Louis Delaporte, Charles Meyron, Albert Roussel, Jean Cras et beaucoup d’autres moins connus ou méconnus. Ces différents thèmes sont à nouveau mis en situation dans des annexes, qui reproduisent les écrits, pittoresques ou douloureux suivant les cas, de personnages ayant participé à certains événements importants.
L’ouvrage se termine par une courte conclusion, dans laquelle l’auteur, constatant l’effondrement des flottes marchandes européennes, demande avec angoisse : l’Europe qu’on nous promet « sera-t-elle simplement européenne ou mondiale ? ». Bonne question, rétorquerait-on dans les colloques, mais dont la portée dépasse beaucoup, pensons-nous, le problème de l’avenir des flottes de commerce. Si en effet la France est la seule Nation d’Europe à conserver « un ancrage outre-mer », comme le constate Jean-Pierre Gomane, elle est surtout la seule parmi ses partenaires à avoir encore la volonté politique de continuer à jouer un rôle mondial, autrement que par ses marchands. Mais pourra-t-elle persister longtemps dans cette voie, compte tenu de ses ressources limitées ? Et nous voici ramenés ainsi au « dilemme français », souligné par l’auteur au début de son ouvrage, celui du choix pour notre pays entre sa vocation mondiale et sa vocation européenne. Remarquons cependant que ce choix dramatique pourrait être évité dans une Europe unie, puisqu’il serait possible alors d’envisager une répartition des tâches entre partenaires. Et nous aurions de la sorte devant nous ce « grand dessein », auquel nos compatriotes aspirent tant. Mais tel ne paraît pas être l’objectif de la fameuse échéance de 1993, puisque le « marché unique » ne se propose pour le moment que de conforter la seule Europe des marchands…
Par cette dernière remarque que nous nous permettons à titre personnel, nous espérons avoir fait entrevoir à nos lecteurs que le livre de Jean-Pierre Gomane est enrichissant pour la réflexion prospective. Il est par ailleurs très intéressant sur le plan historique par l’ensemble des informations qu’il réunit, lesquelles témoignent de l’érudition de l’auteur, bien qu’il se défende d’être historien. Ajoutons pour finir qu’il est remarquablement écrit et ainsi d’une lecture fort agréable. ♦