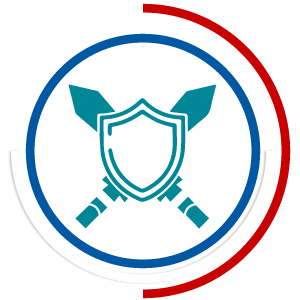Du moment que les deux fractions politiques de Djibouti, celle de la majorité avec M. Ali Aref et celle de l’opposition avec MM. Gouled et Dini, s’accordaient — c’est hélas le seul point de leur accord — pour réclamer l’indépendance du territoire, le gouvernement français ne pouvait évidemment refuser d’en envisager la perspective. Il a donc reconnu, le 31 décembre 1975, « la vocation à l’indépendance du Territoire Français des Afars et des Issas ». Mais il l’a fait en l’assortissant de conditions non équivoques : la France entend faire accéder le territoire à la souveraineté nationale « en maintenant l’intégrité de ses frontières, en assurant sa sécurité et en préservant la dignité de ses populations ». Elle se déclare également disposée à « valoriser les chances économiques du futur État ».
On hésite à se féliciter de la sagesse de ces conditions qui masquent à peine le fait que la promesse française intervient trois semaines seulement après que l’ONU nous ait mis en demeure, dans une résolution aux termes offensants, d’accorder « l’indépendance immédiate et inconditionnelle au peuple de la prétendue Côte française des Somalis ».
Ces faits, faut-il l’avouer avec quelque tristesse, n’ont pas semblé émouvoir beaucoup nos compatriotes. Mais tous ceux qui ont œuvré pour faire de ce morceau de terre africaine ce qu’il est aujourd’hui, tous ceux qui lui ont donné une certaine image de la France et l’ont maintenu en paix en dépit des rivalités et des convoitises, tous ceux pour qui Djibouti était une escale sur la route où les appelait leur carrière de fonctionnaire de la France d’outre-mer ou de soldat, tous ceux-là n’auront pas appris ces nouvelles sans un certain serrement de cœur ni quelque inquiétude. La partie qui va se jouer maintenant s’engage en effet dans un contexte périlleux. C’est ce qu’exprime ici l'auteur, ancien officier de l’artillerie de Marine ; son article avait été rédigé en grande partie à la suite d’un séjour effectué à Djibouti au printemps dernier.
L’installation de la France en 1880 dans le golfe de Tadjoura, à Obock d’abord, et quelques années plus tard à Djibouti, s’inscrivait logiquement dans le dessein général de notre politique d’expansion coloniale. Il importait dans le contexte de l’époque d’assurer la liberté et la sécurité de nos communications maritimes vers l’Indochine, Madagascar et leurs dépendances. À l’entrée de l’Océan Indien en venant de Suez et de la Mer Rouge, le golfe d’Aden était une zone d’aiguillage privilégiée pour la répartition du trafic entre la côte orientale d’Afrique, l’Extrême-Orient, les Indes et le golfe Persique. Les Anglais, bien évidemment, s’y étaient installés les premiers, au meilleur endroit, à Aden même. Il fallait à la France un port d’escale indépendant, qui lui soit propre. Elle le trouva au sud-ouest du détroit de Bab-el-Mandeb, un peu à l’écart, mais sur une côte presque déserte, ce qui facilitait l’établissement. Celui-ci ne fut d’ailleurs guère contestée par les sultanats Afars et les tribus somalies, sous vague souveraineté éthiopienne, qui nomadisaient dans la région. Il n’était pas d’usage de consulter les autochtones, sauf à les indemniser un tant soit peu. Ce genre de problème se réglait en Europe autour des tables de conférence. Dans le cas particulier, à Obock comme à Djibouti, la France ne menaçait personne et le consensus des puissances coloniales fut acquis sans difficultés majeures.
L’escale, principal but de l’opération, une fois installée, le gouverneur Lagarde songea à l’animer par des activités plus diversifiées que le seul soutage des navires français en transit. Après de vagues espoirs, vite déçus, de trouver quelques ressources dans le petit hinterland qui entourait Djibouti, il s’attaque au projet plus ambitieux de faire de ce point la porte d’accès privilégiée du monde extérieur vers l’Éthiopie, car ce pays n’avait de façade maritime qu’en Érythrée, convoitée par les Italiens, qui devaient d’ailleurs l’occuper en tant que colonie en 1890. D’où l’entreprise du chemin de fer franco-éthiopien qui atteignit Dire Daoua, au Harrar, en 1905 et Addis en 1917. Mais le trafic ne prit jamais d’ampleur considérable. La vocation première de Djibouti ne fut donc pas sensiblement modifiée, d’autant plus qu’au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l’Éthiopie réussissait à récupérer l’Érythrée avec ses deux ports maritimes de Massaoua et d’Assab.
En ces circonstances et après la perte de l’Indochine, notre retrait de Madagascar et le tournant vers une décolonisation générale en Afrique, on aurait pu logiquement imaginer que l’importance d’une escale spécifiquement française à l’entrée de l’Océan Indien allait rapidement s’estomper, d’autant plus que les installations proprement portuaires de Djibouti n’avaient jamais été amenées à un niveau vraiment satisfaisant pour un trafic moderne et que la maîtrise du canal de Suez était fortement mise en question. Notre prochain abandon de la Côte Française des Somalis pouvait dès lors paraître inéluctable.