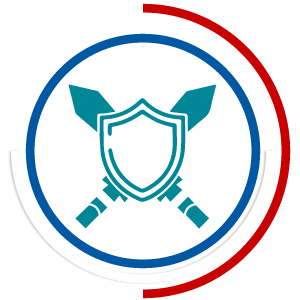From Deterrence to Defence (The inside story of Strategic Policy)-Candid interviews with the architects of American Nuclear Policy
« De la dissuasion à la défense », tel pourrait être, dans sa traduction française, le titre de ce livre publié aux États-Unis et qui relate l’histoire « intime » de la politique nucléaire américaine au niveau stratégique, comme indiqué dans son sous-titre. Écrit par un journaliste réputé de la BBC, il réunit les interviews qu’il a conduites sur ce sujet auprès d’une vingtaine de personnalités américaines et européennes ayant été, à des degrés divers, les « architectes » de cette politique. Le sujet est d’une actualité certaine au moment où les deux Grands prétendent vouloir rendre la dissuasion nucléaire « obsolète ». Mais la méthode adoptée par Michael Charlton pour réunir les éléments de sa recherche est aussi très intéressante, puisqu’elle fait appel à l’« histoire orale », c’est-à-dire aux témoignages parlés de ceux qui en ont été les auteurs, ces témoignages étant recueillis à partir d’interviews soigneusement préparées, si possible contradictoires et en tout cas menées de façon « candid » pour reprendre l’expression anglaise, c’est-à-dire sans complaisance.
Michael Charlton a conduit son enquête en cinq temps. Dans un premier, il a longuement interrogé Robert McNamara, ministre de la Défense des États-Unis de 1961 à 1968, pour déterminer comment au cours de cette période les Américains en étaient arrivés à préconiser l’abandon de toute défense contre les missiles balistiques, ce qui les amena à prendre l’initiative dès 1967 de proposer aux Soviétiques un Traité anti-missiles balistiques (ABM). C’est en effet McNamara qui, contre l’avis unanime des chefs d’état-major conjoints, recommanda alors très fermement au président Johnson de ne pas envisager la fabrication et le déploiement d’une défense de l’espace, alors que les Soviétiques avaient entrepris de s’en doter. Au cours de son interview, McNamara raconte d’abord comment, à son arrivée en fonction, il constata que le fameux « missile gap », au sujet duquel le président Kennedy venait de faire campagne, n’existait pas (en 1960, les États-Unis avaient 6 300 têtes nucléaires contre 200 en Union soviétique). Il raconte ensuite pourquoi, malgré cette dissymétrie, il en arriva dès 1962 à la conclusion que la stratégie des « représailles massives » n’était plus crédible dans le cas d’une agression limitée en Europe effectuée seulement par moyens conventionnels, et comment il recommanda alors l’adoption par l’Otan de la stratégie de la « flexible response », laquelle supposait un renforcement important de ses moyens conventionnels qui ne sera jamais réalisé, déplore-t-il. On sait que cette stratégie ne sera définitivement adoptée qu’en 1967, c’est-à-dire après le retrait de la France de l’organisation militaire intégrée, puisque le général de Gaulle s’y était opposé farouchement, c’est nous qui l’ajoutons, et cela non pas tant parce qu’elle prévoyait le non-emploi immédiat des armes nucléaires, mais parce qu’elle marquait à ses yeux un désengagement des États-Unis dans la défense de l’Europe.
McNamara raconte aussi comment, devant la multiplication des moyens nucléaires de l’URSS (en 1970, elle disposera de 1 800 têtes), il en était arrivé au cours des années 1964-1966 à proposer l’abandon de la stratégie « antiforces », qui était jusque-là celle des États-Unis au niveau stratégique, pour préconiser « avec un mélange d’angoisse et de résolution » l’adoption de la doctrine de la « mutual assured destruction ». Mais celle-ci se heurta d’abord à l’incompatibilité totale des concepts américains et soviétiques en matière de stratégie nucléaire, laquelle apparut clairement en 1967 lors de la rencontre entre le président Johnson et Kossyguine à Glassboro. L’Union soviétique n’accepta pas alors de renoncer au déploiement, qu’elle avait entrepris, de systèmes antimissiles, et pour cette raison les États-Unis décidèrent de se munir de têtes nucléaires multiples et guidées (MIRV). À la fin de son interview, McNamara fournit quelques précisions historiques sur les deux « événements les plus dramatiques de l’ère nucléaire », c’est-à-dire les crises de Berlin et de Cuba, que complète Dean Rusk, à la tête du département à l’époque, et que complétera plus loin Henry Kissinger.
Si nous avons insisté sur le premier chapitre de l’ouvrage de Michael Charlton, c’est qu’il est le plus riche en informations inédites. Son chapitre suivant traite de « la dissuasion par la détente », et par conséquent des accords sur la limitation des armes stratégiques (SALT) et ABM, dont les circonstances sont maintenant bien connues. Son interlocuteur y est Henry Kissinger, le principal auteur des accords en question, mais on y trouve aussi une intervention de Robert Perle, conseiller à l’époque du sénateur Jackson alors opposé à leur ratification. En définitive, conclut tristement Kissinger, « la détente ne dissuadera pas l’Union soviétique », puisqu’elle entreprendra de la défier en Angola, en Éthiopie, à Aden, au Vietnam, puis en Pologne et finalement en Afghanistan.
Le troisième chapitre, intitulé l’« alerte rouge », est consacré pour l’essentiel à une interview de Paul Nitze, l’expert éminent de la stratégie nucléaire américaine puisqu’il en a été un des principaux responsables dans toutes les Administrations depuis la guerre, exception faite de celle de Carter. Avec Eugène Rostov, qui partage ses idées, il explique comment il en est arrivé aux deux conclusions que, d’une part, les Soviétiques n’avaient pas adopté la stratégie de dissuasion mais celle de première frappe, et, d’autre part, que la recherche de la supériorité militaire poursuivie par eux à travers les Accords SALT devait être interprétée en termes plus politiques que militaires. Pour lui, l’idée que le Traité ABM reflète l’adoption d’une doctrine commune en la matière est un « parfait non-sens ».
Le chapitre qui suit est consacré pour l’essentiel à une interview du président Carter lui-même, appuyée par celles de Harold Brown, qui fut son ministre de la Défense, et du général Jones, président à l’époque de l’état-major conjoint. Carter y rappelle les espoirs qu’il avait mis dans des accords d’« Arms Control » avec les Soviétiques, qui auraient été beaucoup plus contraignants que ceux négociés par ses prédécesseurs, puisqu’il espérait aller jusqu’à l’interdiction totale des essais nucléaires et se fixait comme objectif final « l’élimination de toutes les armes nucléaires sur la Terre », comme il l’avait annoncé dans son discours inaugural. Après avoir justifié les déceptions qui suivirent, il s’explique, en en réduisant la portée, sur la « directive présidentielle 59 », qu’il signa en 1980, et qui fut interprétée à l’époque comme signifiant, ce qu’il conteste formellement, l’acceptation de l’éventualité d’une guerre nucléaire limitée et le renoncement à la doctrine de la « destruction mutuelle assurée », qu’il préfère appeler quant à lui « vulnérabilité mutuelle assurée ».
Le cinquième chapitre de l’ouvrage est consacré à l’époque contemporaine, et par conséquent pour l’essentiel, comme l’indique son titre, à la « défense dans l’espace », c’est-à-dire à l’Initiative de défense stratégique du président Reagan. Il comporte des interviews de personnages souvent entendus sur le même sujet, comme Edward Teller, George Keyworth, Gaspar Weinberger, Robert Perle, Fred Hoffman, le général Scowcroft, et il ne nous apporte donc rien de bien nouveau. Quant au dernier chapitre, il traite de la position de l’Europe vis-à-vis des États-Unis sur ce sujet. Son sous-titre, « Réconciliés parmi les étoiles ? », exprime par son point d’interrogation le scepticisme diplomatique avec lequel ont répondu aux questions de Michael Charlton ses interlocuteurs, qui s’appellent notamment Lord Carrington, Edward Heath, Maurice Couve de Murville, Helmut Schmidt. Dans son intervention, l’ancien chancelier de la République fédérale réitère ses réserves à propos du nucléaire et ses suggestions pour une coopération franco-allemande accrue dans le domaine militaire qui avaient fait sensation lorsqu’il les avança pour la première fois, alors que l’ancien Premier ministre du Royaume-Uni, rappelant sa conférence à Harvarden en 1967, se fait à nouveau l’avocat d’une coopération franco-britannique plus active en matière nucléaire.
Comme nos lecteurs l’auront sans doute perçu à travers ce rapide résumé, le livre de Michael Charlton est riche en informations sur les motivations des principaux acteurs de la politique nucléaire américaine, s’il ne nous apporte pas à proprement parler de révélations à ce sujet. Personnellement, il nous a intéressé surtout par la méthode qu’a employée son auteur, d’autant que nous la pratiquons nous-même dans nos recherches concernant la genèse de la politique nucléaire française. Nous pensons en effet, non sans rencontrer parfois quelques réticences de la part de l’université, que cette méthode est la seule qui permettra d’approcher la vérité dans l’histoire « intime » des événements de notre époque, puisque leurs acteurs n’entretiennent plus comme autrefois de correspondances personnelles avec leurs proches pour commenter l’actualité à laquelle ils participent, et que, par ailleurs, les documents officiels ne seront pas accessibles dans ce domaine avant longtemps, si même ils le deviennent lorsqu’ils sont couverts par le « secret-défense ». ♦