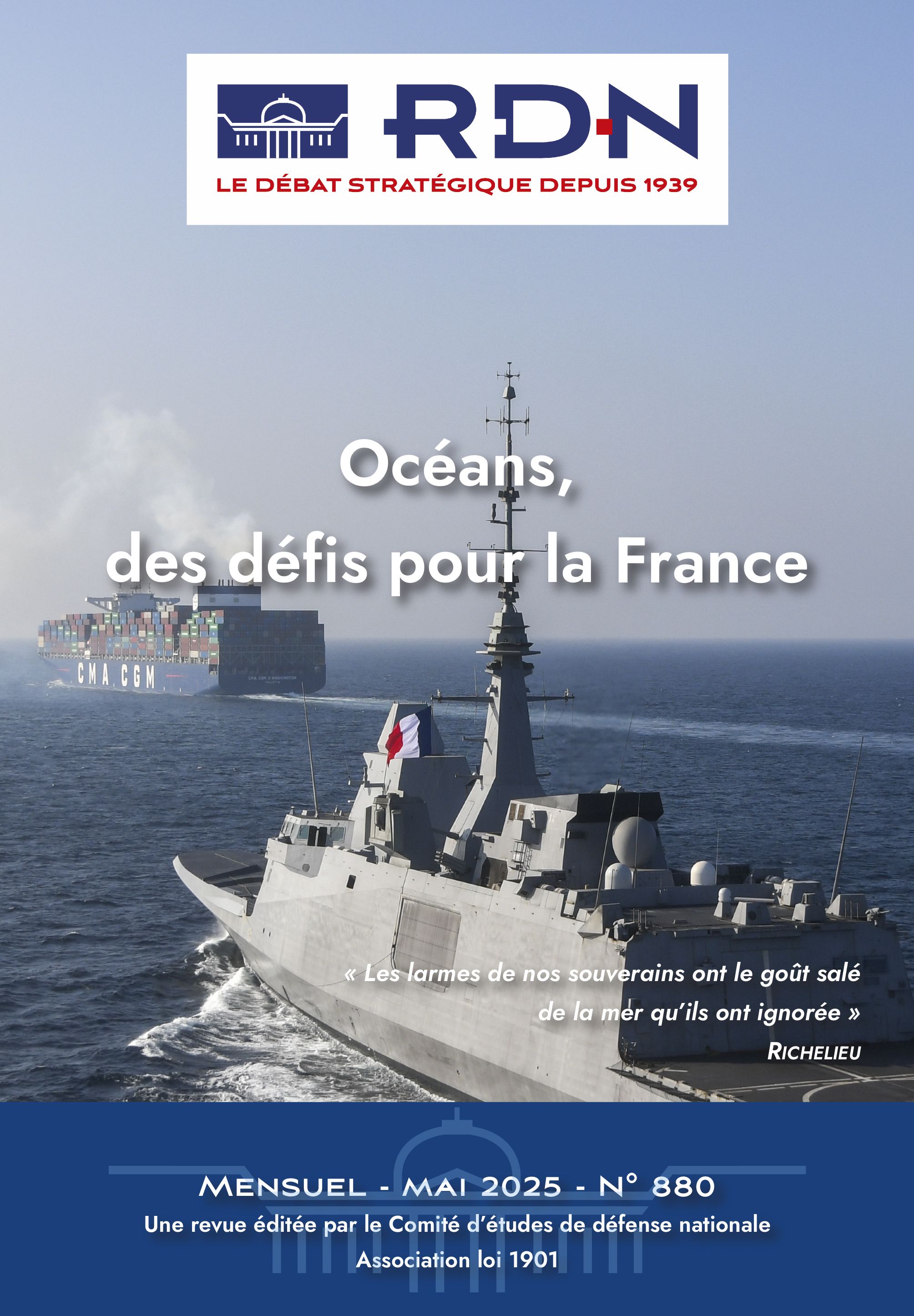Pétain
Dans une collection bien connue, qui va de Moïse à Staline, a paru un Pétain de Marc Ferro dont nous rendons compte tardivement, avec l’excuse d’avoir affaire à un sujet inusable.
Le héros tire une bonne part de son originalité du fait d’une notoriété acquise à 60 ans, d’un accès au pouvoir à 84 et d’une condamnation à mort à 89. L’auteur a pris le parti de se limiter (moyennant quelques retours en arrière) aux cinq années de vieillesse, d’éclat et de drame, en suivant la courbe en dos d’âne où la montée au Capitole précède la chute, et qui fut le lot de maints hommes d’État célèbres. Il décrit les événements chronologiquement, avec minutie et certainement la plus grande exactitude (un doute subsiste toutefois quant au franchissement de la Seine par les Allemands à Forges-les-Eaux – page 54 –, mais il est vrai qu’il ne s’agit pas d’un manuel de géographie !). Il met l’accent naturellement sur les trois périodes essentielles : 1940, du 16 mai, jour où l’ambassadeur de France à Madrid reçoit l’appel au secours de Reynaud, au 10 juillet, date du suicide de la IIIe République ; 1942, l’année de la valse-hésitation, lorsque le départ du maréchal eût pu faire basculer non pas le sort des armes, mais la condition des Français et son propre destin : 1944 enfin, quand un vieillard est enlevé au petit matin, une fois fracturée la porte de sa chambre de l’hôtel du Parc. Autour du personnage central évoluent : d’abord Laval, bien entendu, qui forme avec le maréchal un de ces couples où les partenaires sont « indispensables l’un à l’autre bien que ne pouvant se supporter » et qui, « surestimant ses dons, pense pouvoir rouler Hitler et Roosevelt comme les élus de son département » ; puis Darlan l’énigmatique, le fameux docteur Ménétrel, tout le petit monde de Vichy jusqu’aux ultras de la collaboration dont certains, tels Platon et Darnand, furent d’authentiques héros avant de subir le châtiment des traîtres.
Il n’est pas question ici pour nous d’entreprendre quelque résumé, œuvre vaine et sans signification. Marc Ferro confirme un certain nombre d’éléments de départ désormais indiscutables : l’affolement de la classe politique au cours de la débâcle ; la tentation d’arrêter les frais avant qu’il ne soit trop tard, de façon à conserver, grâce à des clauses d’armistice relativement généreuses, l’essentiel des structures et à faire reposer sur les ruines de la défaite, choc salutaire, les fondements d’une régénération analogue à celle de la Prusse après 1806 ; à cet effet, l’instauration d’un État fort, bâti selon une idéologie d’origine en grande partie maurrassienne, mais inspirée également par Salazar, et adoptée par nombre de milieux traditionnellement conservateur, séduits par la trilogie « travail, famille, patrie » ; les contacts antérieurs de Pétain avec des réseaux et des mouvements comme la « Cagoule », mais aussi sa prudence et sa répugnance vis-à-vis du coup d’État, ce qui semble exclure la préméditation ; enfin le goût du maréchal pour le pouvoir, sa verdeur et sa popularité initiale, servie par les souvenirs de la Grande Guerre comme par sa remarquable prestance.
Il semble que l’accord peut se réaliser tout autant sur les dominantes de la phase terminale : le détachement progressif de l’opinion à partir du tournant de la fin de 1942 ; la recherche d’une porte de sortie en direction des États-Unis, quitte à la payer d’un retour au parlementarisme ; les capitulations répétées devant les exigences allemandes croissantes ; le silence à Sigmaringen ; un procès controversé mené par des magistrats eux-mêmes compromis et dominé par la personnalité d’Isorni. C’est à mi-chemin que se situent les difficultés : la collaboration, voulue ou subie, camouflage ou moindre mal ? La dérive de la légion des combattants et surtout de son service d’ordre, marche vers le fascisme ou réaction aux actes de résistance ? L’indifférence du maréchal au sort des juifs, malgré les appels des évêques, réelle ou tactique ?
Alors, la vérité sur Pétain ? « Tout comprendre… », comme le souhaitait Fernand Braudel ? Vaste programme, et peut-être mission impossible. L’auteur, qui n’est pas un débutant, a travaillé six ans sur cette étude. Il a fait œuvre d’historien. De très rares commentaires défavorables en forme de coups de griffe ne sauraient suffire à le taxer de manque d’objectivité. Les citations sont légion et paraissent équilibrées. Des témoignages contradictoires sont mis côte à côte…
Mais n’y a-t-il pas, comme dans toute œuvre de ce genre, consciemment ou non, une façon personnelle d’ordonner les faits, de les grouper sous un titre, de couper des textes trop longs pour être reproduits in extenso ? Face aux 686 références indiquées en notes, n’en existe-t-il pas 686 autres qui ne disent pas forcément tout à fait la même chose ?
Marc Ferro se défend de juger. Il est conscient des risques encourus dans une telle entreprise. Il a accumulé dans cet ouvrage de fond une masse considérable de matériaux, de quoi condamner pour la « légende noire », de quoi absoudre pour la « légende rose ». La vérité est que nous nous trouvons devant un « secret de famille », d’une famille de millions de braves Français, dont quelqu’un a dit qu’ils ont la mémoire courte et parmi lesquels il existe beaucoup de survivants, vedettes, acteurs de second plan ou figurants. Le grand tort est finalement d’avoir perdu une bataille avant de faire semblant d’avoir gagné la guerre. Ce sont des mésaventures qui laissent toujours des traces. ♦