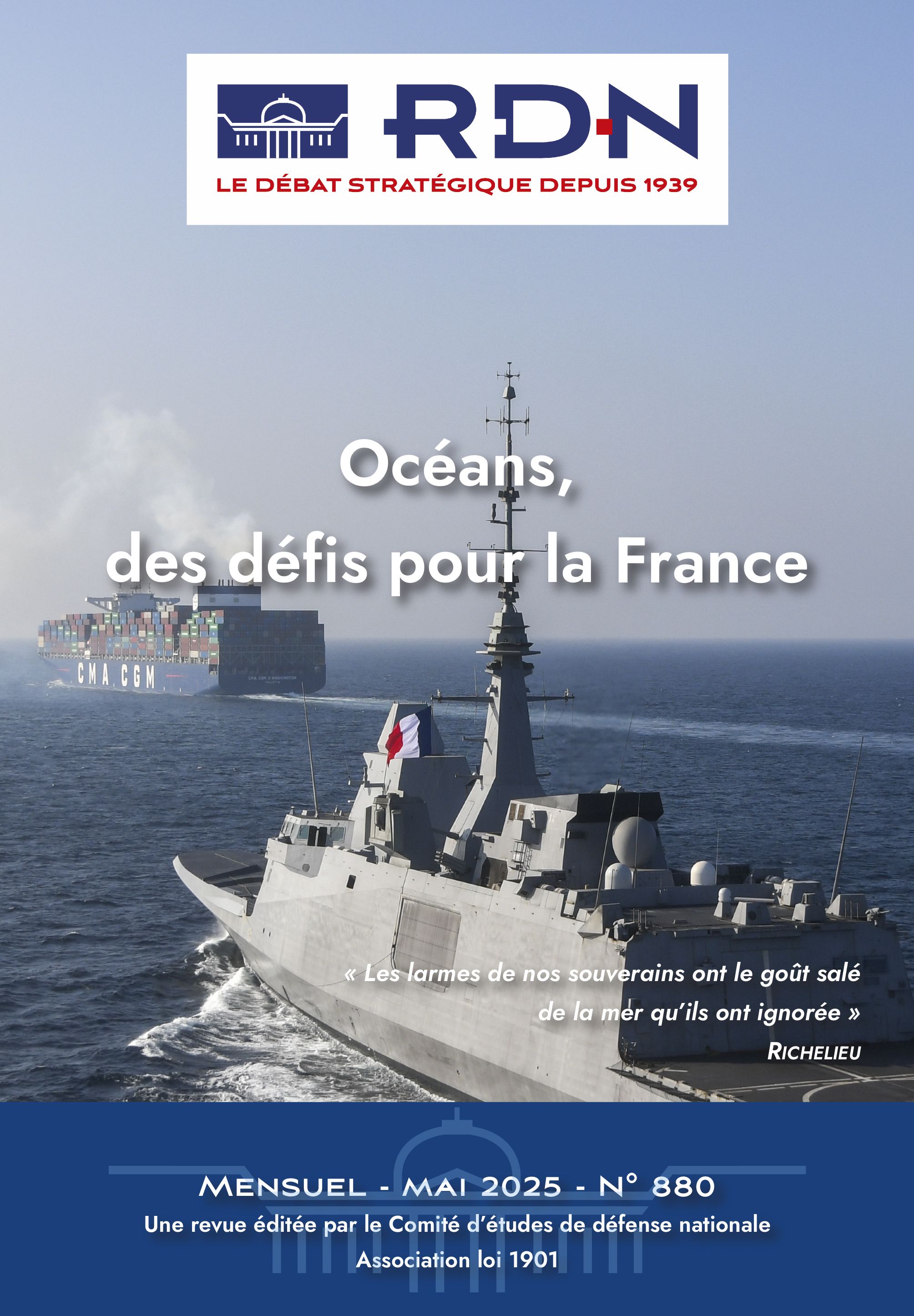La défense de l’Europe
Ce petit livre rassemble neuf communications qui ont été présentées, en septembre 1987, à un colloque de l’Association française pour la communauté atlantique. Tous convaincus de l’urgente nécessité d’une défense de l’Europe sans relâchement de la solidarité atlantique, les auteurs analysent les problèmes complexes que pose la construction de cette défense.
Pierre Gerbet, Jean-Thomas Nordmann et Guillaume Parmentier ouvrent le dossier des institutions, avec un excellent historique de leur évolution depuis le traité de Bruxelles jusqu’à la plate-forme de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) et à l’Acte unique. Ils soulignent en particulier, au-delà d’un consensus de façade, les désaccords qui subsistent sur les dépenses militaires, le nucléaire tactique et la stratégie générale. Abordant les problèmes économiques et industriels, C. Bourdeille et Christan Schmidt exposent les lenteurs de la coopération en matière d’armements, mais aussi les convergences qui s’établissent entre les projets du GEIP (Groupe européen indépendant de programme) et ceux du sénateur américain Sam Nunn. Les relations politiques font l’objet des prestations de Gregory Flynn et de Renata Fritsch-Bournazel. Le premier affirme la nécessité d’un partage des responsabilités par des États-Unis devenus moins puissants. La seconde nous montre une République fédérale d’Allemagne (RFA), pièce maîtresse de la sécurité européenne, partagée entre sa fidélité à l’Alliance, sa personnalité européenne et sa politique à l’Est ; face au refus de la réunification exprimé par Gorbatchev, la RFA s’efforce de rendre le mur plus perméable ; le resserrement des liens avec la France devrait l’inciter, en dépassant ses appréhensions nucléaires, à accepter une stratégie du faible au fort.
C’est la même voie que propose le général Méry, en esquissant un modèle stratégique qui comporte d’abord le réajustement du dispositif classique et une évolution de l’intégration vers une responsabilisation des États, ensuite le partage des armes nucléaires tactiques (françaises), enfin la constitution d’une force stratégique franco-britannique ; très argumentées, ces propositions sont précédées d’un examen des faiblesses et des obstacles à surmonter ; il démontre en particulier l’incompatibilité entre la construction d’une défense européenne et le maintien des concepts d’ultime avertissement et de non-participation à la bataille.
En conclusion, R. Girardet estime conciliables la souveraineté des États-nations, toujours vivants, et leur coopération en matière de défense. Inquiet de la valorisation dans l’opinion de l’idée de négociation et de la répudiation de la notion d’ennemi, il convie les Européens à refuser « une morale de la soumission qui tend ainsi à s’établir ». Pour dissiper cette inquiétude, et pour précéder les initiatives de l’adversaire, les Occidentaux ne devraient-ils pas se mettre d’accord sur un concept global, qui, liant défense et dialogue suivant le plan Harmel (1967), planifierait les garanties et les étapes d’une meilleure sécurité de l’Europe ? Cette question sort évidemment du cadre que s’étaient fixé les auteurs de cet ouvrage consacré à la défense de l’Europe, dont cette brève recension reflète imparfaitement la densité et la qualité des réflexions. ♦