À qui profite le djihad ?
À qui profite le djihad ?
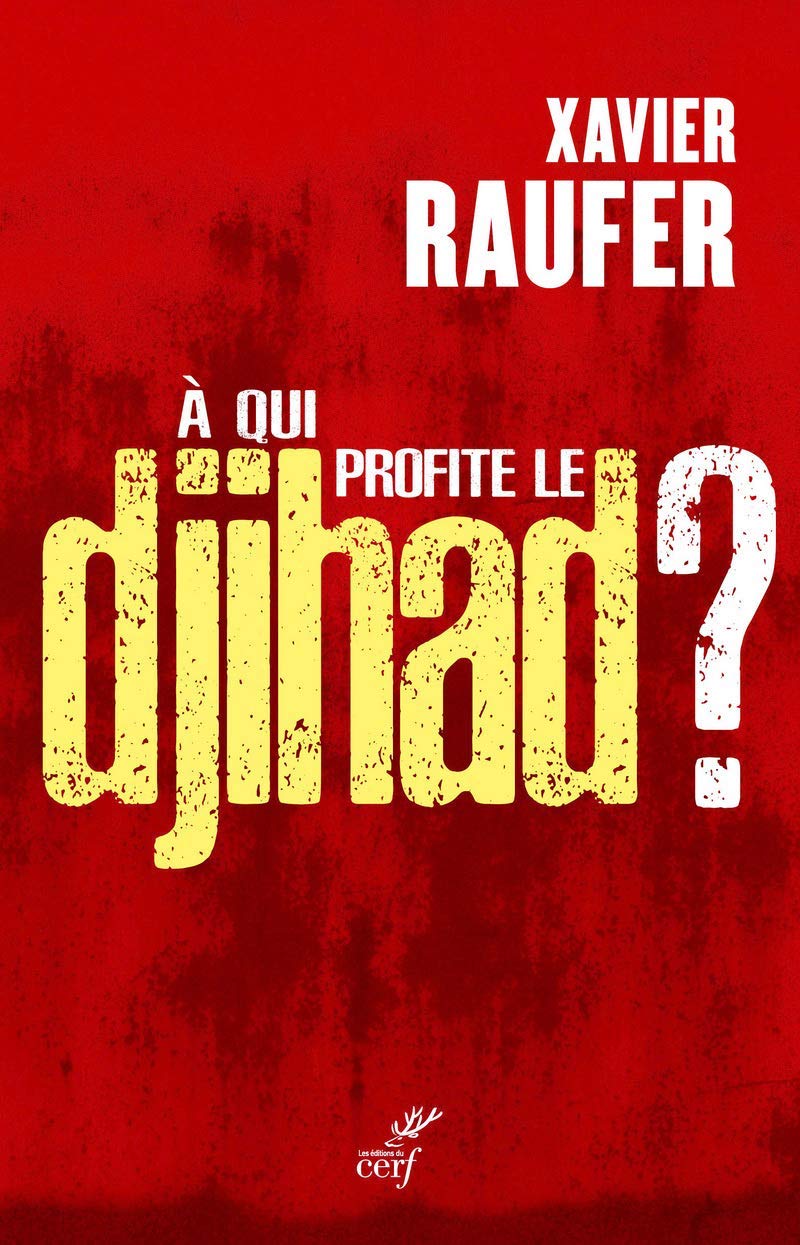 L’émergence de l’organisation qui s’est autoproclamée « État islamique » (ou plus succinctement ici EI) a donné lieu dès le début à des controverses sans fin. Née de la destruction, mal gérée, du régime de Saddam Hussein en 2003, et du licenciement des cadres du parti Baath et des membres de son armée, cette organisation a bénéficié initialement, on s’en souvient, d’une étrange mansuétude de la part de l’Administration américaine, laquelle en rendait responsable le « manque de souplesse » du gouvernement irakien à dominante chiite. Xavier Raufer ne s’inscrit pas ici dans cette ligne et ne s’intéresse guère dans son dernier ouvrage à la tolérance occidentale dont a bénéficié l’organisation, mais soutient la thèse selon laquelle l’EI aurait été aidé par le régime syrien à son début, en s’appuyant notamment sur le fait que lorsqu’elle s’engage en Syrie, il combat principalement les djihadistes du Front Al-Nosra (anciennement Al-Qaïda). Dans un livre conçu comme un « travail de déchiffrement des normes et règles stratégiques moyen-orientales » – ce qui en fait tout l’intérêt ; le spécialiste du terrorisme évoque également le rôle de l’Iran.
L’émergence de l’organisation qui s’est autoproclamée « État islamique » (ou plus succinctement ici EI) a donné lieu dès le début à des controverses sans fin. Née de la destruction, mal gérée, du régime de Saddam Hussein en 2003, et du licenciement des cadres du parti Baath et des membres de son armée, cette organisation a bénéficié initialement, on s’en souvient, d’une étrange mansuétude de la part de l’Administration américaine, laquelle en rendait responsable le « manque de souplesse » du gouvernement irakien à dominante chiite. Xavier Raufer ne s’inscrit pas ici dans cette ligne et ne s’intéresse guère dans son dernier ouvrage à la tolérance occidentale dont a bénéficié l’organisation, mais soutient la thèse selon laquelle l’EI aurait été aidé par le régime syrien à son début, en s’appuyant notamment sur le fait que lorsqu’elle s’engage en Syrie, il combat principalement les djihadistes du Front Al-Nosra (anciennement Al-Qaïda). Dans un livre conçu comme un « travail de déchiffrement des normes et règles stratégiques moyen-orientales » – ce qui en fait tout l’intérêt ; le spécialiste du terrorisme évoque également le rôle de l’Iran.
Raufer remarque tout d’abord que chacune des opérations terroristes conduites en Europe par des vassaux de l’EI émane du Moyen-Orient ou du Maghreb, et aucunement d’initiatives locales. Pour comprendre comment ces opérations s’agencent et s’articulent entre pays-sources et pays cibles, il faut donc comprendre les règles de la guerre au Moyen-Orient.
Au Moyen-Orient, nous rappelle Raufer, le terrorisme d’État « a pour intangible but d’appeler l’adversaire du moment à négocier ou évoluer » ; ce terrorisme-là, « malgré les discours et les gesticulations, ne vise au fond ni à punir, ni à venger ». Les termes « adversaire du moment » sont importants ici pour comprendre la stratégie indirecte qui régit l’« Orient compliqué » : « l’ennemi (pour l’instant) de mon ennemi (actuel) est mon ami (temporaire). Avec ce dernier, l’alliance d’intérêt mutuel est limitée et réversible à tout instant ». Les kataeb djihadistes ont ainsi coutume de changer d’allégeance, un peu comme les grandes compagnies du Moyen Âge ou les lansquenets, évoluant comme eux dans « les eaux glacées du calcul égoïste » (Marx).
Quelle est donc la nature de cet « État islamique, objet terroriste non identifié » ? Pour l’auteur, « l’État islamique est clairement une armée mercenaire. Ce n’est ni une rébellion, ni une guérilla, moins encore un groupe terroriste », d’où cette question fondamentale : « au service de qui est l’État islamique ? » ou plutôt « qui sait influencer cette machine dans le sens de ses intérêts propres ? ». Au Moyen-Orient, nous explique Raufer, « toute émergente entité paramilitaire ou terroriste ne survit que si elle obtient le support d’un des États de la grande région, voire au-delà ; sinon, elle disparaît ». Il considère que depuis 1975 et le début de la guerre civile libanaise, ce « théorème » s’est toujours vérifié.
Tous les dirigeants au sommet de l’État islamique sont issus de l’armée irakienne ou du parti Baath. Sous Saddam Hussein, la plupart n’étaient d’ailleurs même pas musulmans pratiquants. Beaucoup d’entre eux se sont retrouvés ensuite dans les camps ou les prisons américaines de 2003 à 2009 après la suppression de l’armée irakienne et du parti Baath. Le créateur de l’EI, surnommé Haji Bakr, connu comme nationaliste, mais aucunement comme islamiste, est un ancien colonel de cette armée. Abou Omar al-Baghdadi, choisi comme « calife » par l’organisation, ne serait en réalité qu’un pantin destiné à donner une caution religieuse à un mouvement dirigé par d’anciens officiers. Lorsque Haji Bakr fut tué en janvier 2014, lors de l’attaque de sa base par un groupe de rebelles, aucun coran n’a été découvert lors de sa fouille, ce qui confirmerait le rôle secondaire de la religion. Pour l’auteur, dans une première phase de la guerre civile en Syrie, Damas et l’EI s’entraident : « l’aviation du régime bombarde les rebelles pour soulager l’EI, qui jette en retour ses commandos suicides sur les dirigeants de la rébellion, mais laisse en paix l’armée syrienne ». Les choses changent après la conquête de Mossoul en juin 2014. L’EI y récupère un énorme arsenal et prend son indépendance.
Parallèlement, le programme de soutien aux « rebelles modérés » en Syrie, lancé en 2012, coûte à la CIA 5 milliards de dollars entre 2012 et 2016. C’est le programme clandestin le plus cher de l’histoire de la Centrale. Le tout pour un résultat nul. À la fin, des dizaines de véhicules blindés américains finiront dans d’autres mains. La priorité change en 2016. Il s’agit désormais pour les États-Unis de vaincre l’État islamique et non plus de renverser Assad. De même, jusqu’en 2014, le financement de l’État islamique par l’Arabie saoudite est indéniable. L’attitude de Riyad change alors à la suite des récriminations européennes et américaines.
Si, comme le soutient Raufer, Assad a sans doute instrumentalisé l’EI (contre une opposition djihadiste armée, il faut le rappeler) et s’il est possible aussi que l’Iran ait constitué à un moment la base arrière d’Al-Qaïda, il nous semble par contre que tous les États de la région, et d’autres, en ont fait de même dans le cadre de la stratégie indirecte excellemment décrite par l’auteur plus haut. Ils ne sont hélas guère évoqués ici. Quid en particulier de la Turquie, dont le rôle fut pourtant capital dans l’approvisionnement de l’EI en hommes, en munitions et dans l’exportation du pétrole syrien exploité par cette organisation ? Et de celui du Qatar dans le financement du djihadisme ? Quid des États-Unis, dont Maxime Chaix avait révélé le jeu trouble dans son livre Guerre de l’ombre en Syrie ?
On peut par contre porter au crédit du livre une excellente analyse des relations entre la Syrie, l’Irak et l’Iran, et un fort intéressant chapitre sur les Alaouites, ou Nosaïrites, et leurs liens (fort minces d’ailleurs) avec le chiisme.
On retiendra également du dernier livre de Xavier Raufer un certain nombre d’interrogations sur les « failles » du renseignement occidental s’agissant de « ces activistes fanatisés (qui) parcourent l’Europe ; certains connus depuis près de vingt ans pour contacts avérés avec ce que le djihadisme fait de plus dangereux, sans être le moins du monde repérés ni signalés par la coordination européenne et les entités qui l’alimentent ». On appréciera de même une lumineuse exposition de la stratégie indirecte en œuvre dans cet « Orient compliqué », en contraste avec « la constante incapacité de Washington – Big Data ou pas, intelligence artificielle ou non – à concevoir tout jeu géopolitique à plus de deux acteurs ; ce, par distribution arbitraire jusqu’à l’absurde, des rôles de “gentils” ou “méchants” ». ♦







