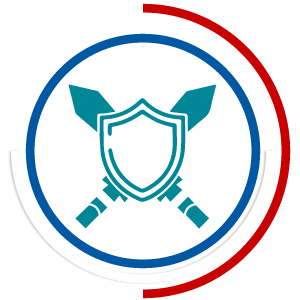Allocution du président de la République devant les auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) le 11 octobre 1988.
Discours à l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)
Mesdames et Messieurs,
Responsables civils et militaires et personnes ici présentes venues d’horizons très divers, vous avez choisi de réfléchir et de travailler sur ce sujet essentiel : la défense, la sécurité de la France.
Chef de l’État, chef des armées, je souhaite rappeler devant vous, car c’est une mission qui m’incombe, les grandes lignes de notre politique de défense. Au-delà de vos personnes, je m’adresse bien entendu à ceux qui ont à prendre part à quelque niveau que ce soit à notre sécurité.
La stratégie
Je poserai d’abord ces deux questions : que veut la France ? Autour de quels objectifs majeurs organise-t-elle son action ?
Que veut la France ? Notre pays ne nourrit, vous le savez, aucune ambition territoriale. Elle n’a pas de raison de vivre autrement qu’en harmonie avec les autres. Mais des menaces peuvent exister.
Chacun n’a pas les mêmes sentiments. Or, la France est une nation libre et elle entend se déterminer par elle-même, décider de son mode de vie et des voies de son avenir. Elle veut pouvoir se défendre face à toute agression. Le premier objectif de notre défense sera donc de maintenir notre identité et notre indépendance. J’ajouterai que cette indépendance ne peut elle-même être assurée que si nous conservons, pour préserver nos intérêts vitaux, notre autonomie de décision. J’y reviendrai dans un moment.
Certes, et cette remarque est capitale, nous faisons partie d’une alliance et nous sommes solidaires de nos alliés. Ils sont en droit d’attendre de nous notre concours en cas de danger, d’agression, comme nous sommes en droit d’attendre le leur. Mais la décision à prendre dépend de nous et de nous seuls. C’est ce qui autorise à définir notre stratégie, comme une stratégie autonome de dissuasion, plus précisément de dissuasion nucléaire. J’expliquerai un peu plus loin la portée de ces termes.
Puisque j’ai parlé d’alliance, et que cette alliance est l’Alliance atlantique, je précise tout de suite que notre autonomie de décision se définit particulièrement à l’égard des organes militaires intégrés de l’OTAN. Cessons, je vous prie, toute spéculation à ce sujet. Il n’est pas question pour nous de changer de statut. Cela n’interdit pas les relations d’ordre militaire au sein de l’Alliance. Ces relations sont multiples, elles sont constantes et, je le crois, confiantes. J’entends les développer autant qu’il le faudra. Je n’oublie pas ce que nous devons au premier de nos alliés, les États-Unis d’Amérique. Mais rien ne peut empiéter sur le pouvoir de décision qui demeure propre à la France et dont le président de la République est seul à disposer.
Sur l’Alliance, beaucoup de notions confuses se répandent, et l’une d’entre elles m’oblige à apporter la précision suivante. L’Alliance atlantique comporte des limites géographiques. Lorsque l’on souhaitait survoler notre territoire pour aller bombarder la Libye, sans que nous connaissions exactement les objectifs visés et bien que la Libye fût alors en guerre avec le Tchad, où nous étions nous-mêmes engagés, nous avons dit non, et pas simplement pour rappeler une règle d’or.
De même, aux conférences au sommet des sept pays industrialisés, point depuis quelque temps le thème d’une sécurité globale qui lierait quasi automatiquement les pays de l’Alliance atlantique et le Japon. Certes, nous devons porter la plus grande attention aux problèmes qui se posent là-bas. Nous pouvons, le cas échéant, nous devons proposer — accepter — certaines formes actives de solidarité. Mais cela dépend de nous, non de l’Alliance.
Je reviens sur les objectifs de notre stratégie. D’abord, ai-je dit, assurer notre indépendance ; j’ajoute, défendre notre identité. La France est une démocratie qui croit en ses principes. Elle n’a pas l’intention de se lancer dans des conflits de caractère idéologique. Mais elle n’a pas l’intention non plus d’avoir à supporter des pressions extérieures, qui viseraient à transformer notre mode de vie intérieur ou à nous faire adhérer à des systèmes qui nous paraîtraient condamnables. Il est d’autant plus opportun de l’affirmer que nous allons fêter le deuxième centenaire d’un événement, la Révolution de 1789, qui a, me semble-t-il, quelque rapport avec cette déclaration.
La France a aussi un rôle à jouer dans la sauvegarde de la paix du monde et dans l’équilibre de l’Europe. Rappelons qu’elle est l’un des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité. Dans un moment, j’aborderai certains aspects spécifiquement européens ou plus encore spécifiquement franco-allemands. Mais je répète dès maintenant que nous avons un rôle à jouer dans l’équilibre du monde et particulièrement de l’Europe. Tout découle de l’idée que nous nous faisons du rôle de la France en Europe. Nous sommes membre de la Communauté et nous y participons pleinement. Rien ne nous paraît plus important que de réussir cette entreprise. Mais nous n’avons pas à négliger notre politique vis-à-vis de l’Union Soviétique et de l’Europe de l’Est. Solidaires de nos alliés, nous n’en avons pas moins une histoire et donc une politique et une diplomatie qui nous sont propres là comme ailleurs. Nous devons toujours considérer l’Europe tout entière dans sa réalité géographique et historique.
Enfin, nous avons des obligations hors d’Europe. Notre pays est lié par des accords de défense à un certain nombre de pays africains. Pudeur ou prudence, on ne dit jamais lesquels et combien. Mais tout le monde sait que l’on en compte une dizaine. En fait, ces accords ont eu très rarement à jouer, bien que le premier acte que j’ai dû accomplir en 1981 ait été de fournir une aide au Cameroun dans une situation qui pouvait devenir délicate.
Avec le Tchad, le paradoxe veut qu’il n’existe pas de convention de ce type. Il y en avait une. Elle a été dénoncée en 1976. Nous sommes cependant intervenus en 1983, bien que rien ne nous y obligeât, simplement parce que l’appréciation du rôle de la France dans cette partie du monde, à l’égard de nos amis d’Afrique noire, surtout francophones, nous créait un devoir que nous avons rempli. Aujourd’hui la paix prévaut au Tchad et la France n’y est pas pour rien.
J’ai évoqué les objectifs de notre défense d’une façon très schématique, telle est la loi du genre. Il va de soi que si ces objectifs sont permanents, les moyens en sont variables ; d’abord en s’adaptant, même si cette considération paraît très prosaïque, aux ressources économiques et financières de la nation, aux crédits dont elle dispose, c’est-à-dire à la marche générale des affaires.
Il n’y a pas de défense solide sans économie saine. Le déséquilibre économique et budgétaire contrarierait notre défense, compromettrait notre sécurité. La nation consent pour le budget militaire des sacrifices importants au détriment d’autres secteurs. Non seulement, cela doit être accepté mais cela doit être proclamé, à la condition de garder le bon sens nécessaire et de savoir distinguer ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas l’être. L’essentiel est que nos moyens de défense collent à la nature des menaces en même temps qu’à l’évolution des techniques.
Pour revenir à l’essentiel, notre stratégie est et reste fondée sur la dissuasion nucléaire. En quoi consiste cette dissuasion ? J’aperçois ici et là tellement de contresens que mieux valent les définitions simples. La dissuasion consiste à empêcher tout agresseur — éventuel — de s’en prendre à nos intérêts vitaux à cause des risques qu’il encourrait. La dissuasion n’est pas faite pour gagner la guerre, elle est faite pour l’empêcher, la prévenir. Il reste à maintenir nos forces en situation de « suffisance » — en quantité, en qualité, en performances —, afin d’être en mesure d’infliger à l’agresseur des dégâts pour le moins équivalents à l’enjeu que nous représentons. Notre force nucléaire peut, hypothèse tragique mais qui sert de base à notre raisonnement, détruire un territoire à portée de 4 000 kilomètres sur une superficie pour le moins égale à celle de notre propre territoire. Quel intérêt, pour quiconque, d’attaquer un pays comme le nôtre qui, après une guerre nucléaire, connaîtrait un épouvantable dommage tandis que l’agresseur en supporterait tout autant ?
Notre capacité nucléaire représente environ 2 % du total des forces nucléaires mondiales. Mais elle suffit pour remplir l’office que nous lui attribuons. Si l’arsenal des autres est surabondant, le nôtre n’a pas à l’être. Nul ne nous attaquera dès lors que nous resterons au-dessus du seuil de crédibilité.
Vous savez que la force nucléaire française comporte trois composantes. Ces composantes, sous-marine, terrestre, aérienne, forment un tout. Nous modernisons en priorité nos sous-marins nucléaires lance-engins, la composante principale, leurs armes, leurs plates-formes et leurs transmissions afin qu’ils conservent leur invulnérabilité. Nous tentons de devancer les progrès de la détection. On constate que les progrès de la défense contre la détection vont aujourd’hui de pair, observation qui ne nous tient pas quitte d’une vigilance extrême.
Quoi qu’il en soit, nous avons à diversifier notre panoplie stratégique parce que les percées technologiques en tous domaines sont si rapides et si soudaines qu’il convient de se prémunir. C’est pourquoi nous renforcerons notre composante terrestre, celle du plateau d’Albion. À ce sujet, s’est ouvert un débat. Albion, n’est-ce pas trop fragile, trop exposé ? La force qui s’y trouve ne risque-t-elle pas d’être détruite avant tout autre déclenchement d’une guerre nucléaire ? À cette question, légitime, ma réponse est qu’il faut moderniser Albion, durcir notre dispositif. Cela fait partie des sujets que le Premier ministre et le ministre de la Défense auront à débattre avec les états-majors. Pour quel missile ? J’écouterai avec la plus grande attention les conseils qui me seront donnés.
La détermination de la France doit être connue sans doute possible. Une attaque sur Albion signifierait que nous serions déjà dans la guerre, la guerre nucléaire. Par là même, le déclenchement de nos forces stratégiques serait instantané. Nous n’aurions pas le temps de philosopher. Nous serions dans la guerre, avec toutes les conséquences que cette situation supposerait. Cela, il est important que les autres puissances nucléaires le sachent.
Certains ont imaginé, il y a quelques années, d’organiser à terre, la mobilité des fusées afin qu’elles échappent à l’observation étrangère. Les États-Unis d’Amérique examinent pour eux-mêmes ce déploiement aléatoire, mais la superficie du territoire français n’est pas telle que nous en tirerions avantage. Je l’exclus.
Quant à la composante pilotée, l’état-major réfléchit aux différentes formules qui permettront de la développer. Dans tous les cas, nos ingénieurs et nos chercheurs ont pour mission de mettre le pays à l’abri de tout bouleversement technologique. Le missile air-sol moyenne portée vient d’entrer en service dans la force aérienne tactique. Il sera bientôt sur le porte-avions Foch. Une précision sur ce point s’impose : les armes préstratégiques, terme qui a été finalement préféré à celui d’armes tactiques, et armes stratégiques concourent ensemble à la dissuasion. Elles ne sont pas séparables. La dissuasion forme un bloc, un bloc dont on ne peut distraire tel ou tel type d’arme nucléaire. Ne répétons pas la tragique erreur commise face à l’invasion hitlérienne en Autriche : « Jusqu’ici mais pas plus loin ». C’est le langage de la faiblesse. Si l’on accepte que l’ennemi aille jusqu’ici, on acceptera qu’il aille plus loin !
Les armes préstratégiques ne sont pas destinées à prolonger les armes conventionnelles. Elles se placent par définition au début du processus nucléaire. Elles n’ont pas à devenir des armes de théâtre ou de champ de bataille, aucune ambiguïté n’est permise là-dessus. D’où la notion de l’ultime et unique avertissement. Il peut y avoir des avertissements de toutes sortes, diplomatiques ou politiques. Mais il ne peut y avoir qu’un avertissement nucléaire, l’ultime.
Bien entendu, l’ultime avertissement ne pourrait être délivré que sur des objectifs strictement militaires. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’utilisation du Hadès. Nous pourrions aussi mettre en œuvre l’arme à neutrons ou à effets collatéraux réduits. Pourquoi pas, si cela servait notre défense ? La fabrication de cette arme dépend de ma décision. J’ai voulu que nous fussions en mesure à tout moment de la produire. Mais j’entends en apprécier le moment, l’opportunité. Et je pense que rien ne doit être fait qui contrarierait le mouvement actuel vers le désarmement. Il n’appartient pas à la France de compliquer la situation présente.
Je veux simplement, à ce propos, rappeler le principe que j’ai fixé : nous ne nous priverons, si nous en avons les moyens technologiques et financiers, d’aucun type d’armes qui serait détenu par les autres puissances. Ce raisonnement vaut pour le Hadès. Il vaut pour l’arme neutronique. Si l’on m’objecte : « Alors, on a une armée pour ne pas s’en servir », je réponds : « Oui. Pour ne pas s’en servir ». Et j’insiste : « Il n’y a pas de contradiction entre le caractère de non-emploi de notre stratégie nucléaire et la nécessité d’être à tout moment prêt à mettre en œuvre les armes de dissuasion ».
Nos soldats le comprennent.
L’éloge le plus vif que l’on puisse adresser à notre armée est qu’elle a su préserver sa disponibilité, son moral, alors qu’il lui était demandé de se préparer à un conflit pour qu’il n’ait pas lieu. C’était plus simple naguère lorsque l’ambition du soldat était d’aller sur le terrain pour en découdre au service de son pays.
J’en arrive à nos armes classiques. Elles sont complémentaires de l’arme nucléaire. Parmi leurs missions, les forces conventionnelles ont celle d’empêcher le contournement du dispositif nucléaire. Notre corps de bataille aéroterrestre souligne la solidarité qui nous unit à nos alliés. Nos forces de combat aériennes, terrestres, en liaison avec nos forces navales, assurent en certains points vitaux du globe une présence dont l’importance est reconnue par tous. Sous tous les cieux, au Liban, dans le Golfe, au Tchad en particulier, nos trois armées — sans oublier la gendarmerie — ont donné le meilleur d’elles-mêmes dans des conditions souvent très difficiles. Elles ne valent que par ceux qui les servent et à tous les niveaux. Leur moral tient au sentiment qu’ont nos soldats que la nation les aime et les respecte et qu’elle remplit à leur égard les obligations morales et matérielles qu’elle leur doit.
Un mot encore : je n’ai pas parlé de la défense civile qui, cependant, me tient à cœur. Si l’on aborde ce sujet, j’entends l’objection : un pays dont la stratégie est d’interdire la guerre paraîtrait douter du bien-fondé de ce choix s’il creusait des trous et construisait des abris pour s’en protéger. Mais je vous invite à vous méfier de ce sophisme. Je souhaite que la défense civile s’organise. J’avais recommandé, voici quelques années, que pour toute construction publique nouvelle de quelque importance fussent prévus des abris antiatomiques. Je demande que ces directives soient réitérées et appliquées.
Le désarmement
Après le rappel de notre stratégie, je veux vous dire les raisons de mes choix en faveur du désarmement. Vous savez que j’ai approuvé, dès qu’elles ont été exprimées, les propositions russo-américaines résumées par l’expression « option zéro », qui consistait dans l’élimination, la destruction des forces nucléaires intermédiaires sises en Europe, c’est-à-dire les fusées dont la portée va de 1 000 à 5 000 kilomètres et plus. J’ai approuvé de la même manière l’option dite « double zéro » qui, elle, visait les armes nucléaires de moins longue portée, 500 à 1 000 kilomètres. Pourquoi ? Parce que je considérais — et je considère toujours — que l’un des événements majeurs de l’après-guerre mondiale, et pour la première fois depuis l’avènement de la guerre atomique, était que les deux plus grandes puissances avaient enfin consenti à désarmer.
Sécurité collective, arbitrage, désarmement, cette trilogie déjà ancienne a valeur pour moi de principe. Raison de plus pour approuver sans aucune réserve l’accord de Washington. Le fait majeur, le fait nouveau est que cet accord organise un contrôle réciproque sur le territoire de chacun. Dans l’histoire du désarmement, ce pas franchi est décisif.
On s’est plaint dans différents milieux de l’absence de la France — et, au-delà, de l’Europe — à la table de négociation. Moi, je m’en suis réjoui. La négociation sur les armements nucléaires doit rester longtemps encore russo-américaine. Ce qui ne nous empêche pas d’exprimer nos avis.
Aux Américains et aux Russes, nous avons à dire : défaites d’abord ce que vous avez fait. Réduisez considérablement votre surarmement. Après, on verra. Si l’on avait invité, dans la phase actuelle, la France à prendre part à la discussion, j’aurais refusé. Comment, présents, aurions-nous pu empêcher que l’on intègre à la discussion l’armement nucléaire français ? Quant à l’Europe, soyons sérieux. Seules la Grande-Bretagne et la France possèdent l’arme atomique. L’Europe n’est pas prête à prendre la relève. Au demeurant, nous n’avons pas de force nucléaire intermédiaire — seul objet de l’accord de Washington —, et les armes à très courte portée ne sont pas à l’ordre du jour d’une négociation.
À Reykjavik, MM. Reagan et Gorbatchev ont imaginé le jour où le désarmement serait total et où disparaîtraient les armes nucléaires. Le rêve reste lointain, car chacune des deux superpuissances possède aujourd’hui quelque 12 000 charges nucléaires stratégiques. De quoi détruire plusieurs fois — si je puis ainsi m’exprimer — toute vie sur la Terre, alors que nous, nous ne disposons que de quelques centaines de têtes. On comprend pourquoi j’ai énoncé devant l’Assemblée générale des Nations unies, en 1983, les conditions à remplir par les deux grands partenaires pour que nous participions à la négociation.
Premièrement, réduire leurs arsenaux stratégiques à des tailles comparables à la nôtre.
Deuxièmement, arrêter les surenchères antimissiles, antisatellites et anti-sous-marins.
Troisièmement, corriger les déséquilibres conventionnels. J’y viens.
Si la nature spécifique de l’arme nucléaire, en effet, permet de dissuader un agresseur plus puissant, il n’en va pas de même dans le domaine conventionnel où la sécurité exige un équilibre global des forces.
Le raisonnement est différent parce que la nature des armes est différente. En Europe, un nouvel équilibre conventionnel est nécessaire, à la frontière des deux Allemagnes, comme à la frontière de l’Allemagne fédérale et de la Tchécoslovaquie, en raison des dangereuses et inquiétantes asymétries qui y prévalent au détriment de l’Occident.
Sur ce point, de retour, cinq ans après, aux Nations unies, j’ai avancé plusieurs propositions. D’abord, dans la zone où l’Est et l’Ouest se font face, réduire et déconcentrer les troupes et les matériels — engins blindés, artillerie, matériels de franchissement, etc. —, afin d’interdire la possibilité de toute attaque surprise.
Deuxièmement, limiter les réserves et les stocks pour empêcher une guerre prolongée.
Troisièmement, plafonner les forces d’un seul pays au regard de l’ensemble dans certaines zones, établir une proportion stricte entre les matériels militaires nationaux et les matériels étrangers.
Enfin, élaborer des procédures de contrôle et de vérification.
J’ajoute ici une notion que je n’ai pas développée à New York : rester très attentif à la modernisation des armes conventionnelles. En effet, modernisées, les armes conventionnelles pourraient atteindre une telle capacité de destruction que l’élimination des armes nucléaires ne remplirait pas son objet.
Quant à la dimension spatiale d’une politique de défense, je demande que l’on cesse de confondre les missions de vérification et d’observation par satellites, militaires ou civils, initiative souhaitable, et l’introduction d’armes dans l’espace, initiative regrettable : armer l’espace, c’est-à-dire étendre et reporter plus loin, plus haut, la course aux armements contenue à si grand-peine sur la planète est une démarche à proscrire. C’est dans cet esprit que j’ai refusé toute participation de la France à l’Initiative de défense stratégique. Je n’engagerai pas notre pays dans cette voie.
J’en viens enfin aux armes chimiques, à la prolifération des armes chimiques, à la banalisation de leur emploi. Vous savez que, le 29 septembre dernier, j’ai apporté mon soutien à la proposition du président Reagan de réunir à Paris les 110 pays du protocole de Genève qui date de 1925, dont la France est dépositaire, et qui interdit l’emploi des armes chimiques et bactériologiques.
Cette conférence de Paris sera la bienvenue et répond à nos vœux, mais il convient de la préparer avec soin, de s’entendre sur son ordre du jour. Pour cela, il faut prendre le temps nécessaire. Mieux vaut ne pas tenir de conférence qu’échouer. Les prévisions pour décembre sont sans doute trop optimistes. Ce qui ne m’empêche pas de souhaiter aller vite. Les travaux menés à Genève devraient nous y aider, sans que leur conclusion puisse constituer un préalable. L’objet de cette conférence de Paris sera de réaffirmer solennellement l’engagement de non-emploi, de prévenir la prolifération, de susciter de nouvelles adhésions, d’améliorer les procédures d’enquête, enfin de marquer une volonté commune de voir aboutir les travaux actuellement menés à Genève dans le cadre de la conférence de désarmement.
Aux Nations unies, j’ai demandé que l’on ne se contente pas d’interdire l’emploi de l’arme chimique, mais aussi sa fabrication, ce qui allait plus loin que les propositions de M. Reagan. L’Union Soviétique dispose de stocks importants. Les États-Unis tentent, à vive allure, de rattraper leur retard. Nous sommes, en France, très loin du compte. Cela dit, je ne pense pas qu’il soit raisonnable d’arc-bouter la France sur une position intenable qui la verrait continuer de fabriquer des armes chimiques quand les autres auraient cessé. Aussi respecterons-nous scrupuleusement les termes de la convention dès que celle-ci sera entrée en vigueur. Une exemption en entraînerait d’autres et la course, qu’il s’agit précisément d’arrêter, repartirait.
Précaution supplémentaire : pendant la période qui précédera la destruction complète des armes chimiques, usines et stocks devraient être placés sous contrôle international avant que les usines elles-mêmes soient détruites.
Là encore, la difficulté principale sera celle d’un contrôle réel, plus difficile en ce domaine qu’en tout autre. Un laboratoire est aisément dissimulable, les matières utilisées aussi. Cela conduira à des précautions particulièrement rigoureuses et, de ce fait, malaisées à obtenir.
La défense commune de l’Europe
Je veux, pour terminer, vous entretenir de la défense commune de l’Europe.
Interrogeons-nous.
Comment construire l’Europe économique, technique et politique sans construire l’Europe de la défense ? Mais comment construire l’Europe de la défense sans avoir construit l’Europe politique ? Le serpent se mord la queue ! Les discours généreux inondent la scène publique. Mais ils restent vagues. Qu’en est-il ? La défense de l’Europe, je suis pour, je la veux. J’en cherche patiemment les chemins, mais j’en vois aussi les obstacles. Et c’est par la lucidité que nous atteindrons notre but.
Je note, en premier lieu, la différence de statut des douze pays de la Communauté. Seules la France et la Grande-Bretagne détiennent l’arme nucléaire. Encore la France dispose-t-elle, et non la Grande-Bretagne, d’une décision autonome. L’Allemagne, elle, conséquence de la dernière guerre mondiale, ne peut accéder à ce type d’armement. Elle ne le demande d’ailleurs pas. Cette différence de statut entraîne des différences d’approche. L’Irlande est neutre. La Grèce obéit à d’autres critères que nous. Le Danemark a des traditions, une Constitution qui l’éloignent de nos perspectives. Avec la Grande-Bretagne, nous entretenons des relations cordiales, mais lorsqu’il s’agit d’armement et de défense commune, la conversation en reste là. Après Reykjavik, j’ai vu Mme Thatcher s’interroger. L’option européenne semblait se rapprocher. On en est resté là.
L’UEO, l’Union de l’Europe occidentale, est un forum et un forum utile. On s’y rencontre. On s’y concerte. On ne décide pas. L’Espagne en est absente, quoique son engagement européen soit très ferme. Certains de nos partenaires ne montrent pas d’enthousiasme, c’est le moins qu’on puisse dire, pour qu’elle se joigne aux sept pays qui en sont déjà membres. Bref, l’UEO a besoin d’être réformée si elle veut répondre à l’attente de beaucoup.
Et l’armement ? Certes, le groupement européen des industries de programme et d’armement travaille. Les discours y sont valeureux. Mais pour quel résultat ? Y a-t-il un avion européen ? Deux sont en projet. L’un qui regroupe quatre pays. Il est lourd, il est cher, beaucoup plus cher que le nôtre, qui coûte déjà très cher, et il ne remplit pas la même mission stratégique. Des confidences laissent entendre que certains des quatre partenaires trouvent la note lourde. La France, de son côté, fabrique le sien, le Rafale ; elle serait heureuse d’un arrangement, mais n’en cultive pas l’illusion. Elle emploiera donc le Rafale, dont tout laisse penser qu’il fournira à nos armées un remarquable instrument.
L’échec des conversations pour un avion européen accepté par tous a largement dépendu des industriels fort peu enclins à trouver un accord, y compris en France. Une vraie politique de défense européenne devra passer par-dessus ce primat. Toute décision est politique. Faute de quoi, rien ne se fera. Et rien ne s’est fait, jusqu’ici. J’entends qu’en France la décision redevienne, sans doute possible, l’apanage du pouvoir exécutif.
Au point où nous en sommes, il y aura au moins deux avions européens sans oublier les autres, puisque les États-Unis d’Amérique se proposent pour arranger les choses. Et les choses seront considérées comme arrangées le jour où l’Europe aura choisi de se doter… d’un avion américain.
En matière d’armement, on avance donc à pas lents vers l’unité européenne. Pas d’avion, pas de char, un hélicoptère franco-allemand. Et pour les fusées, pas grand-chose.
Je ne veux pas que cette description véridique et cruelle donne le sentiment d’une moindre volonté française d’aboutir ! Je continuerai de lutter pour l’unité politique de l’Europe et donc pour l’unité de sa défense. Mais à quoi bon dissimuler que l’Europe est encore peu consciente des rendez-vous qui l’attendent au siècle prochain ? Je ne vois pour l’instant de solution, et je l’ai souvent dit à nos partenaires, que dans une planification commune de nos besoins pour les trente ans à venir. Seule cette façon de faire permettra d’harmoniser les intérêts concurrents, d’unifier les armements à mesure que s’imposeront leurs renouvellements. Il est urgent de commencer. Je m’y emploierai et je souhaite ardemment en convaincre les autres.
Le seul terrain où les progrès sont sensibles est celui des relations franco-allemandes. Le traité de l’Élysée, signé par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer en 1963, prévoyait des actions communes. Mais les dispositions propres à ces actions étaient restées lettre morte.
Vingt ans après, en 1983, le chancelier Kohl et moi-même les avons ravivées et leur avons donné un contenu : stages bilingues, réunions d’état-major, groupes de coopération, échanges d’officiers et visites d’unité, manœuvres à grande échelle avec participation de la FAR créée par la France en 1983, brigade de quatre mille hommes stationnée en Allemagne, alternativement sous commandement français ou allemand. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense se rencontrent obligatoirement quatre fois par an, en réalité beaucoup plus. Plus récemment nous avons décidé de créer un Conseil commun de défense. Enfin, en février 1986, j’ai indiqué que dans la limite de l’extrême rapidité de telles décisions, le président de la République consulterait le chancelier de la République fédérale d’Allemagne sur l’emploi éventuel des armes préstratégiques françaises sur le territoire allemand.
J’ai souvent rapporté une controverse qui m’avait opposé à Mme Thatcher, lors d’un sommet des Sept, un soir que nous dînions tous ensemble. « Que feriez-vous, m’a-t-elle demandé, si des troupes ennemies arrivaient devant Bonn ? Interviendriez-vous avec vos armes nucléaires ? » Le chancelier Kohl écoutait avec l’attention que vous devinez et M. Reagan aussi. Je les ai pris à témoin et j’ai répondu simplement : « Non. Ce que vous demandez à la France c’est à l’Alliance atlantique de le faire. C’est à l’Alliance d’empêcher, par sa détermination initiale, qu’on en arrive là. C’est exactement son rôle. Alors la France sera aux côtés de ses alliés dès la première minute. Cette responsabilité est la vôtre autant que la nôtre. La sécurité de l’Europe engage les trois puissances nucléaires de l’Alliance. À l’Alliance atlantique d’affirmer ses points de vue et d’éviter de se perdre dans des finesses stratégiques qui, de flexibilité en flexibilité, empêcheront toute décision, sinon trop tard ».
De tout cela, naturellement, j’ai parlé souvent avec le chancelier Kohl, comme je l’avais fait avec le chancelier Schmidt. Les Allemands le comprennent très bien. Ils savent que nous sommes solidaires plus que nous ne l’avons jamais été. Mais le traité de l’Élysée n’a pas pour objet de se substituer à l’OTAN. Et c’est aussi leur opinion.
Il est vrai que la notion d’espace commun, en raison même de l’étroite étendue de nos territoires habités par une forte densité de population, souligne justement à quel point nos sorts, en Europe occidentale, sont liés. Sans vouloir extrapoler, j’en dirai autant du binôme Amérique du Nord-Europe. La planète est si petite au regard des progrès — si je puis les appeler ainsi — de la science.
Tout découplage serait funeste et aux uns et aux autres. Non que je croie aux intentions belliqueuses de l’autre bloc. L’antagonisme des blocs, au demeurant, et c’est tant mieux, s’effrite. Le tournant pris, aussi bien à Moscou qu’à Washington, ces dernières années, l’apaisement de nombreux conflits régionaux, plaident en ce sens.
L’œuvre de paix a bien avancé ces temps-ci et nous devons en remercier les artisans. Mais je crois cependant à la nécessité de construire le pilier européen de l’Alliance atlantique. C’est un grand objectif. On ne peut l’isoler du contexte. C’est l’environnement économique, monétaire, technologique, culturel, politique de l’Europe qui donnera son contenu à l’environnement militaire. D’où l’enjeu, l’enjeu déterminant pour plus de trois cents millions d’Européens, que représente la date du 31 décembre 1992.
Je finirai comme j’ai commencé. En 1992-1993, si nous avons réussi, comme je le souhaite ardemment, à bâtir l’Europe du marché unique, toutes les données que nous connaissons changeront ; y compris les données de la défense commune de l’Europe. On comprendra alors que l’Europe n’existera pas sans qu’elle soit capable d’assurer elle-même sa défense.