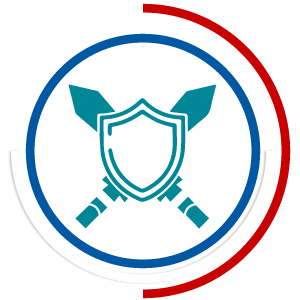Le bien, la guerre et la terreur ; pour une morale internationale
Le sous-titre l’affiche, ce livre est un plaidoyer pour une morale dans les affaires internationales. Plaidoyer inutile, diront certains : le monde, vu d’Occident, est déjà moralisé. Vœu pieux, diront les autres : la violence, un peu partout, se porte fort bien. Il faut donc aller y voir de près. Mme Canto-Sperber nous sera un bon guide. Férue de philosophie grecque, elle est l’auteur d’une quinzaine de livres savants. Directeur de recherche au CNRS, elle est membre du Comité national d’éthique.
Dans une première partie, descriptive, l’auteur justifie son entreprise. Le monde est bel et bien en voie de moralisation ; mais la morale, indispensable pour comprendre et juger le monde, doit être solidement fondée. Or on est loin du compte. Droits de l’homme, interventions humanitaires, justice internationale, démocratie normative, la compassion guide nos pas. Cette unanimité des cœurs est suspecte. Une vraie morale est nécessaire. Cherchons-la : deuxième partie.
Dans cette recherche, l’auteur fait un sort à l’opposition habituelle entre réalisme et idéalisme. C’est un lieu commun vide de sens. Il faut réconcilier ces contraires, dans une « quête du raisonnable ». Les grands classiques défilent à la barre : Hobbes, Rousseau, saint Thomas, Vittoria, Suarez, Kant, Locke… et l’excellent Grotius, qui professait que les lois destinées à régler les rapports entre États devraient rester valides « même s’il n’y avait pas de Dieu », ce qui, publié en 1625, était une belle audace. De cette revue historique résulte une question : la morale commune est-elle valable pour les États ? Réponse sage de l’auteur : les contraintes qui pèsent sur l’État amènent à ne pas opposer morale des individus et morale des États. Cette réserve étant faite, « sur quoi fonder la moralité des normes » internationales ? ou encore, « d’où viennent les normes et les valeurs ? ». Questions indiscrètes, devant lesquelles l’auteur s’évade : « Je n’entreprendrai pas ici de répondre à ces questions » (p. 179). Dommage !
Au reste, quel que soit le fondement de la morale proprement dite, un idéal moral se constitue aujourd’hui, celui d’une communauté mondiale, démocratique et pacifiée. Pour l’auteur, cet idéal est une duperie, sous quelque forme qu’on le présente : ni la multipolarité (équilibre de puissances à la mode de Vienne 1815), ni la démocratie des États (façon ONU), ni l’hégémonie (on pense aux États-Unis, mais l’Union européenne elle-même, préfiguration d’un empire du bien, se renierait en prétendant à une hégémonie douce), ni le cosmopolitisme (monde sans États ni État, sorte de démocratie directe de la société civile et des individus) ne sont porteurs d’avenir.
De réfutation en réfutation, nous voilà en plan. Pas tout à fait. La conclusion de la deuxième partie va peut-être nous donner la clé, clé molle il est vrai : c’est dans l’incertain, entre le général et le contingent, qu’il nous faut nous mouvoir. Et là, Monique Canto-Sperber frise le « politiquement incorrect ». Valeurs universelles il y a bien, ce sont les nôtres (p. 230), dignité de la personne, liberté, égalité, justice. Foin, donc, du relativisme ! Hélas, on se rétracte aussitôt : ce n’est pas parce que les valeurs occidentales sont universelles qu’elles doivent s’imposer partout (p. 238). Que reste-t-il donc ? La rationalité, laquelle serait étroitement liée à la morale. Voilà une proposition bien discutable. Ainsi lorsque l’auteur pose (p. 241) que préserver la vie est le plus rationnel des comportements moraux, encore faudrait-il avoir posé d’abord que la vie est le bien suprême ; ce qui est un parti pris métaphysique.
On ne saurait traiter de morale internationale sans parler de guerre. C’est ce que fait l’auteur en une troisième partie. Sans doute le terme « guerre » convient-il mal aux violences de notre début de siècle. Cette approximation de vocabulaire nourrit, et pas seulement ici, les équivoques. Aussi bien est-ce le terrorisme islamique qui sous-tend l’ensemble de l’étude ici présentée. On n’en fait pas moins le relevé de tous les théoriciens de la guerre juste, saint Augustin, saint Thomas, Vittoria… et Grotius, toujours excellent et fort actuel, justifiant l’ingérence et introduisant, en deçà et au-delà du jus ad bellum et du jus in bello, le jus ante bellum, qui place la guerre en ultime recours, et le jus post bellum, qui est modération dans le sort fait au vaincu.
Venant à notre époque, Monique Canto-Sperber stigmatise les « guerres morales ». Fortes de leur vertu, elles portent en germe la guerre totale. Aussi oppose-t-elle guerre morale et justice de la guerre. Pour elle, et on la suit volontiers, la guerre n’est juste que si sa légitimité est scrupuleusement établie et sa conduite assortie de limites morales fortes. Cela étant, le jugement ne sera pas facile. La juste cause est toujours ambiguë, il n’y a pas de guerre « absolument » légitime. La moraliste rejoint le stratège : à la guerre, en morale comme en stratégie, la vérité n’apparaît qu’a posteriori.
On sait que les juristes spécialisés dans le droit de la guerre exercent une activité peu gratifiante. C’est ce que l’auteur reconnaît, parlant, en conclusion, de la « précarité morale de la guerre ». Tant d’efforts pour rien ? Que non ! Certes, on ne conseillera pas la lecture de ce livre à de jeunes officiers entrant dans la carrière. Cette petite minorité mise à part, chacun trouvera, dans ce livre subtil, de quoi faire son miel. ♦