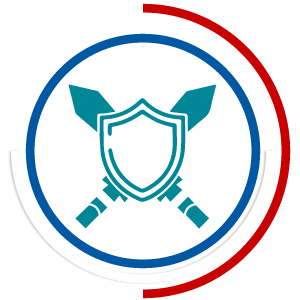Un amour à la légère
On connaît le général Buis, sa carrière et son œuvre. On se souvient de La Grotte (1961), son premier roman qui prenait pour cadre la guerre d’Algérie, et de Fanfares perdues (1973), où il méditait avec Jean Lacouture sur une vie militaire riche d’expériences multiples. Si l’on ne craignait de le trop réduire, on dirait bien de ce nouveau roman qu’il est le chant du cavalier.
Le plus brillant sabreur de l’armée impériale revient d’Espagne. Napoléon, à la veille de la campagne de 1809, l’attend sous Vienne pour lui confier le commandement de sa Cavalerie Légère et la mission de préparer, par ses reconnaissances, la sanglante œuvre d’art qu’il élabore et qui prendra forme à Wagram. Notre général passe à Paris, s’entiche d’une romancière en vogue, qui le lui rend bien : Rolande suivra l’armée en campagne, pratique courante, en cette heureuse époque, chez les belles des généraux, et rejoindra sur le Danube son ravageur, et du même coup le décor et le sujet de son prochain roman. Ainsi l’auteur se donne-t-il la possibilité d’un double jeu : l’histoire qu’il raconte, et l’histoire de l’histoire, que Rolande met en chantier.
À la bataille décisive, le héros ne sera point. Il fera merveille à Essling et mourra devant Engerau, la poitrine défoncée par un boulet autrichien. Ce général n’est pas Lasalle – mort, lui à Wagram –, mais on y pense.
Sur cette trame, Georges Buis est à l’aise et s’en donne à cœur joie ; le lecteur aussi ! Passons sur les amours, nombreuses et variées, légères parfois selon le titre, plus graves avec Rolande. C’est ici l’admirable peinture de la guerre qui nous retiendra : guerre sérieuse, intelligente, dont la reconnaissance fournit le premier matériau ; guerre brillante, où l’on se défie entre chefs sur le front des troupes ; jolie guerre, « chenilles d’escadrons multicolores » remontant le lit des rivières. « violente palette des uniformes dans les plaines et les vallons, le tout piqueté du vol blanc des quelques mamelouks qui restent en vie » ; guerre furieuse, lorsque la charge déchaîne hommes et chevaux, fous de vent, de cris et de sang ; guerre fraternelle où se retrouvent, au soir, « cinq cents épaves étalées sur le sol du bivouac, ivres mortes et que leurs chevaux reniflent délicatement comme pour prendre acte du bon respect de la tradition ».
Sans doute l’auteur a-t-il placé son roman à l’époque la plus grandiose – sinon la plus cruelle – qu’ait connue notre armée. Mais quel plaisir de voir décrits par l’un des nôtres, avec exactitude et sensibilité, dans un style à la pureté classique, les rigueurs, les charmes et la grandeur du métier des armes. À nous, soldats du XXe siècle finissant, besogneux d’états-majors parisiens ou vieux ratiocineurs de stratégies nouvelles, restent la nostalgie et « la soie brodée, souvent joliment blessée, des drapeaux, étendards et fanions qui tapissent occasionnellement Notre-Dame ou qu’habitent imperceptiblement, dans leur alignement sous les voûtes de Saint-Louis des Invalides, les frissons d’une mêlée oubliée ». ♦