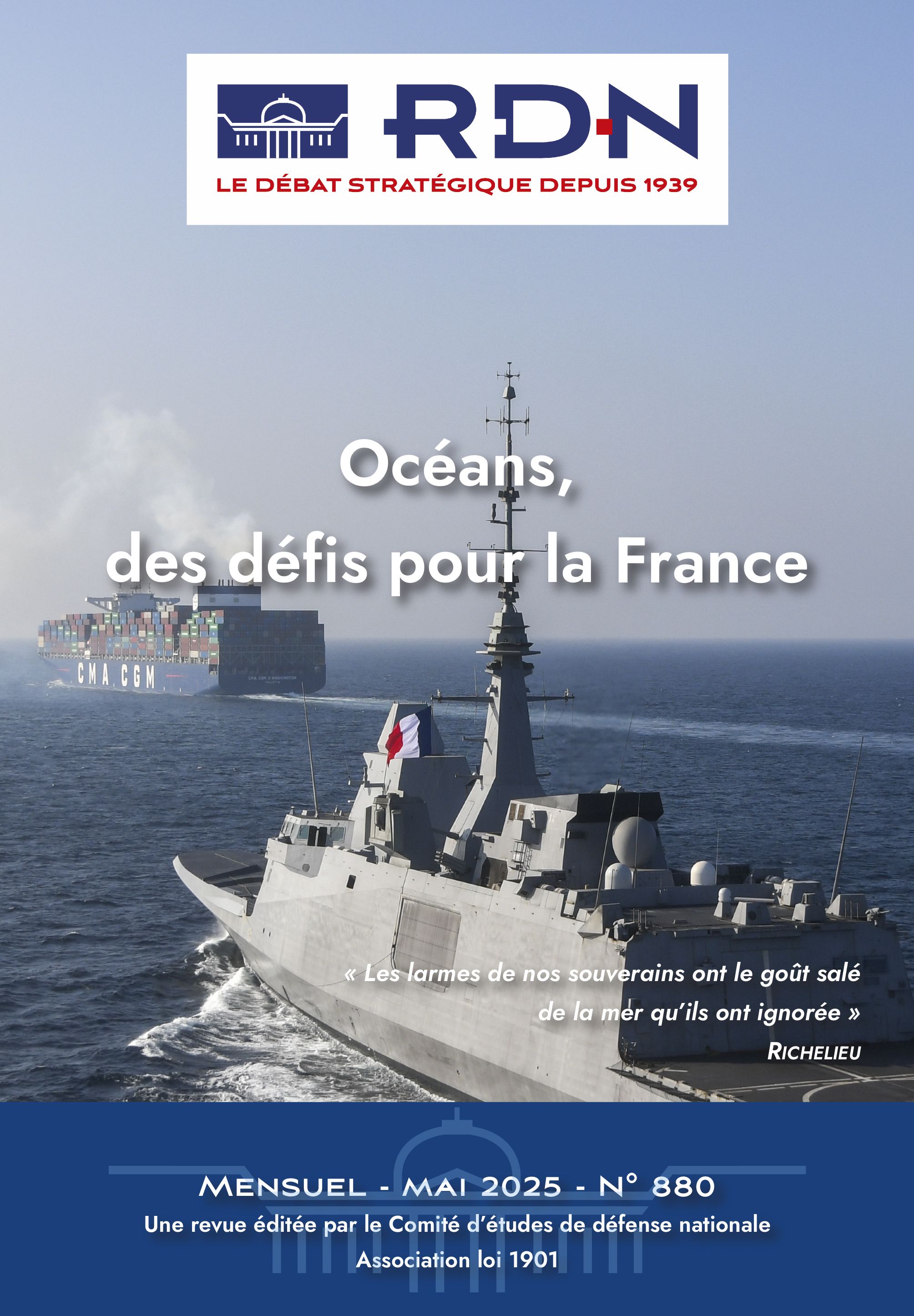La société sans la guerre
Si on a bien compris, la thèse exposée par François Géré est, au moins dans l’esprit, originale et séduisante. Selon lui, on a pris la mauvaise habitude de traiter de la paix négativement, comme un état provisoire de non-guerre « par défaut », et de ne se résigner à ne pas se battre que dans deux cas : soit la présence d’un Père Fouettard capable de faire tenir les gens tranquilles, soit l’état d’épuisement des protagonistes « fourbus, devenus post-belliques ». Si nous ne vivons actuellement « une nouvelle forme de paix » que pour déboucher dès demain sur « une autre forme de guerre », ce n’était pas la peine assurément… comme aurait dit Madame Angot.
Il convient donc au contraire de construire désormais positivement, et hors du royaume d’Utopie, une véritable stratégie de paix, se donnant les moyens d’y parvenir. Cette ambition ne signifie pas en effet inaction ni renoncement (car « un État désarmé n’est pas un État pacifique, c’est une proie potentielle »), mais dotation en forces adaptées décrites ici comme suit : une composante européenne de gendarmerie consacrée à la sécurité intérieure du continent, une composante de protection des frontières dudit continent, une composante d’intervention lointaine. Adieu donc aux armées nationales, tout en reconnaissant que les trois missions énumérées ne font qu’élargir au niveau européen les « traditionnelles assignations faites aux forces armées de tout État depuis 1945 ».
Le message est clair. Il nous a semblé toutefois que le petit télégraphiste chargé de le remettre s’attardait un peu en chemin, au risque de faire perdre le fil. Certes, la construction d’ensemble est d’allure rigoureuse et le style impeccable. François Géré n’abuse pas trop de formules abstraites comme « la dialectique des différentiels temporels » ou « la gestion des micro-environnements dilatés » et ne fait perdre complètement pied au lecteur moyen qu’en une occasion (page 268) à propos d’un schéma de « relation interactive de deux régulations qui se développe en boucle de rétroaction permanente ». On se laisse guider plus aisément dans certains chapitres (notamment ceux qui terminent chacune des trois parties) que dans d’autres au parcours plus ardu, abondants en classifications et cascades d’interrogations, émaillés de réflexions philosophiques voire métaphysiques, et non dénués par ailleurs de maintes formules pittoresques ou percutantes du type « l’éclaboussure des excès n’asperge plus que les caméras » ou, à propos de la question de savoir si un combattant de la paix est encore un militaire, « on tourne à l’intérieur de cette aporie comme un écureuil sur sa roue ». Le chapitre 7, offensif, presque agressif, ne peut que fouetter au passage le sang de celui qui se serait laissé aller à la distraction. Un Géré déchaîné s’élève contre les « réflexes conservatoires qui affublent la menace de propriétés horrifiantes », brocarde les « inlassables sirènes acharnées à relancer un discours de conflictualité », dénonce la « grossièreté du trait » chez Huntington et y voit « un symptôme de la panne intellectuelle du narcissisme américain ».
Sur le fond, on ne peut que souscrire à cet objectif d’instauration d’une paix musclée. Sur le fait de savoir si l’histoire ne fournit que des « leçons impertinentes », nous ne discuterons pas l’observation d’un agrégé dans cette discipline. La plupart des prises de position semblent bien relever d’une saine appréciation des choses : le caractère « aberrant » des indispensables armes nucléaires, le peu d’avantages tirés par la France de la fin de la guerre froide, la « sottise roublarde » d’intellectuels jugeant « à travers un prisme de relations de salon, rehaussé de petites excursions touristico-médiatiques sur les lieux du crime », la fonction à la fois protectrice et belligène de l’État… On suivra peut-être moins aveuglément l’auteur dans des affirmations conduisant à une draconienne révision en diminution de la menace : « Il n’existe plus de valeurs contre les nôtres… L’islam n’a pas vocation à un messianisme conquérant » ; l’obsession sécuritaire est une « attitude proche de la paranoïa… envers malfaisant » du besoin de sécurité ; à l’intérieur, la gendarmerie européenne suffira à mettre bon ordre à l’agitation en zone urbaine où il ne saurait être question de « léser gravement l’opposant qui n’est qu’un citoyen protestataire momentané ». Admettons ce discours quelque peu démobilisateur, mais si on veut être logique jusqu’au bout en excluant toute éventualité de défense armée et déterminée du territoire national, il importe à notre avis de supprimer au plus tôt de nos textes de base la première phrase lapidaire de l’ordonnance du 7 janvier 1959 !
Au total, nous avons eu l’impression, fondée ou non, d’un idéalisme culminant avec les propositions d’interdire de « placer les installations militaires à une distance donnée, trop proche des populations civiles » et de créer des « zones réservées, interdites aux opérations de guerre ». Le livre peut se résumer ainsi : au lieu de l’« adage paradoxal » qu’est la formule classique si vis pacem, para bellum, lire : si non vis bellum, para pacem. On peut toujours essayer... ♦