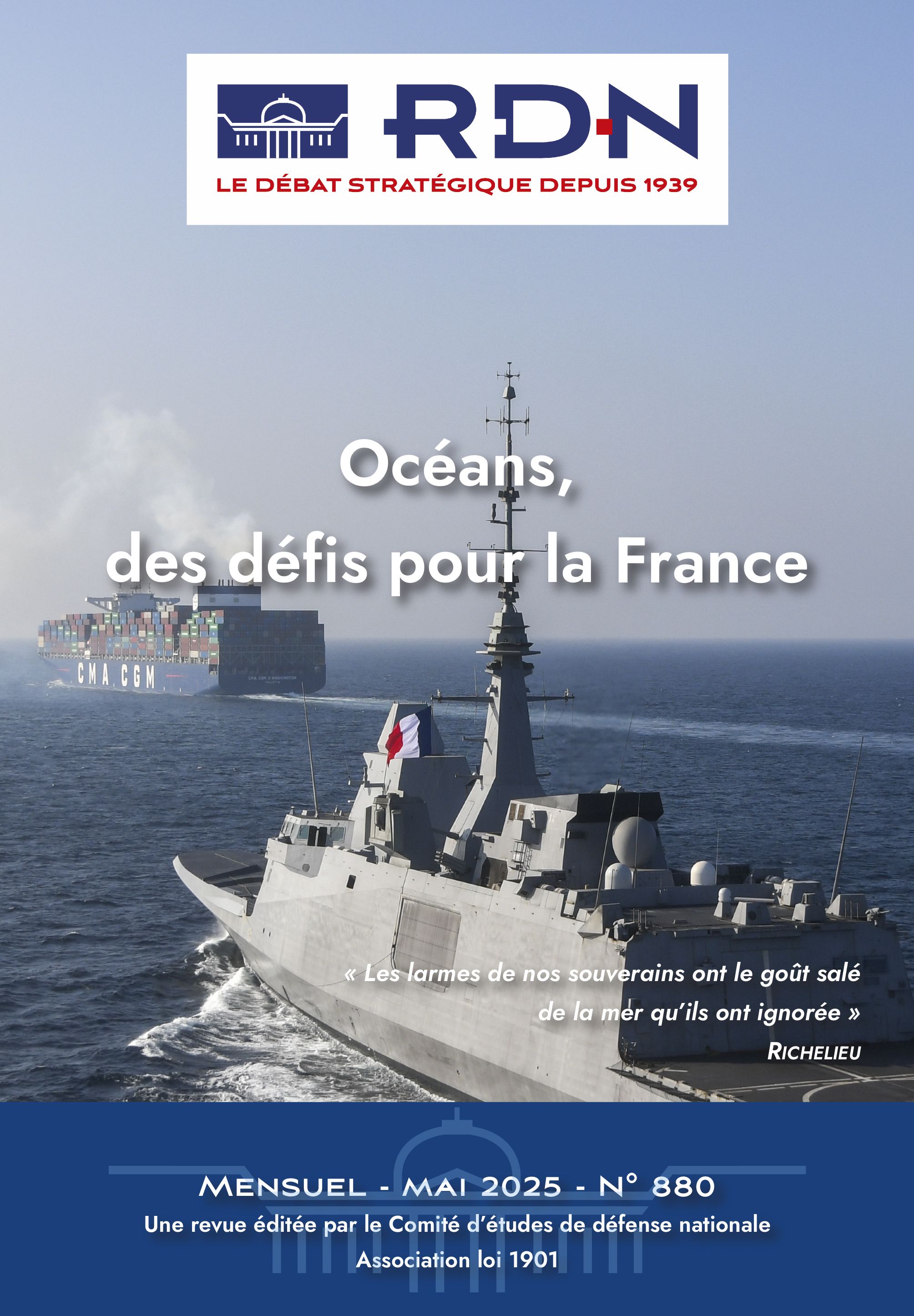Voyage au bout de l’Allemagne. L’Allemagne est inquiétante
Depuis plus d’un siècle, l’ignorance des réalités allemandes a précipité la France dans de grandes tragédies. Ce terrible constat a amené Alain Griotteray à rédiger, en collaboration avec Jean de Larsan, spécialiste reconnu des questions germaniques, une étude détaillée sur notre voisin d’outre-Rhin. Les acteurs mettent notamment l’accent sur le choc psychologique créé par l’unification allemande. Deux populations dissemblables se retrouvent brusquement « mariées de force, obligées de vivre ensemble, et ce en moins d’un an » : des fiançailles (9 novembre 1989) au mariage de raison (3 octobre 1990), « le temps de la connaissance aura été bien court ». La partie orientale de l’Allemagne sort de quarante années d’absolutisme communiste ; la partie occidentale, de trente années de prospérité économique. Chacune a vécu auparavant douze années de dictature hitlérienne.
Quelques années après cet événement historique, le bilan semble varié : « La fiancée orientale n’était pas aussi belle » et « l’époux occidental n’était pas aussi attentionné ». Hier, les Allemands formaient un peuple et deux États ; aujourd’hui, ils constituent deux peuples et un État. Cette analyse dressée par Lothar de Mazières est complétée par Alain Griotteray : deux peuples ? Non, trois plutôt ! En effet, à ce heurt brutal entre deux groupes de populations est venu s’ajouter le retour à la mère patrie des Aussiedler, « ces Allemands que la colonisation des marches orientales avait essaimés en Europe de l’Est ». Dès 1990, ce n’étaient donc plus les deux entités humaines de la RFA et de la RDA, mais bien trois qui furent obligées de vivre ensemble et de se supporter. C’est par vagues entières, dès lors que le mur de Berlin était tombé et avec lui les restrictions à la liberté de la circulation à l’Est, que ces « rapatriés », Allemands de droit en vertu de l’article 116 de la Loi fondamentale, déferlèrent en Allemagne. Selon les auteurs, ces apports anarchiques de population représentent un facteur de déstabilisation majeure.
À cet élément inquiétant, il convient d’ajouter l’évolution de la démographie : « La grande Allemagne, prospère et bourgeoise, malgré ses 81,8 millions d’habitants, se suicide chaque année davantage ». Sur cette question, Alain Griotteray rappelle qu’avec 10,5 naissances pour 1 000 habitants, la nation de Goethe est devenue l’un des pays ayant le plus faible taux de naissances au monde. La pyramide des âges allemande s’apparente à un triangle inversé : 16 % de jeunes de moins de 15 ans, 15 % de plus de 65 ans, 25 % d’Allemands entre 44 et 65 ans, 44 % entre 15 et 45 ans. La part des jeunes est l’une des plus basses de la planète ! Par ailleurs, ce paramètre humain risque d’être bouleversé par un possible retour à la maison mère de certaines minorités allemandes qui sont éparpillées dans de nombreux points chauds du globe. Sur ce sujet, il est bon de mentionner l’importance des communautés germaniques au Kazakhstan (960 000), en Russie (840 000), au Kirghizstan (100 000), en Ukraine (40 000), en Pologne (800 000), en Roumanie (120 000), en République tchèque (100 000), en Slovaquie (15 000), en Hongrie (200 000), en Croatie (3 000)… C’est dans ce chapitre que les auteurs citent ce passage controversé d’André Siegfried (L’âme des peuples, 1950) : « Il y a un peuple allemand qui, dans ces conditions, ne veut pas connaître de frontière. Son unité n’est pas le lien qui l’attache à un certain territoire, comme c’est le cas en France, mais dans sa conscience ou du moins sa volonté d’être une race, ayant sa langue, sa culture, le sens de son unité. Son instinct constant de déborder en fait un danger permanent pour ses voisins. D’où, pour l’Europe, un problème qui jusqu’ici n’a pas été résolu, puisqu’il y a au centre du continent une Allemagne, tantôt envahissante et tantôt envahie, à la fois plastique et agressive, sans laquelle bien évidemment aucune construction politique continentale n’est durable ». Ce passage va certainement susciter des polémiques. Pour les uns, cette référence au passé n’est plus d’actualité ; pour les autres, elle demeure au contraire une nécessaire mise en garde.
En réponse à la question posée par Pierre d’Harcourt en 1954 L’Allemagne est-elle inquiétante ? (éditions Flammarion), Alain Griotteray prétend que le pays de Goethe présente aujourd’hui des aspects préoccupants qui résultent de ses désirs d’hégémonie. Pour étayer son jugement, le député français s’appuie sur deux exemples. Le premier concerne le domaine militaire dans lequel trois grandes réformes ont renforcé le potentiel de l’Allemagne : création de forces de réaction aux crises (KRK, 50 000 hommes), mise sur pied d’une structure nationale d’emploi des forces « pour les cas qui ne sauraient incomber à l’Otan », et instauration d’unités spéciales chargées d’évacuer les ressortissants allemands des pays en guerre. Le second exemple touche à la volonté de suprématie culturelle. Concernant ce registre, les auteurs mentionnent l’importance des budgets consacrés aux Fondations (Friedrich Ebert, Konrad Adenauer). Celles-ci couvrent un champ d’activités considérable : recherche historique, juridique, sociale, géopolitique, formation politique, coopération internationale… Ces organismes conduisent plus de 200 projets dans une centaine d’États et financent des bourses, non seulement pour des Allemands, mais aussi pour des étrangers. Pour Alain Griotteray, ces Fondations sont surtout destinées « à exporter le modèle allemand dans le monde ». Cette diplomatie parallèle repose sur un véritable réseau international qui agit la plupart du temps en liaison avec les ambassades et les Goethe Institute chargés du développement de la langue et de la culture germaniques.
Tout au long de cet ouvrage, les deux auteurs répètent le même message et tentent de convaincre le lecteur qu’il existe une stratégie d’hégémonie allemande au sein même de l’Union européenne. Alain Griotteray examine ainsi l’épineux dossier de la banane, d’où il ressort que l’Allemagne a agi à l’encontre des intérêts européens en soutenant la politique commerciale des États-Unis. Dans cette affaire, l’Union européenne avait imposé un système de contingentement des « bananes dollars », produites moins cher en Amérique latine et vendues par les multinationales américaines, afin de protéger la production fruitière d’anciennes colonies de ses États membres et des pays couverts par les accords de Lomé. Pour le député français, l’attitude allemande est condamnable, car elle s’appuie sur des considérations bassement matérialistes : « L’Allemand engloutit voracement 19 kg de bananes dollars par an et ne supporte pas les bananes Dom-Tom françaises ». C’est cependant sur la question de la monnaie qu’Alain Griotteray se montre le plus critique. Il estime en effet que la politique du franc fort se décide à Francfort, siège de la Banque centrale européenne, où tous les postes clés sont détenus par des Allemands.
Pour les auteurs, l’Europe doit parfois savoir dire non à l’Allemagne. Ainsi l’attitude allemande envers la question du retraitement des déchets nucléaires et de l’arrêt du nucléaire a remis en lumière le coup d’Agadir de 1911 : « Le diktat sert à éprouver la résistance de l’autre, allié ou adversaire, afin de mesurer jusqu’où il est possible de pousser son avantage. » Après avoir dit et répété que l’Allemagne sortirait du nucléaire rapidement et qu’il n’était pas question de dédommager les deux industriels du retraitement, le Français Cogema et le Britannique BNFL, le chancelier Schröder recula sous la contrainte des menaces franco-britanniques. Dans cette affaire, la détermination de Paris et de Londres a eu raison du projet aventureux des sociaux-démocrates allemands. Pour Alain Griotteray, des ripostes de ce type doivent se multiplier pour contrecarrer le dessein hégémonique de l’Allemagne. En résumé, l’homme politique français lance un cri d’alarme pour éviter à la France l’écueil d’une Europe fédérale dont « le capital est à Francfort et la capitale à Berlin ». Certains commentateurs verront dans cette argumentation des propos excessifs ; d’autres un guide utile pour retenir les leçons du passé, construire l’avenir, et surtout donner une dimension différente au « couple franco-allemand ». Quelles que soient leurs opinions, les lecteurs trouveront de toute façon dans cet essai très documenté des données intéressantes sur l’Allemagne dans les domaines historique, géographique, sociologique et politique. ♦