Saint-cyrien de la promotion Maréchal de Turenne et breveté de la 102e promotion de l’École supérieure de Guerre, colonel en retraite, auteur de plusieurs ouvrages sur la Grande Guerre et d'articles dans la presse militaire et civile spécialisée. Actuellement chargé de mission au Centre de doctrine et d'enseignement du commandement (CDEC).
À partir du printemps 1945, les forces françaises commencent à occuper une zone dans le sud de l’Allemagne. Cette force d’occupation contrôle un territoire allant de la plaine d’Alsace jusqu’à l’Autriche. Il s’agit d’abord de désarmer ce qui reste de la Wehrmacht, de rapatrier les Français encore prisonniers, de démonter des équipements industriels pour rebâtir l’industrie française largement pillée lors de l’occupation nazie et de permettre à la France d’être à la table des vainqueurs. Lire les premières lignes
La dissuasion nucléaire a également concerné l’Armée de terre avec la mise en œuvre de missiles à capacité nucléaire. Le système Pluton y a joué un rôle majeur avec une évolution doctrinale essentielle, passant du tactique au préstratégique sous l’ère du président Mitterrand, très attaché à la dimension politique de la dissuasion. Lire les premières lignes
La relation transatlantique entre la France et les États-Unis a beaucoup varié au cours du XXe siècle. Il y a eu de nombreux désaccords parfois profonds comme entre de Gaulle et Roosevelt, mais le lien a toujours fonctionné, y compris après 1966. Le dialogue diplomatique et militaire a toujours prévalu, permettant de surmonter les différends. Lire les premières lignes
Le général André Beaufre est décédé il y a juste cinquante ans. Tout au long d’une carrière dense et l’ayant conduit à vivre de près les échecs français comme 1940 et Suez, il a développé une œuvre stratégique majeure qui reste d’actualité, notamment sur la dissuasion et sa relation avec le conventionnel. Lire les premières lignes
En janvier 1945, sous la pression allemande, le général Eisenhower, commandant en chef les Forces alliées, envisageait de se retirer de Strasbourg pourtant à peine libérée. Ce fut l’occasion d’une crise majeure avec le général de Gaulle, crise politique qui fut résolue par l’engagement personnel de Winston Churchill. Cela illustre la problématique des intérêts nationaux au sein d’une coalition. Lire les premières lignes
La Libération de l’Alsace eut lieu fin 1944 avec l’engagement de forces américaines et de la 1re Armée française commandée par le général de Lattre de Tassigny. L’entrée au nord par le col de Saverne et au sud par le Territoire de Belfort permit aux troupes alliées de libérer Strasbourg et Mulhouse. Toutefois, les Allemands surent maintenir une poche autour de Colmar. Lire les premières lignes
Il y a 60 ans – Le Général Weygand (1867-1965), la haute conscience de l’armée (T 1675)
- Claude Franc - 6 pages.jpg)
À l'occasion des 60 ans de la mort du général Maxime Weygan, le colonel Claude Franc revient sur cette figure de l'armée française qui marqua la première moitié du XXe siècle, étant un officier qui joua un rôle important pendant les Première et Seconde Guerres mondiales.
Le Maréchal Foch a très vite compris comment travailler avec le général Pershing, chef des troupes américaines en 1918. Plutôt persuader et associer, qu’ordonner sèchement, permettant ainsi à l’officier américain de renforcer la cohésion de son armée. Foch sut maintenir cette ligne malgré l’échec en Argonne et les critiques de Clemenceau. Lire les premières lignes
L’unité italienne doit beaucoup au Comte Cavour qui ne cessa d’agir pour unifier l’Italie sous la tutelle du Roi de Piémont-Sardaigne, Victor-Emmanuel. Ce long processus bénéficia du soutien de Napoléon III, fervent « champion des Nationalités ». Toutefois, la question de la Papauté à Rome resta centrale jusqu’en 1871, étant conclue avec les accords de Latran en 1929. Lire les premières lignes
L’opération aéroportée visant à se saisir d’Arnhem en septembre 1944 fut conçue principalement par Montgomery, imposant alors ses vues à Eisenhower. Ce fut un échec tactique, s’inscrivant dans les difficultés des Alliés anglo-américains à définir une stratégie cohérente à l’issue de la bataille de Normandie. C’est une problématique récurrente des grandes coalitions avec la question du commandement. Lire les premières lignes
Les réformes du général Lagarde aboutissent à l’organisation 77 des Grandes unités avec 3 corps d’armées et des divisions subordonnées. Ce modèle, avec l’arrivée massive de nouveaux équipements (VAB, AMX-10, 155 AU-F1) a constitué un apogée pour nos forces terrestres avec des capacités de commandement et de logistique permettant une manœuvre dynamique face à la menace soviétique. Lire les premières lignes
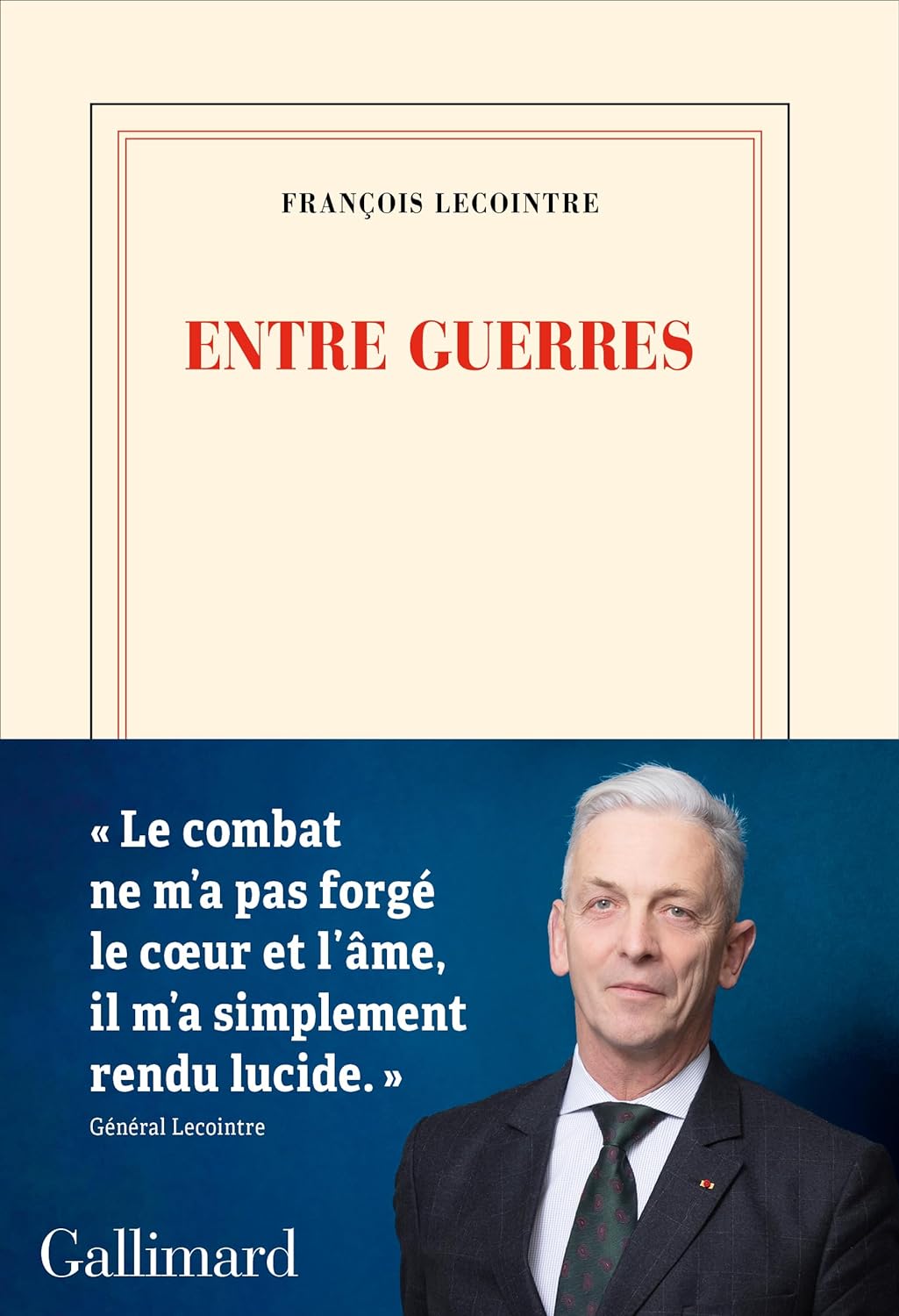 Se souvient-on encore qu’en décembre 1950, en débarquant en Indochine pour y exercer le commandement d’un corps expéditionnaire traumatisé par la catastrophe de la RC4, le général de Lattre affirmait haut et fort « Je suis ici pour les lieutenants et les capitaines ». Phrase forte, non exempte d’une certaine forme de démagogie dans le contexte où elle avait été prononcée, mais qui révélait tout de même une vérité première : la guerre est faite par les lieutenants et les capitaines. Lire la suite
Se souvient-on encore qu’en décembre 1950, en débarquant en Indochine pour y exercer le commandement d’un corps expéditionnaire traumatisé par la catastrophe de la RC4, le général de Lattre affirmait haut et fort « Je suis ici pour les lieutenants et les capitaines ». Phrase forte, non exempte d’une certaine forme de démagogie dans le contexte où elle avait été prononcée, mais qui révélait tout de même une vérité première : la guerre est faite par les lieutenants et les capitaines. Lire la suite
Il y a 80 ans – Les enjeux politiques de la Libération de Paris – 18-25 août 1944 (T 1628)
- Claude Franc - 6 pages.jpg)
À l'occasion du quatre-vingtième anniversaire de la Libération de Paris, le colonel Claude Franc analyse pour la RDN les enjeux politiques qui entouraient cet événement majeur de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
À l’issue de la guerre d’Algérie, l’Armée de terre se restructure et se concentre autour de l’organisation 67 des grandes unités, avec un centre de gravité réparti entre le Quart Nord-Est et les Forces françaises en Allemagne. Le principe divisionnaire inclut alors l’échelon de la brigade et s’est vite révélé trop lourd à manœuvrer, amenant aux réformes du général Lagarde. Lire les premières lignes
Il y a 80 ans – Tulle et Oradour-sur-Glane, deux crimes de guerre de l’armée allemande – 8 et 9 juin 1944 (T 1609)
- Claude Franc - 5 pages.jpg)
Le massacre d'Oradour-sur-Glane et celui des pendus de Tulle ont eu lieu dans les premiers jours qui ont suivi le Débarquement en Normandie, il y a tout juste 80 ans. Le colonel Claude Franc revient, dans cet article, sur le contexte dans lequel ces crimes ont eu lieu, en pointant précisément la responsabilité du commandement allemand.
La réforme conduite par le général Lagarde a largement dépassé le simple cadre des forces terrestres pour englober toute l’armée de Terre. Cette mutation, très ambitieuse, a permis de refonder l’ensemble des composantes en l’adaptant au combat moderne, tout en bénéficiant de la modernisation des équipements. Il s’est agi de la plus importante réforme et la plus réussie depuis 1946. Lire les premières lignes
Pour le général Lagarde, réformer l’Armée de terre était une évidence en rétablissant un lien de confiance entre celle-ci et la Nation. Cela passait notamment par un nouveau style de commandement fondé sur l’initiative et la discipline librement consentie plutôt que sur une contrainte rigide et subie. Lire les premières lignes
Lorsque Valéry Giscard d’Estaing arrive à l’Élysée en 1974, l’Armée de terre est en souffrance. Ses valeurs sont rejetées par une société en mutations profondes. Ses moyens sont dans un état de grand délabrement. L’encadrement est sous-payé et mal considéré, tandis que la jeunesse récuse la contrainte du service militaire. Lire les premières lignes
Il y a 70 ans, la bataille de Diên Biên Phu débutait. Le choix tactique fait par le commandement français a abouti à la défaite. Mais celle-ci résulte d’abord de l’incapacité des différents gouvernements de la IVe République à définir un objectif politique puis stratégique sur le devenir de l’Indochine française. Des non-choix successifs aux conséquences dramatiques. Lire les premières lignes
In memoriam – Hommage à Alfred Grosser, penseur de l’amitié franco-allemande (1925-2024) (T 1573)
- Claude Franc - 6 pages.jpg)
Notre chroniqueur le colonel Claude Franc rend hommage à Alfred Grosser, disparu le 7 février 2024 à l'âge de 99 ans. Le politologue a été un contributeur de la RDN dans les années 1960 et un penseur du rapprochement franco-allemand pendant et après la guerre froide.
Le maintien de l’ordre fut jusqu’au début du XXe une des missions de l’armée avec plus ou moins de succès. Après la Grande Guerre et notamment le 6 février 1934, le commandement fut très réticent face aux demandes des autorités politiques, maintien de l’ordre et opération militaire ne relevant pas des mêmes logiques. Lire les premières lignes
La campagne d’Italie à partir de 1943 ne fut pas le succès stratégique escompté initialement. Malgré la bascule d’alliance de l’Italie, les Alliés ne parvinrent que laborieusement à franchir les différentes lignes défensives mises en place par les troupes allemandes. Les difficultés du terrain montagneux et les affres du climat pesèrent sur la mobilité des forces alliées. Lire les premières lignes
Les guerres balkaniques de 1912 et 1913 ont vu des engagements militaires de haute intensité démontrant la supériorité du feu sur le mouvement. Ces enseignements, pourtant correctement recueillis, n’ont pas été exploités à partir de l’été 1914 lorsque la Première Guerre mondiale démarra. Lire les premières lignes
Colloques, manifestations, expositions...
Institutions, ministères, médias...