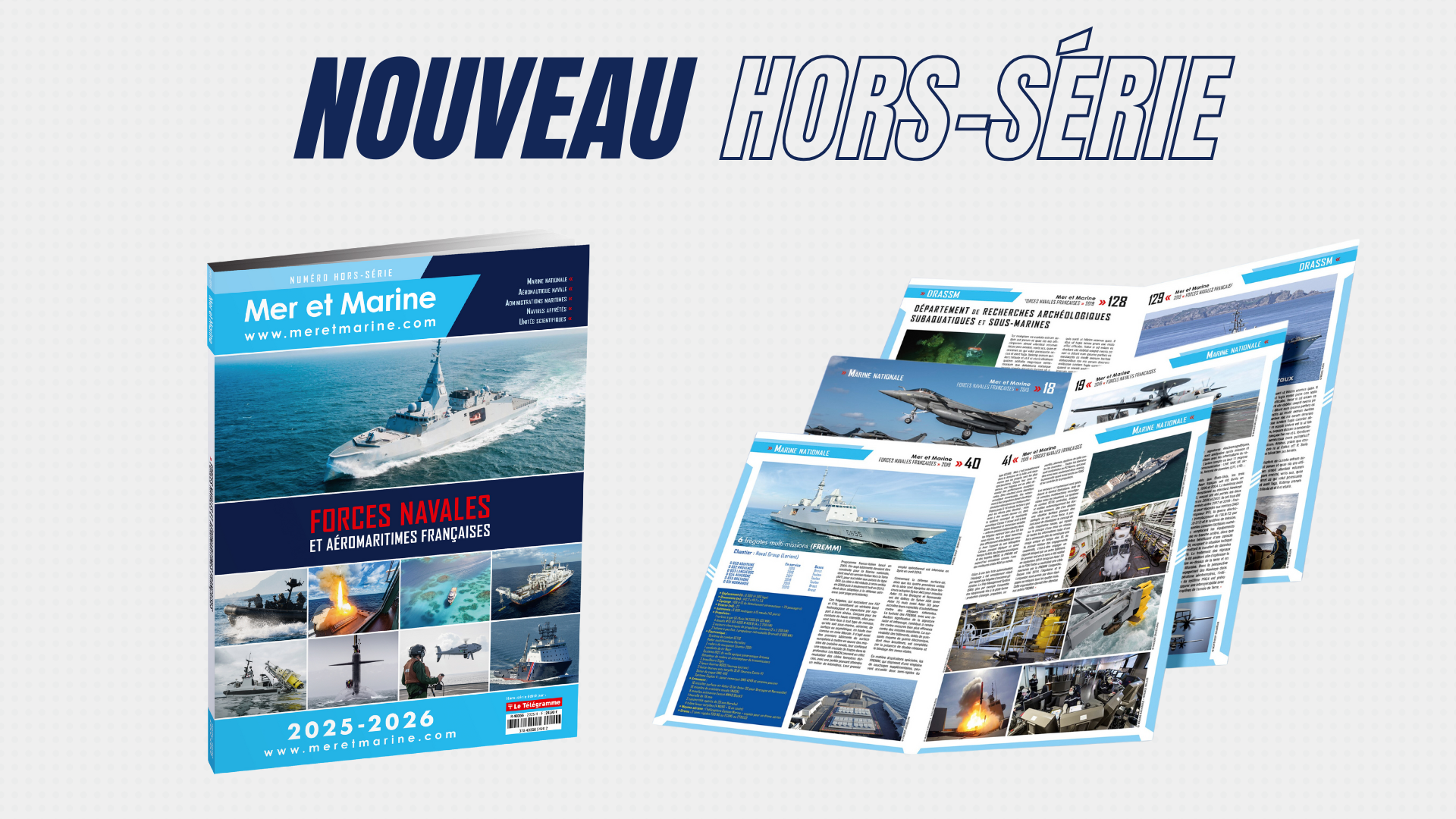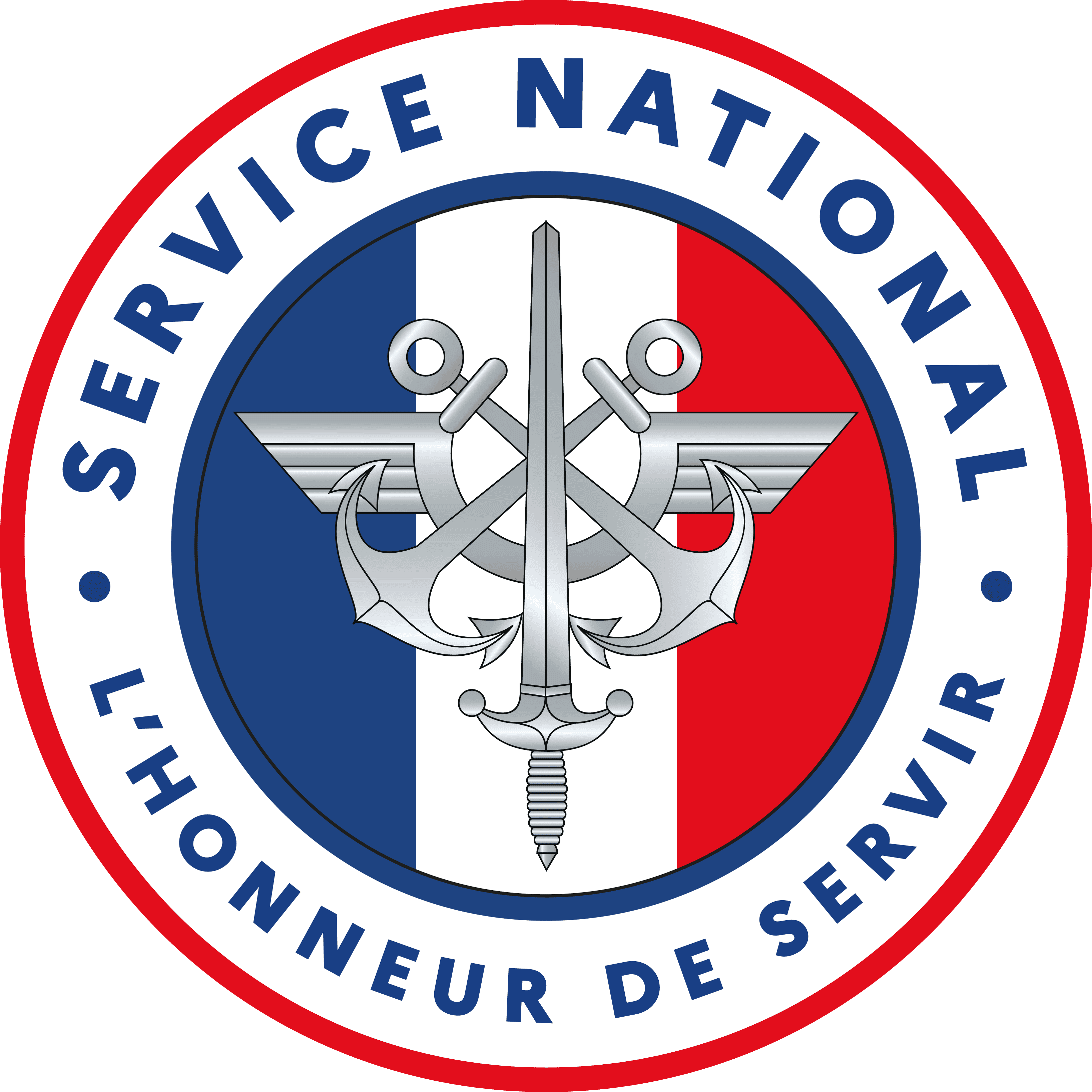Les enjeux de sécurité en Méditerranée orientale
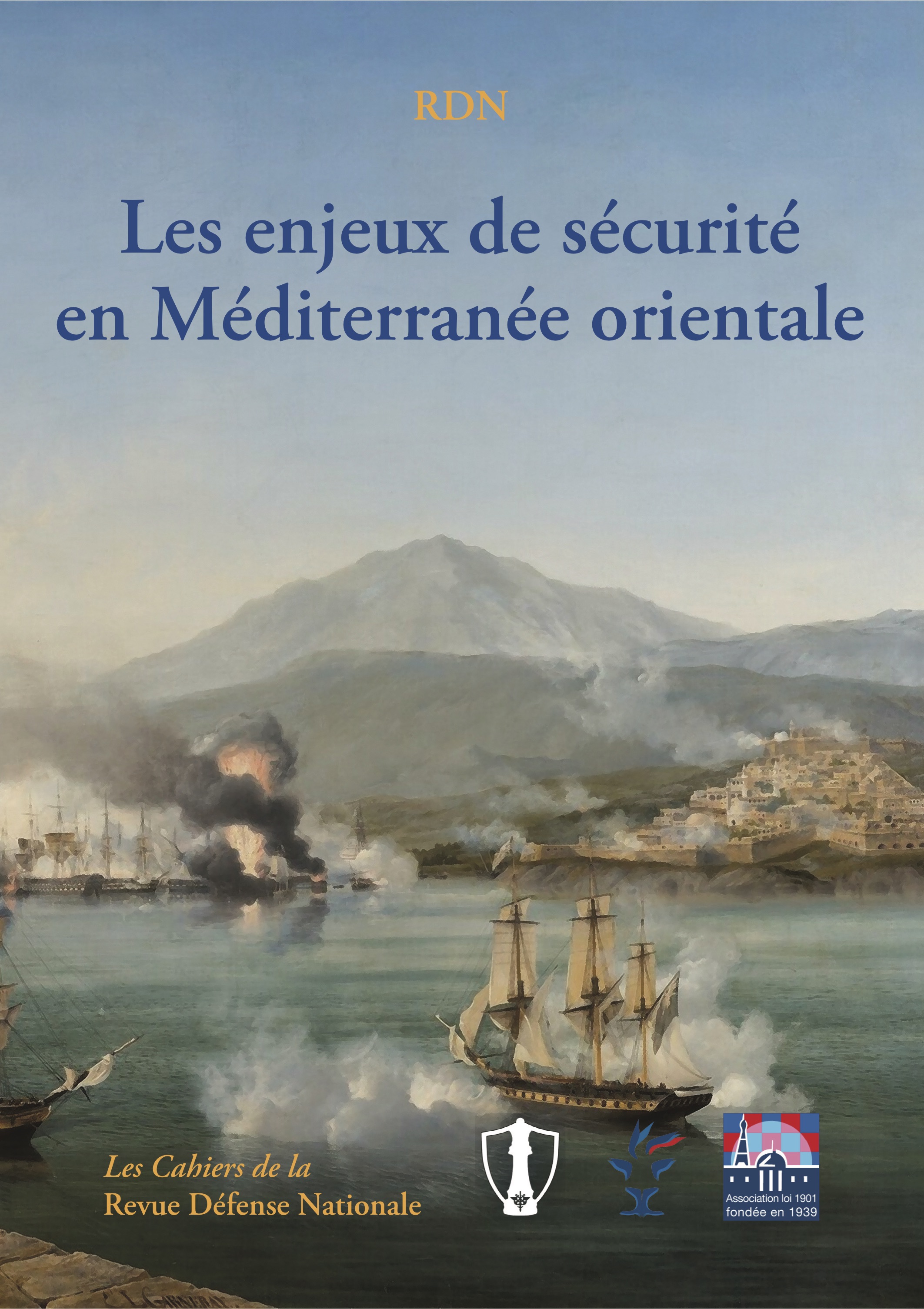
Remerciements - - p. 5-5
Nous adressons nos remerciements les plus vifs au général Pellistrandi ainsi qu’à toute l’équipe de rédaction de la Revue Défense Nationale pour avoir accordé leur confiance aux jeunes chercheurs que nous sommes et nous avoir permis de publier ce Cahier. Lire la suite
Le monde est en train de vivre une bascule stratégique majeure qui voit les équilibres et les règles qui avaient prévalu depuis la Seconde Guerre mondiale remis en cause sur tous les plans. L’occidentalisation du monde, qui irriguait les relations internationales, l’économie, la politique, les valeurs et l’organisation des sociétés, s’est interrompue pour laisser la place à une compétition encore confuse entre des systèmes, des perspectives et des intérêts différents, compétition dont il est difficile de déterminer l’issue. Lire la suite
Qu’est-ce qui fait l’unité de la Méditerranée orientale ? Quoi de commun entre les différents espaces qui bordent le bassin levantin, entre Chypre et la Syrie, entre la Turquie et la Bande de Gaza ? Il semble qu’on puisse appliquer à son bassin oriental ce qu’écrivait Fernand Braudel de l’ensemble de la Méditerranée : elle n’est « pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée […] c’est tout à la fois s’immerger dans l’archaïsme des mondes insulaires et s’étonner devant l’extrême jeunesse de très vieilles villes ouvertes à tous les vents de la culture et des profits qui depuis des siècles, surveillent et mangent la mer. Tout cela, parce que la Méditerranée est un très vieux carrefour. Depuis des millénaires tout a conflué vers elle, brouillant, enrichissant son histoire : hommes, bêtes, voitures, marchandises, navires, idées, religions, arts de vivre (1) ». Lire la suite
Le contexte politique, social et économique de la Méditerranée orientale
Loin de se résumer à une division entre « démocraties au Nord » et « autoritarismes au Sud », le paysage politique, très varié, a fait de la Méditerranée orientale un laboratoire des réponses politiques à la Covid-19. Démocraties, régimes hybrides ou régimes autoritaires : tous ont fait usage d’outils d’administration contraignant fortement les libertés individuelles. L’usage de ces outils a renforcé des tendances préexistantes : enracinement de l’autoritarisme en Libye, en Égypte et en Syrie, accélération du tournant populiste en Turquie, délitement démocratique en Israël, au Liban et à Chypre. Seule la Grèce semble faire figure d’exception. Lire la suite
Les migrations à l’épreuve d’une pandémie - Claire Mabille - p. 25-30
Restriction des déplacements, fermeture des frontières, rapatriements… La propagation du virus de la Covid-19 a fortement affecté la mobilité. L’étude des migrations fait notamment apparaître quatre aspects des conséquences de la pandémie sur les migrants : les difficultés économiques des expatriés se répercutent sur leur pays d’origine ; la précarité des migrants s’accroît ; les pays d’accueil instrumentalisent la pandémie pour durcir leur politique migratoire ; les routes migratoires depuis le Sud de la Méditerranée vers l’Europe se transforment, avec une baisse du passage par la route orientale au profit de la route centrale. Lire la suite
Plus de 70 ans après la création d’un État hébreu en Palestine et l’exode de milliers de ses habitants arabes vers la Cisjordanie, la bande de Gaza et les États voisins, le conflit israélo-palestinien demeure un foyer de tensions majeur aux portes de la Méditerranée orientale. Toutefois, le déséquilibre militaire total entre belligérants, l’émergence de questions socio-économiques au premier plan de la vie politique israélienne et les récentes normalisations arabes semblent remettre en cause le caractère structurant du conflit dans les équilibres moyen-orientaux. Tour d’horizon des raisons qui poussent les auteurs à parler de « marginalisation » de ce conflit. Lire la suite
Depuis son étiage du printemps 2013, le régime de Bachar el-Assad est parvenu à reprendre le contrôle des deux tiers du territoire syrien avec l’aide de ses alliés russe et iranien. Cependant, l’essentiel de ses frontières internationales lui échappe au profit de ses alliés et de ses ennemis. Cette perte d’un symbole régalien par excellence témoigne de la réalité du pouvoir à Damas, où la Russie et l’Iran imposent leurs agendas, tandis que la Turquie étend son influence sur le Nord du pays. Lire la suite
Le 23 octobre 2020, un cessez-le-feu ouvre la voie pour une réconciliation des deux Libye : celle de l’Ouest et celle de l’Est. De fait, un gouvernement de transition reconnu par les deux camps est entré en fonction en mars 2021 et a pour tâche de mettre en place des élections présidentielles et législatives pour le 24 décembre. Néanmoins, la décennie de guerre civile passée a fait de la Libye un territoire parsemé de milices locales où ne demeurent que des institutions politiques et économiques fragilisées voire paralysées. En cas d’échec, lors des prochaines élections, la situation risque d’aboutir au renforcement des influences turque et russe sur le pays. Lire la suite
La militarisation croissante de la Méditerranée orientale
Si la Méditerranée orientale est d’une importance stratégique pour la sécurité européenne, enjeu au cœur des prérogatives de l’Otan, l’efficacité de la présence transatlantique semble discutée depuis 2011 malgré les nombreux établissements de coopérations. Celles-ci masquent la difficulté pour l’Alliance à maintenir une cohérence politique et stratégique entre ses membres, après l’effacement de la bipolarité Est-Ouest, en témoigne notamment la prise d’autonomie de la Turquie dans son action militaire régionale. Lire la suite
Prenant conscience de la dégradation de son environnement sécuritaire à ses marges, l’Union européenne travaille à mettre en cohérence une stratégie globale de Politique étrangère et de défense commune visant à garantir son autonomie stratégique. Cette initiative part du constat que l’UE a été dans l’incapacité d’agir de manière commune face aux tensions en Méditerranée orientale. Cependant, elle apparaît insuffisante pour conférer un nouvel élan politique européen. Ce cas d’étude offre à l’analyste un concentré des défis diplomatiques et sécuritaires qui ne manqueront pas de se poser aux États européens au cours du XXIe siècle. Lire la suite
Frappée et fragilisée par de grandes purges au lendemain du coup d’État manqué du 15 juillet 2016, l’armée turque n’en fut pas moins érigée dès après en instrument majeur de la diplomatie de son pays. Ankara a ainsi acté le renouvellement de sa doctrine politique et stratégique vis-à-vis de son environnement proche dans un climat régional instable, s’il ne lui est même hostile. Multipliant les interventions militaires et soutenue par une industrie militaire en plein essor, la Turquie entend s’affirmer comme une puissance militaire régionale de premier plan. Lire la suite
La Méditerranée est un point clé de la stratégie maritime russe. Elle constitue en effet un lieu de passage et de projection depuis la mer Noire vers différentes zones d’intérêt pour la Russie. Si l’instabilité de la région offre des opportunités à Moscou pour étendre son influence, elle lui impose également une approche prudente pour se prémunir de ses conséquences. Dès lors, la présence russe en Méditerranée sera probablement amenée à s’intensifier dans les années à venir. Lire la suite
Par les opportunités économiques et stratégiques qu’elle offre, la Méditerranée orientale suscite bien des convoitises. Cette compétition entre acteurs, qu’ils soient étatiques ou non, inclut toujours un risque non négligeable de confrontation armée directe. C’est pourquoi, afin d’atteindre leurs buts rapidement sans encourir une telle éventualité, certains pays adoptent une stratégie de contournement leur permettant de recourir tout de même à la force militaire, sans s’exposer à une guerre directe. Lire la suite
Le prisme de la souveraineté maritime
L’été 2020 a été le théâtre de l’incursion, dans des eaux revendiquées par la Grèce, d’un navire de recherche d’hydrocarbures turc accompagné d’une importante escorte. Cette crise est la manifestation d’une rivalité au long cours entre les deux pays, qui a donné lieu à de multiples confrontations analogues au cours des dernières décennies. Les ambiguïtés et les silences du droit international de la délimitation maritime, rapportés aux enjeux énergétiques et géopolitiques, sont un facteur permettant d’expliquer la perpétuation des tensions gréco-turques en mer Égée. Lire la suite
La négociation conflictuelle de la frontière maritime entre le Liban et Israël est révélatrice des tensions entre l’État hébreu et le Hezbollah, et de la déliquescence de la classe politique libanaise. Celle-ci, incapable de se structurer, fait montre d’incohérence vis-à-vis de leurs pragmatiques homologues israéliens. L’incapacité à trouver un accord malgré une médiation américaine et onusienne met en lumière les limites du droit international et le besoin de critères de délimitation uniformisés en Méditerranée orientale. Bien qu’un conflit armé pour le gaz ne soit pas d’actualité, la crise économique du Liban et sa précarité énergétique constituent une véritable bombe à retardement. Lire la suite
Israël, Chypre et la Grèce ont signé le 2 janvier 2020 un accord pour la réalisation du gazoduc EastMed qui doit acheminer du gaz de Méditerranée orientale vers l’Europe en contournant la Turquie. Loin cependant de résoudre les problèmes d’approvisionnement énergétique du Vieux Continent, le gazoduc s’inscrit dans une dynamique de recomposition des frontières politiques et économiques en Méditerranée et en Europe. Lire la suite
Conclusion
Conclusion - Sciences Po Défense & Stratégie - p. 109-111
Espace de convoitise, de rivalité, d’affrontement, mais aussi de coopération et d’échange, la Méditerranée orientale se présente comme une unité géographique tissée de paradoxes. La pandémie de coronavirus, qui l’a durement touchée, en a révélé les fragilités. Loin de se résumer à une division entre « démocraties au Nord » et « autoritarismes au Sud », le paysage politique régional, très varié, a fait de la zone un laboratoire des réponses politiques à la Covid-19 qu’a étudié Maëlle Panza. Démocraties, régimes hybrides ou régimes autoritaires : tous ont fait usage d’outils d’administration (contrôle physique des populations, désinformation) contraignant fortement les libertés individuelles. L’usage de ces outils a renforcé des tendances préexistantes : enracinement de l’autoritarisme en Libye, en Égypte et en Syrie, accélération du tournant populiste en Turquie, délitement démocratique en Israël, au Liban et à Chypre. Seule la Grèce semble faire figure d’exception, incarnant une « démocratie d’autorité » qui ne repose pas sur un compromis utilitaire entre économie et santé, mais privilégie la transparence et la coopération avec les citoyens. Claire Mabille met en avant un autre aspect des effets de la pandémie par l’intermédiaire de l’étude de l’évolution des flux migratoires qui sculptent la région. Expatriés, demandeurs d’asile et réfugiés se sont trouvés en première ligne face au coronavirus, vivant souvent dans des conditions précaires et n’étant que peu, voire pas, protégés par les systèmes de santé de leurs pays d’accueil. La fermeture des frontières a rendu la migration plus ardue : les travailleurs étrangers ont dû être rapatriés et la route de Méditerranée orientale est devenue plus difficile d’accès. Derrière ces conséquences sanitaires et physiques se dessinent des conséquences politiques et économiques. L’argent que les expatriés envoient à leur famille représente une part non négligeable du PIB de pays comme l’Égypte, le Liban ou la Jordanie, et la diminution de ces transferts pourrait durement affecter les économies nationales. Par ailleurs, l’exemple de la Grèce montre que la crise sanitaire a été exploitée pour durcir les politiques migratoires tout en se soustrayant au regard du droit international. Lire la suite